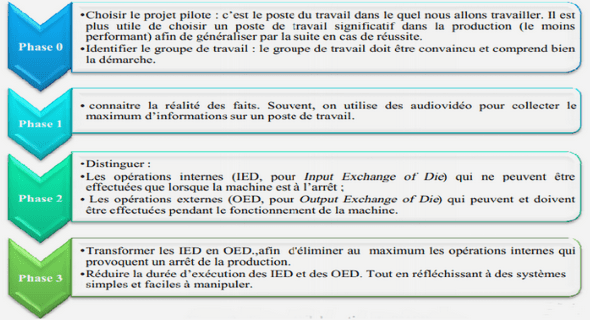LA VILLE POSTMODERNE DANS LES ROMANS DE WILLIAM BOYD
Temporalités et rythmes urbains
Représenter les temporalités urbaines n’est pas chose aisée, car, contrairement à la représentation classique du temps (le temps fléché), le temps n’est pas toujours linéaire. Dans Temporalités urbaines, Bernard Lepetit établit trois traits du temps fort intéressants : il évoque d’abord une certaine opacité due au fait que le futur ne s’inscrirait pas dans le droit fil du présent, ensuite la durée unique fait place à des temporalités plurielles et, enfin, les différents territoires ne sont pas soumis au même rythme ni n’évoluent tous dans le même sens (Lepetit 1993). La rapide croissance des villes et l’extension des agglomérations urbaines et des réseaux, entre autres, rendent la temporalité urbaine si complexe que « la pensée commune commence par hésiter quand elle s’intéresse à cette question du temps, elle tergiverse, avance, recule et est constamment prise dans des contradictions » (2003 : 16), selon François Ost dans Figures du temps. Comme c’est toujours le cas avec les agrégats urbains, pour extraire l’échelle du temps de la réalité urbaine, les apports des disciplines sont fondamentaux. Ce chapitre s’attèle à démontrer comment ces disciplines pensent le temps urbain et comment ces usages pluriels de la dimension temporelle traduisent la complexité d’un phénomène spatialisé en passe de devenir un mode de vie planétaire.
Les visages du temps urbain
Pareil à l’espace postmoderne, il y a aussi un éclatement du temps dans la ville moderne contemporaine. Le temps est multiforme et s’exprime en un palimpseste visible sur l’espace et le temps. William Boyd en fait le portrait en ayant recours à des motifs contrastant passé et présent, espace et temps, distance et durée, etc. C’est un procédé qui renseigne au moins sur une chose : une histoire et une temporalité propre à la ville, une temporalité qui peut être perçue sous plusieurs représentations.
Un temps archéologique
William Boyd fait revêtir son personnage d’un habit d’aventurier archéologue 20 avec un « regard postmoderne [qui] voit à travers les sédiments laissés par une histoire maintenant terminée » (Latouche 1997 : 1). Aussi traverser une ville, est-ce voyager dans 20Dans son étude de Los Angeles, la ville dite la plus postmoderne, Mike Davis utilise le terme de ‘Excavating’ (exhumer). Voir City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, 1990. 70 le temps, car il y a une stratification de la ville qui se lit à l’horizontale, avec les ceintures ou aires successives de constructions qui fournit la première forme de temporalité urbaine. Partant des derniers édifices construits au XXIe siècle qui entourent la ville, on rencontre une autre génération d’édifices, à l’instar du Shaftesbury Estate qui date de l’après-guerre (XXe siècle) avant d’arriver au cœur de la cité victorienne du XIXe siècle. On pourrait même nommer les édifices georgiens qui datent du XVIIe siècle, même s’il est difficile de situer leur emplacement par rapport aux édifices victoriens. Mais nous pensons logiquement, compte tenu de leur antériorité, qu’ils se situent dans l’enceinte victorienne. Il s’agit d’une alternance générationnelle qui crée une rupture esthétique et temporelle et repousse sans cesse les limites de la ville. Cette temporalité est perçue à travers la notion de « sites et monuments historiques ». Dans le passage qui suit, l’auteur met en scène une grande place au cœur de Londres. Entouré par les majestueux édifices victoriens, Finsbury Circus est le lieu où George Gérald Hogg, l’ambitieux directeur de GGH Ltd, aime souvent aller pour une raison bien précise: All around the neat central garden were the leafless plane trees, with their backdrop of solid ornate buildings with a few frozen workers smoking and shivering in doorways. The old City, Hogg always said, as it used to be in the great days—which was why he so liked Finsbury Circus (AR 78). A Finsbury Circus, le temps a suspendu son vol victorien. En vérité, cette époque glorieuse n’est jamais partie, sa présence est plus que jamais rendue par l’architecture du XIXe siècle. Ce sentiment d’immobilité est davantage renforcé par l’expression frozen workers, comme pour donner l’impression que les victoriens sont toujours là, figés par le gel. Cette impression est rendue par le caractère relativement intemporel de la description. En effet, contrairement à la narration qui met en œuvre l’aspect temporel du récit, la description « s’attarde sur des objets ou sur des êtres qu’elle fige à un moment du temps » (Jenny 2004), confirme Laurent Jenny. Quant à Hogg qui a retrouvé son temps historique, comme pour conjurer un présent désenchanteur, son esprit nostalgique crée une sorte d’inversion du flux temporel dans lequel il s’immerge. C’est dans cette fusion avec “the great days” qu’il revit son rêve de 71 grandeur à travers la sublimation pour un idéal victorien. Alors, le temps revêt une fonction thérapeutique : il panse les déceptions et désillusions, il lie aux origines, à la source originelle et rassure le citadin qu’il n’a pas perdu son âme à la modernité. Cela est quand même ironique quand on connaît l’attitude acerbe de Hogg envers Lorimer pour son manque de connectivité quant aux réalités du jour, alors que lui-même semble vénérer le passé. Même si Boyd ne le dit pas de manière explicite, ce passage marque aussi un contraste remarquable avec la vitesse et les forces entropiques qui caractérisent la ville moderne contemporaine. Il y a alors ce qui ressemble à un désir fort pour un retour à la lenteur tel qu’évoqué dans « La ville retrouve son temps » par Christel Alvergne et Daniel Latouche qui parlent d’une nouvelle propension des citadins à la lenteur. Ces auteurs expliquent comment le roman de Milan Kundera et l’essai de Pierre Sansot21 ont contribué à mettre le lent à la mode et comment on en est arrivé aujourd’hui à consacrer le 21 juin Journée internationale de la lenteur. Cette apologie de la lenteur, selon ces auteurs, a tout son sens : moins de consommation, moins d’accidents sur les routes, moins d’énergie dépensée, meilleure santé, etc. Hogg n’est pas le seul à être intrigué par le passé. En effet, il semble aussi beaucoup plaire à James Bond, comme on le décèle dans ce passage qui consacre son retour à Chelsea après une expérience traumatisante dans la jungle africaine : As it swung Sloane Square he felt his spirits lift. Sloane Square and Albert Bridge were the London landmarks that gladdened his heart whenever he saw them, day or night, all seasons—signals that he was coming home (2013: 11). De tout le bâti londonien, seuls Albert Bridge (1873) et Sloane Square (1771), monuments historiques et célèbres du paysage urbain, semblent réellement cristalliser l’attention de Bond. Ils lui indiquent qu’il est bien chez lui et le remettent d’aplomb, évoquant de fait les mêmes fonctions historique et thérapeutique. Le rapport du temps à ces édifices anciens sont une vraie obsession pour Boyd. Refusant obstinément d’être relégués à un passé archaïque, la formidable résilience dont ils font montre finit par les projeter dans le présent. Notons cependant que, pour un écrivain postmoderne comme Boyd, il n’est pas toujours facile de dire si cet intérêt pour la tradition victorienne, où le passé, en général, relève d’une nostalgie ou d’une attitude révisionniste, s’il suit la tendance contemporaine des écrivains pour leur fascination pour le passé, ou s’il cherche à déconstruire le modèle victorien. Dans Nostalgic Postmodernism: The Victorian Tradition and the Contemporary British Novel, Christian Gutleben recommande, pour faire la différence, de voir si le roman contemporain en question favorise “the derisive quality of parody or the mimetic quality of pastiche” (2001 : 8). En effet, l’ironie et la dérision sont le propre de la parodie, du post-roman, et Boyd en use librement dans diverses situations. En vérité, la satire semble même être “an integral component of his narrative universe, even to the extent of determining the way he constructs his characters, settings and plots” (2006: 11), comme le soutient Juan Francisco Elices Agudo à propos de Boyd. L’humour noir, le mordant, tourner en dérision, etc. sont au cœur de la fiction boydienne, comme lui-même le reconnaît dans une interview22. C’est aussi une influence qui proviendrait du romancier anglais au style sarcastique, Evelyn Vaugh, dont il dit être fasciné par son humour sombre et cynique. Mais on ne peut non plus ne pas penser au pastiche qui est un outil littéraire qui crée l’éclectisme, valorise et est tout aussi caractéristique du postmodernisme. Plus même, pour être né et avoir grandi en Afrique, qui a une tradition plutôt tournée vers le passé, on ne serait pas surpris que Boyd cherche quelque part à faire resurgir la grande tradition victorienne pour exprimer son attachement à un certain passé. Mais la dimension postmoderne de ce regain d’intérêt pour ce type d’architecture réside surtout dans le fait qu’il s’insurge contre l’universalisme du mouvement moderne : “these reactions featured a renewed interest in the specificity of regional and historical style along with a respect for the diversity of urban subcultures” (Ellin 1996 : 23). Une brèche dans laquelle se sont engouffrées les sciences sociales qui ont utilisé l’urbanisme et l’architecture comme cadre théorique pour ce regain d’intérêt pour l’architecture locale et historique, une façon de valoriser la diversité culturelle dans l’espace urbain. Et pour faire davantage ressortir la longue lutte des édifices classiques pour la survie, l’auteur présente, dans un autre roman, une autre scène pas contemporaine, mais qui date de 1939. Il s’agit d’une grande place à Bruxelles qu’observent Eva et Morris Devereux à travers les fenêtres d’un café: They sat indoors and smoked a cigarette and drank tea, looking out through the windows at the ornate cliff faces of the buildings round the massive square, their sense of absolute confidence and prosperity still ringing out across the centuries (RL 77). Ce passage révèle un temps passé glorieux qui défie et nargue la modernité : ces bâtiments anciens dégagent une impression de résilience et de prospérité à toute épreuve, une confiance absolue (their sense of absolute confidence) quant à leur immortalité. Car le temps présent, pétrifié à l’intérieur de ce café à partir duquel se regarde l’éternité (ringing out across the centuries), n’a aucune emprise sur ce passé plus que présent. Ici, Boyd semble faire un clin d’œil à certains philosophes, comme Kierkegaard qui a inventé la notion d’« instants d’éternité », c’est-à-dire cet ambigu où le temps et l’éternité sont en contact, posant ainsi le concept de temporalité où le temps interrompt constamment l’éternité et où l’éternité pénètre sans cesse dans le temps (Kierkegaard 1990 : 150). Le philosophe met en exergue l’idée paradoxale du temps qui passe, car on se rend compte que le temps imite plutôt l’éternité. L’idée d’éternité vient du fait du vécu de certains instants comme la contemplation de ces édifices victoriens, ce qui conforte bien l’idée de François Ost selon laquelle « Tout passe avec lui [le temps] sauf lui qui ne passe pas à travers ce qui passe » (2003 : 24). Ce rapport de force temporel qui se lit dans la dualité passé-présent laisse perplexe. Il défie même la loi temporelle qui divise le temps en trois éléments (passé, présent, futur) et veut, par conséquent, que l’histoire soit enfermée dans le passé. En effet, selon la logique 74 historique, on ne peut comprendre la complexité d’une situation donnée sur laquelle on veut faire œuvre d’historien, qu’ « à la condition de prendre bien garde de laisser le temps faire son œuvre. On permettra ainsi aux œuvres humaines de s’achever ou même d’être anéanties » (Vigneron 2007 : 3). Mais ce temps historique, qui se lit à travers l’architecture ancienne, particulièrement victorienne, refuse de faire son œuvre, d’être anéanti et, au lieu de se limiter à « frôler le présent », semble même y faire irruption. Ainsi, semblable à l’historien dompteur du temps, qui l’empêche de s’écouler, de s’enfuir, Boyd ramène le passé ancien et le rend vivant sous les yeux du citadin : « Qui, si ce n’est l’historien, sait dompter le passé et le ramener, plein de vie, en notre présent ? » (Vigneron 2007 : 28), applaudit Vigneron. C’est cela qui fait dire à El hadj Cheikh Kandji que « l’architecture pense les temps : passé, présent, avenir, les coule dans le même moule atemporel et futuriste » (2007 : 102). Dans son approche de l’architecture comme pensée de l’espace, l’auteur évoque en effet une relation triangulaire entre architecture, passé et pensée. Une dialectique du temps présent et du temps historique qui s’interpénètre sans cesse et qui, sous un angle philosophique, est à l’origine de ce que Kierkegaard qualifie d’ « instant », comme souligné précédemment.
Un temps psychologique
Le citadin est pris dans une dualité temporelle. Le retour qu’il effectue sur le passé s’opère à travers la métalepse, ce qui le plonge dans deux conceptions du temps opposées : le temps psychologique, le temps qui se passe en chaque personne par opposition au temps des horloges ou temps mathématique. Ce temps semble émerger avec la tension qui interrompt le cours du présent. Le cas d’Adam Kindred l’illustre à merveille. Fugitif, il oscille constamment entre le passé perdu de sa situation antérieure qu’il ne peut plus réintégrer et l’avenir menaçant qui le guette à chaque coin de rue parce que recherché par la police : He stood in the dark mews at the back of Grafton Lodge and looked at the back of the hotel for the window of his room and duly found it: dark, the curtain half-drawn as he had left them that morning for his interview at Imperial College. What world was, he thought? … He thought of his new three-bedroom house in Phoenix, Arizona … he could see its watered green lawns, the neat laurel hedge, the twin-car garage … (OT 14). Le paradoxe du désir qui se lit en Adam met en évidence un manque, on dira même un rêve fou, qu’il n’arrive pas à combler. En effet, la distance qui le sépare de sa chambre d’hôtel au Grafton Lodge si proche (il se trouve derrière l’hôtel, sous les fenêtres de sa chambre) est, psychologiquement, la même qui le sépare de sa maison de Phoenix en Arizona. En effet, c’est la liaison impossible qu’il fait de sa situation antérieure à travers une construction mentale qui est importante et non la distance physique qui le sépare de ces lieux. 76 Le désir impossible de se retrouver en sécurité crée une distorsion temporelle pareille à “a parallel universe, or something that had existed aeons ago” (OT 77). C’est cela le temps psychologique, le temps qui se passe en chaque individu (il peut être court ou long selon le contexte) et qui est différent du temps de l’existence qui s’écoule en années, heures, instants. Dans la diégèse boydienne, ce temps apparaît quand le personnage est saisi en temps de crise, quand il ploie sous les exigences multiples de la ville : « le moi est une succession d’états instables où … rien n’est constant que l’instabilité même » (Genette 1992 : 26). Autrement dit, il y a une série de changements de positions (Phoenix, Grafton Lodge, la rue de derrière, etc.) et de changements d’états (watered green lawns, parellel universe, aeons ago, etc.). La souffrance provient de l’impossibilité du personnage à réaliser ces désirs antagonistes. C’est du moins la perception que Schopenhauer donne du désir et de la souffrance : « le désir est long, et ses exigences se tendent à l’infini » (1998 : 101). Le désir crée des exigences et celles-ci se multiplient, reportant incessamment la satisfaction des désirs. C’est l’impossibilité à concilier ces deux extrêmes qui engendrent la douleur. Selon Schopenhauer, le désir est l’origine du malheur pour l’homme parce qu’il le condamne à l’insatisfaction et le maintient dans une perpétuelle inquiétude. Une situation de manque et de privation dont on ne peut se libérer parce qu’on n’entrevoit pas de solution, ce qui place la condition humaine sous le sceau d’une répétition infernale. Cette dualité entre désir et souffrance crée une sorte d’effet illusion-réalité temporel qui produit à son tour un flou artistique, voire un effet de mirage, comme la distance réelle et celle sur une carte. Prenons l’exemple des pérégrinations d’Adam à travers la ville gigantesque: Adam walked from Chelsea to Southwark—across Chelsea Bridge to Battersea and then round the back of the power station and along the river, most of the way… he was guided past Lambeth Palace and the National Theatre, along Bankside and under London Bridge to Southwark … In Southwark he … directed … off Tooley Street, down on the river by Unicorn Passage and so he headed that way, realising he was leaving Southwark for Bermondsey … and he went further east, along Jamaica Road, turning left and 77 then right, following the signs and arrows before finally arriving at his destination—on the edge of the river … (OT 112-3, nous soulignons). Si l’on mesure cette distance tortueuse de Chelsea à Southwark sur une droite, ou si on l’offre au cercle de l’horloge pour qu’il la découpe en intervalles de temps mesurables sur l’échelle d’une carte, la réalité est tout autre. En effet, s’il faut une heure et demie pour relier les deux points, sur une carte, une seule enjambée suffit : “yet on a map he would have covered no distance at all” (OT 163). Ainsi, la carte fonctionne comme un stratagème en trompe-l’œil qui rétracte comme par enchantement les distances afin de présenter une ville domptée aux yeux du citadin, une façon intelligente de se donner de la contenance devant une ville tentaculaire. Ce temps qui se passe dans la tête de chaque citadin est le produit des effets de la ville sur le citadin. C’est donc un temps produit de l’action. 2.1.3. Un temps de l’action Le temps de la ville est aussi le temps de l’action qui rythme la vie urbaine. Il se conçoit à travers l’action du citadin exercée sur l’espace urbain ou celle que la ville exerce sur le citadin. Si, dans la cohabitation du vieux et du neuf, on ne lit pratiquement que l’écart temporel, au XXIe siècle, cet écart se fait rythme. Une dimension temporelle sur laquelle revient souvent Boyd, c’est le rythme d’aménagement de l’espace auquel la ville est soumise. Dans le Silverstone, à l’extrême est de Londres, par exemple, c’est ce type de spectacle auquel on assiste : un renouvellement du neuf par le neuf: Everything was going here, or being transformed, cast out by the new. It seemed a different pioneering city out here in the east … everything was new here, and he felt new also, a new species of man, as if he were in a newer city … (AR 71, 181). Lorimer est ému par le rythme effréné dans la construction (a newer city), qui a fini de supplanter tout ce que le monde a connu du XIXe au XXe siècle. Cette expansion 78 donne l’impression d’une juxtaposition de villes de plus en plus neuves, c’est-à-dire un renouvellement du présent par le plus-que-présent, le temps chassant le temps, le temps urbain renouvelé. Autrement dit, les écarts temporels notés sur les marques archéologiques jusqu’au XXe siècle font état d’un renouvellement du vieux par le neuf, parce que les rythmes d’évolution sont assez lents, contrairement au début du millénaire qui consacre une expansion si fulgurante que les marques archéologiques de la ville n’ont même pas le temps de vieillir. De la même façon, les espaces aménagés augmentent exponentiellement, comme schématisé par la figure ci-dessous : Figure 1 : Diamètre approximatif de la ville dans la diégèse romanesque Plus intéressant encore, cette action urbanistique sur les dernières strates de la ville impacte en retour sur le mental du citadin qui se sent lui-même renouvelé (he felt new also, a new species of man), immergé dans un flux régénérateur. Un sentiment de régénération mutuelle basé sur la sensation que procure le neuf. En vérité, Londres a toujours été une ville à l’expansion fulgurante. C’est l’action que décrivait le tableau qu’Arthur Machen faisait de la Londres anthropophage du XXe siècle, qui ne laissait à ses frontières que des paysages souffrants, agonisants, “continually exhibit[ing] something new and altogether unexpected” (cité par Prungnaud 2007).
INTRODUCTION |