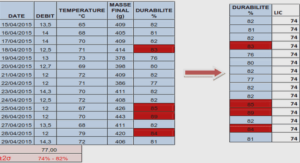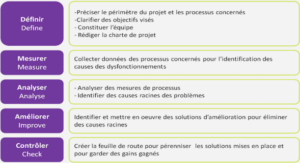La vie sujet et métamorphoses
Qu’est-ce que la vie et comment en rendre compte en termes atomistes ?
Comment expliquer que le sujet pensant soit aussi un objet physique, qu’il se trouve à l’interface entre passivité et activité ? Où se trouve la limite entre ces deux sphères ? L’origine de la vie ainsi que son terme, l’interaction de la personne avec son environnement et le fonctionnement du corps animé sont trois pôles de débats acharnés qui retiennent l’attention de Digby. Le chevalier consacre une part non négligeable de Deux traités à ce que l’on appellerait aujourd’hui la biologie ; en analysant la place de l’homme dans le monde physique, il décrit les interactions entre les dimensions terrestre et spirituelle, et il analyse comment le sujet s’inscrit dans un monde qui lui est parfois hostile. De fait, l’ensemble de ses considérations physiques dépend de la façon dont l’homme perçoit et connaît son entourage. Digby analyse la vie humaine, animale et végétale à l’aide de trois points fondamentaux : le fonctionnement des sens dont la dimension épistémologique est cruciale pour l’élaboration de sa logique, le mouvement du cœur qui allie émotions et principe de vie et qui semble faire le lien entre les éléments matériels et spirituels de l’homme et enfin l’origine de l’être humain, la naissance, mise en parallèle avec la germination des plantes. Le monde ne peut être appréhendé que grâce à l’intermédiaire que constituent les cinq sens dont le bon fonctionnement autorise l’analyse du monde ; véritables ponts entre la subjectivité et le monde physique, les sens participent à toutes les interactions avec le monde. Une fois décrite la présence physique, on s’aperçoit que le fonctionnement régulier et ordinaire du corps vivant dépend du mouvement du cœur, siège de la vie physique et de la conscience émotionnelle. En un seul organe se trouvent ainsi paradoxalement réunis le principe vital le plus cadencé et l’émotion anarchique, pilier de l’esthétique baroque1 . Enfin, l’enquête mène aux origines de la vie, à la naissance qui, nimbée de mystère, interroge la façon dont le spirituel vient s’allier au monde matériel et ausculte les limites de l’existence immatérielle. L’ensemble de ces phénomènes contribue à une définition de la vie et de l’homme placée sous le signe de la métamorphose. Ainsi, l’homme participe au changement perpétuel du monde matériel en subissant quotidiennement dans son corps des transformations discrètes, mais incessantes, qui permettent le fonctionnement de son être. 3.A. Les sens et l’appréhension du réel La sensation est une véritable passerelle entre le sujet et le monde qui l’entoure. Elle permet de connaître et d’expérimenter, mais elle fonde aussi toute expression et communication, elle est l’un des sites de rencontre entre l’individu et son environnement ainsi que des hommes entre eux. Plus profondément, la question de la sensation et du fonctionnement des sens fait écho à des interrogations épistémologiques : est-il possible et désirable de faire confiance à ses sens pour appréhender le monde ? Les sens perceptifs tels que la vue et l’ouïe sont parfois trompeurs et sujets à illusions ; ils ne sont plus que de « ternes étincelles », vestiges abîmés de la perfection des sens dont jouissait le premier homme1 . La corruption de l’homme et la dégradation de ses sens par des siècles de mauvais comportement pouvaient cependant être compensées par l’usage d’instruments tels que le microscope ou le télescope, ce qui permettait d’observer l’infiniment grand et l’infiniment petit2 . En sus de la nécessaire médiation instrumentale pour appréhender le réel, l’atomisme que choisit Digby ne fournit aucun fondement métaphysique pour garantir la vérité des apparences sensibles, alors que le XVIIe siècle tente de réhabiliter la vue – et avec celle-ci, tous les sens perceptifs – comme source fiable pour appréhender le réel3 . Cette évolution entraîne la transformation des cadres structurels de l’expérience sensible comme l’a démontré Philippe Hamou4 . La discussion des sens revêt une importance particulière du seul fait que, en tant qu’atomiste, le chevalier est sous le coup de l’accusation habituellement portée aux disciples d’Épicure et de Démocrite, fustigés pour un athéisme qui va jusqu’à rendre compte de toute connaissance par le truchement des sensations. Digby sépare donc soigneusement l’activité des sens du savoir qui peut en découler au moyen d’un mystérieux phénomène qui échappe à toute description. En outre, la possibilité de la pensée est en jeu, puisque, comme le rappelle le chevalier au cours de sa discussion de la sympathie, les sens, par le biais des esprits internes, servent à l’homme à « sçavoir et reconnoistre ce qui se fait hors de son Royaume, dans le grand monde ; et qu’il puisse éviter ce qui luy pourroit nuire, et rechercher ce qui luy est utile1 ». La sensation fonde la compréhension du monde par le sujet, de même qu’elle est à la racine de son discernement. Le discernement de ce qui est bon ou mauvais pour soi provient des sensations, et si cette capacité est partagée par les animaux et concerne d’abord les besoins physiques, il n’y a qu’un pas à faire pour y voir l’origine du sens moral2 . Les sensations permettant la juste appréhension du monde, elles servent de fondement au jugement. Comme le rappelle Digby, « en matière de fait, la détermination de l’existence de la vérité ; dépend du rapport que nos sens nous en font », i l est donc essentiel, dans l’approche digbéenne, de revenir à ce qui permet au sujet de prendre conscience de son environnement matériel et humain afin de déterminer la légitimité qu’il y a à poursuivre la connaissance.
Le lieu de la sensation
Le premier objectif de Digby est de prouver que la sensation ressortit du domaine matériel et non du spirituel. Il s’insurge ainsi contre les « espèces intentionnelles » scolastiques, représentations cognitives qui s’insèrent dans l’entendement pour faire connaître à distance4 . À l’origine de la théorie, Aristote postule que les formes des objets externes sont transférées au cœur de l’animal au cours de la perception, le cerveau ne servant qu’à refroidir le corps5 . L’acte perceptif permet donc de recevoir la forme sans la matière, tandis que les quatre éléments sont la cause active et véritable de la sensation6 . La théorie de la sensation est l’un des sites majeurs de l’affrontement entre philosophie scolastique et philosophie nouvelle, et Digby a une conscience aiguë de ce conflit. Les tenants des espèces intentionnelles, avance-t-il, ont désormais la double tâche de prouver que ce qu’il y a dans la nature ressemble à ce qu’ils hasardent, mais aussi d’invalider l’hypothèse atomiste7 . Si la remarque paraît présomptueuse, elle rappelle avec justesse le défi nouveau qui s’offre à la philosophie scolastique. À l’inverse, Digby récuse que les choses de ce monde puissent émettre des images spirituelles d’elles-mêmes ; il argue que ce sont des corpuscules jaillissant de toute chose qui pénètrent les cinq sens humains. Contrairement à ses prédécesseurs scolastiques, Digby refuse l’idée que les choses soient en notre pensée comme un reflet du réel, une image de la chose véritable, « que les objets ne s’introduisent dans l’âme que par une partie de leur être et que ce sont seulement des images des objets qui sont immédiatement données à l’esprit et soumises à son examen1 ». À l’instar de Descartes, il rejette la fameuse théorie scolastique des espèces qui voulait que les objets émettent de petites images d’eux-mêmes et les envoient vers les organes sensoriels. Au sein de ce différend, Digby se range aux côtés du mécanisme tout en soulignant le caractère éclectique de son approche, en phase avec son idée que chaque courant de pensée comprend une part de vérité s’il est correctement interprété. Digby pose que les sensations sont résolument matérielles et qu’elles sont un mouvement, mais il réinjecte au cœur de sa réflexion de nombreux éléments empruntés à Aristote dans le but de conférer à son mécanisme une certaine légitimité. À la fois subjectives et objectives, personnelles et collectives, les sensations sont paradoxales. On doit d’abord supposer qu’elles sont ressenties par tous, en dehors des cas pathologiques. Le processus de nomination de ces sensations l’illustre bien : étiquetées d’après les passions et affects qu’elles suscitent, elles se regroupent sous des dénominations issues d’un accord commun. Ainsi, tous prêtent le même sens à l’idée du « trop chaud » qui décrit l’inconfort qui fait désirer la fraîcheur, rend les mains moites et fait transpirer. Dans toute sensation, il y a un classement dans une catégorie générale ; chacune comprend donc une part d’universalité. Cependant, si l’on y regarde de plus près, la sensation a aussi une dimension subjective. Non seulement certains prennent pour parfum ce que d’autres trouvent ignoble comme odeur, mais il peut y avoir aussi différents mots pour une même sensation : une liqueur sera taxée de sucrée ou d’amère par deux goûteurs. En outre, une personne peut percevoir une même chose de manière distincte à deux moments donnés : celui qui se rend aux bains turcs et qui trouvera la première pièce bien trop chaude, au sortir de l’établissement, après avoir traversé toutes les salles d’eau, chacune plus chaude que la précédente, trouvera ce premier bain frisquet2 . Avec cet exemple, Digby postule d’emblée une mémoire sensorielle, primordiale dans le processus de nomination et d’évaluation du ressenti, qu’il justifie, a posteriori, par un cheminement cognitif qui sera développé au cours de l’étude de sa logique. Il faut cependant noter que cette mémoire participe activement à la nature de l’impression. La sensation se trouve à l’interface du sujet et de la collectivité, mais aussi entre monde physique et royaume cognitif. Le paradoxe de la sensation conduit à s’interroger sur le lieu de la sensation par rapport au corps. Toute sensation comprend un stimulus extérieur et aboutit à une prise de conscience intérieure : mais où a-t-elle réellement lieu ? Plutôt que d’estimer que les qualités sensibles sont des entités indivisibles et distinctes du corps humain, ne devrait-on pas les considérer comme des parties du corps humain lui-même ? De fait, à y regarder de près, la sensation comprend une stricte individualité qui pourrait s’apparenter à celle du corps : tel nez appartient au corps d’un sujet distinct, de même que les odeurs qu’il sent – peut-être que le nez et les odeurs sont tout simplement liés en profondeur au point de ne faire plus qu’un. La sensation de l’odorat serait alors un attribut du nez, que l’on pourrait décrire comme camus, allongé et ayant tel type d’odorat. Ce que sentirait le nez serait propre à lui seul et conséquence de son fonctionnement particulier1 . Digby rejette cette définition interne des sensations et assure que celles-ci sont extérieures au corps, elles le frappent, l’interpellent et s’immiscent dans le sujet. Cette vision des choses est rendue possible par l’hypothèse atomiste, dans la mesure où Digby voit un espace continu d’atomes en perpétuel mouvement, là où Aristote subodore, entre la réalité sensorielle et les organes sensitifs de l’homme, un milieu intermédiaire qui, lorsqu’il se trouve ébranlé, est la cause directe et physiologique de la sensation. Les atomes provoquent des impressions sur les organes de sens (nez, oreilles, yeux, langue et peau) qui deviennent alors des passeurs de messages et qui laissent entrer les atomes et les dirigent vers les nerfs. Ces derniers sont d’étroits canaux emplis d’esprits qui se mêlent aux atomes et les conduisent jusqu’à l’entendement. Si les esprits animaux qui les occupent sont trop épais, comme chez le paralytique ou l’homme qui ne sent pas, les atomes ne peuvent pas être conduits vers le « tribunal du cerveau2 ». C’est ce dernier qui effectue l’action de sentir proprement dite : il détermine la nature de la sensation et réagit en conséquence. Par exemple, l’expérience du froid se traduit par la pénétration des atomes correspondants qui sont canalisés vers le cerveau, acteur ressentant de la basse température..