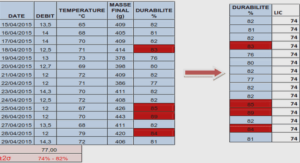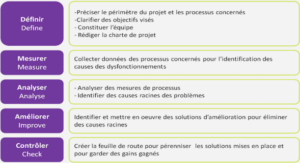Le débat sur l’existence de Dieu
Bien qu’elle ne constitue, strictement parlant, qu’un élément parmi d’autres d’une interrogation philosophique sur la religion, la question de l’existence de Dieu a offert matière à un débat récurrent tout au long de l’histoire de la philosophie. Nombre de métaphysiciens se sont efforcés de démontrer rationnellement que Dieu existe, soit à partir de son concept, soit à partir de l’ordre du monde, soit enfin à partir de la contingence de l’univers.
Emmanuel Kant a proposé un classement de ces preuves de l’existence de Dieu, qui a été adopté depuis : ces preuves ne sont plus qualifiées de « physiques », « métaphysiques » et « morales », mais de « physico-théologiques », « cosmologiques » et « ontologiques ». La preuve ontologique a connu la plus grande fortune, dans sa version anselmienne (texte 7), comme dans ses versions cartésienne (texte 9) et leibnizienne (texte 10). Saint Thomas d’Aquin, pour sa part, a préféré défendre un argument cosmologique, qui greffe un contenu dogmatique chrétien sur le modèle d’argumentation aristotélicien (texte 8). Kant, cependant, a définitivement mis fin à toute tentative de traitement métaphysique de la question de l’existence de Dieu : une telle prétention est illusoire, compte tenu de nos capacités limitées de connaissance. La grande porte de la métaphysique ayant été refermée et condamnée de manière irrévocable, seule semblerait rester ouverte la fenêtre de la religion. C’est pourtant par une réflexion éthique que Kant pose sur de nouvelles bases le problème de l’existence de Dieu (texte 11).
Paradoxalement, malgré son statut privilégié parmi les débats classiques de la philosophie, l’examen de la question de l’existence de Dieu se situe à la marge d’une approche philosophique de la religion : son propos concerne en effet moins le pourquoi de l’attitude humaine qu’est la religion, que le quoi de la causalité du monde. En un mot, son enjeu est d’ordre métaphysique. Et en tant que tel, ce débat subira, au cours de l’histoire de la philosophie, les aléas qui affecteront tous les questionnements métaphysiques. Il ne sortira pas indemne, notamment, de la révolution kantienne. Justement parce que le problème de l’existence de Dieu ne peut être tranché par la métaphysique de manière irréfutable, et ne le pourra jamais, il laisse le champ libre aux choix proprement humains, soit strictement subjectifs, soit à prétention universelle comme l’exigent les principes de la morale kantienne. Le problème philosophique de l’existence de Dieu ne disparaît donc nullement, mais se déplace : quel(s) choix faut-il faire, face à une question qui demeurera fatalement sans réponse positive, qui ne pourra jamais être tranchée sans contestation possible ? Et comment justifier ce(s) choix ? Au nom de quoi faut-il en décider et s’y engager ?
La preuve ontologique de l’existence de Dieu, Saint Anselme (1033-1109)
Saint Anselme, moine en Normandie (à l’abbaye du Bec), puis archevêque de Cantorbéry, cherche à démontrer l’existence de Dieu. Il élabore à cet effet un argument que l’on appellera métaphysique, jusqu’à ce que Kant le nomme ontologique.
Donc, Seigneur, toi qui donnes intellect à la foi, donne-moi, autant que tu sais faire, de comprendre que tu es, comme nous croyons, et que tu es ce que nous croyons. Et certes, nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand. N’y a-t-il pas une nature telle parce que l’insensé a dit dans son cœur : « Dieu n’est pas10 » ? Mais il est bien certain que ce même insensé, quand il entend cela même que je dis : « quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand », comprend ce qu’il entend, et ce qu’il comprend est dans son intellect, même s’il ne comprend pas que ce quelque chose est. Car c’est une chose que d’avoir quelque chose dans l’intellect, et autre chose que de comprendre que ce quelque chose est. En effet, quand le peintre prémédite ce qu’il va faire, il a certes dans l’intellect ce qu’il n’a pas encore fait, mais il comprend que cette chose n’est pas encore. Et une fois qu’il l’a peinte, d’une part il a dans l’intellect ce qu’il a fait, et d’autre part il comprend que ça est. Donc l’insensé aussi, il lui faut convenir qu’il y a bien dans l’intellect quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, puisqu’il comprend ce qu’il entend, et que tout ce qui est compris est dans l’intellect. Et il est bien certain que ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand ne peut être seulement dans l’intellect. Car si c’est seulement dans l’intellect, on peut penser que ce soit aussi dans la réalité, ce qui est plus grand. Si donc ce qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est seulement dans l’intellect, cela même qui est tel que rien ne se peut penser de plus grand est tel qu’on peut penser quelque chose de plus grand ; mais cela est à coup sûr impossible.
Il est donc hors de doute qu’existe quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand, et cela tant dans l’intellect que dans la réalité.
Pour mieux comprendre le texte
Saint Anselme voit dans la raison un appui pour la foi, une foi à la recherche de l’intelligence d’elle-même (« fides quaerens intellectum »). La philosophie est donc au service de la théologie, les prémisses et les finalités de son raisonnement sont religieuses (l’auteur dit à plusieurs reprises : « nous croyons »). Cependant la définition qu’il donne de Dieu doit pouvoir être admise par tous, y compris par « l’insensé » évoqué dans les Psaumes, celui qui soutient que Dieu n’existe pas. Cette définition est la suivante : Dieu serait « quelque chose de tel que rien ne se peut penser de plus grand ». Tout homme, même athée, peut concevoir un tel être.
À partir de cette définition, saint Anselme développe l’argument suivant : un tel être ne peut pas exister seulement dans l’intelligence (« l’intellect »), car s’il n’était qu’un concept (et n’existait donc pas dans la réalité), on pourrait concevoir un autre être qui, lui, existerait aussi dans la réalité (et non seulement dans l’intelligence), et qui par conséquent serait plus grand que le premier. Pour être vraiment « tel que rien ne se peut penser de plus grand », il doit donc exister non seulement dans l’intelligence, à titre de concept, mais aussi dans la réalité. Dire que « Dieu n’existe pas », c’est donc se contredire ; car comment penser un être infiniment grand (ce que chacun peut faire), et lui refuser en même temps l’existence (ce que font les athées) ?
Cette preuve de l’existence de Dieu est dite ontologique car elle part de son essence et de son concept, et non cosmologique (elle partirait de la contingence du monde pour remonter jusqu’à l’existence d’un être nécessaire), ou physico-théologique (elle partirait de l’ordre régnant dans le monde pour remonter jusqu’à sa cause).
L’argument ontologique sera critiqué par le moine Gaunilon, du vivant même de saint Anselme qui lui répondra ; puis il sera critiqué par saint Thomas, repris et transformé par Descartes et Leibniz, à nouveau critiqué par Kant…
La preuve cosmologique de l’existence de Dieu, Saint Thomas D’Aquin (1227-1274)
Théologien dominicain, saint Thomas d’Aquin veut concilier philosophie et théologie. Il fait donc appel à la raison pour démontrer l’existence de Dieu.
Cinq voies sont possibles pour prouver que Dieu existe.
La première et la plus manifeste part du mouvement. II est certain, d’une certitude sensible, qu’il y a du mouvement ou du changement dans le monde. Or tout ce qui est mû, est mû par autre que soi. En effet, rien ne se meut qu’en étant en puissance par rapport au terme du devenir ; et ce qui meut est en acte, puisque mouvoir n’est rien d’autre qu’élever un être de la puissance à l’acte : un être ne peut être porté à l’acte que par un être en acte (…). Mais il est impossible qu’un être soit, à la fois et sous le même rapport, en acte et en puissance (…). Impossible donc d’être, sous le même rapport et identiquement, moteur et mû, c’est-à-dire de se mouvoir soi-même absolument. Donc ce qui est mû est mû par autre que soi. Si donc le moteur est mû, ce ne peut être que par un autre, et cet autre par un autre. Mais on ne peut remonter à l’infini (…). Il faut donc en venir à quelque premier moteur qui ne soit mû par aucun autre : ce que tout le monde entend par Dieu.
La deuxième voie s’appuie sur la notion de cause efficiente. Nous trouvons, dans ce monde sensible, un ordre de causes efficientes. On ne voit pas, et il est impossible, qu’un être soit sa propre cause efficiente : il existerait avant lui-même. Impossible, ici encore, de remonter à l’infini. (…) Par conséquent il est nécessaire de poser une cause efficiente première. C’est elle que tous appellent Dieu.
La troisième voie se réfère aux notions du possible et du nécessaire. Nous trouvons, dans la nature, des êtres qui peuvent exister ou ne pas exister (…). Mais (…) il existe, immanente au monde, quelque nécessité. Mais ce qui est nécessaire tient, d’un autre ou de soi-même, la raison de sa nécessité. Et comme pour la série des causes efficientes, il est impossible, pour les êtres nécessaires qui n’ont pas en eux-mêmes la cause de leur nécessité, de remonter à l’infini. Il faut donc poser un premier terme nécessaire par lui-même, et qui donne aux autres leur nécessité : ce que tous appellent Dieu.
La quatrième voie part des degrés constatés dans l’ordre même du réel. On constate, dans le monde, du plus et du moins : degrés de bonté, de vérité, de perfection, etc. Le plus et le moins désignent divers termes par la distance différente qui les sépare d’un absolu. Il existe donc un absolu dans l’ordre du vrai, du bon, du parfait, et par conséquent de l’existence (…). Il existe donc pour tous les êtres une cause de leur existence, de leur bonté, de toutes leurs perfections. Nous l’appelons Dieu.
La cinquième voie part de la considération de l’ordre qui règne dans le réel. Nous voyons des êtres dépourvus de connaissance agir en vue d’une fin (…). Il existe donc un principe intelligent qui oriente vers leur fin toutes les réalités naturelles. Nous l’appelons Dieu.
Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, I, question 2, article 3 (1266-1274), trad. J. Rassam, in L’Etre et l’Esprit. Textes choisis, éd. PUF, 1964, pp. 30-32.