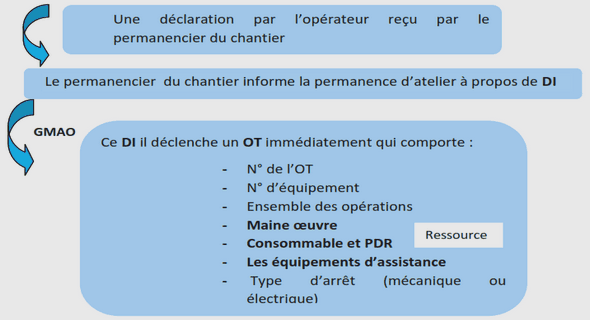La théorie de l’illégalité légitime
Les pouvoirs de guerre
Dans le présent Appendice, nous attirons brièvement I’ attention sur une théorie qu’on a appelée la théorie de l’illégalité légitime (cf. G. Renard, Le Droit, la Logique et le Bon Sens, p. 360), et qui, bien qu’intéressant plutôt la question du contrôle de la légalité proprement dite, est, cependant, de nature à nous fixer, à certains égards, l’étendue des possibles?ilités d’application du contrôle juridictionnel de la moralité administrative. Il s’agit, plus spécialement, de la conception jurisprudentielle des pouvoirs de guerre avec l’extension qu’elle a reçue pour le règlement de certains problèmes nés de circonstances exceptionnelles susceptibles de se produire en temps de paix. Si l’idée même de l’illégalité légitime n’est pas absolument nouvelle (2), elIe ne s’est cependant affirmée dans toute sa force que pendant et depuis la guerre, notamment ·en ce qu’elle a été appliquée non pas seulement aux mesures individuelles et particulières, ou elIe POUy~it encore être justifiée par une conception large du pouvoir discrétionnaire, mais encore – ce qui est plus grave – au pouvoir réglementaire exercé à l’encontre de la loi et des libertés individuelles. I. – A l’ époque de la grande lutte qui exigeait la concentration de toutes les énergies pour mener à bien l’entreprise de défense du pays, le Conseil d’Etat dut nécessairement s’apercevoir qu’en présence des intérêts vitaux en cause, l’application stricte de la loi ne pouvait se justifier en toutes circonstances. C’est pourquoi il a élaboré ce qu’on a appelé la théorie des pou’l Jours de guerre, en vertu de laquelle il a reconnu au gouvernement le droit de prendre des mesures exorbitantes et contraires au droit établi lorsqu’il se ;trouvait dans l’impossibilité absolue d’assurer la vie de la nation par les voies légales. Pour aboutir à ce résultat, sans trop heurter les conceptions traditionnelles, le Conseil d ‘Etat fonda sa jurisprudence sur une interprétation tendancieuse des lois constitutionnelles. Si l’on doit admettre que l’emploi de cet argument de texte n’ était pas très juridique, on ne peút s’ empêcher d’approuver pleinement les motifs qui ont porté le Conseil ‘d’Etat à faire abstraction de tout scrupule inopportun pour reconnaître, en dernière analyse, que la logique stricte des principes devait céder le pas à des considérations de fait qui, dans des cas exceptionnels, s’imposent sans discussion possible. C’est ainsi, notamment, que, dans un arrêt du 28 juin 1918 Heyries, apres avoir posé en principe que, par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le Président de la République est placé à la tête de l’administration française et chargé d’assurer l’exécution des 10is, qu’il lui incombe, dés lors, de veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements .soient en état de fonctionner et à ce que les difficultés résuItant de la guerre n’en paralysent pas la marche », le Conseil d’Etat déclara qu’il appartenait au Président de la République d’apprécier que la communication, prescccrite par l’ article 65 de la loi du 22 avril r 905, à tout fonctionnaire de son dossier, préalablement à toute sanction disciplinaire, était, pendant la durée des hostilités, de nature à empêcher, dans un grand nombre de cas, l’ action disciplinaire de s’ exercer, et à entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires li la cc vie nationale, qu’en raison des conditions dans Ies quelles s’exerçaient, en fait, à cette époque, Ies pouvoirs publics, i! avait Ia mission d’ éd.icter lui-même Ies mesures indis pensables pour I’ exécution des services publics placés sous cc son autorité )l. Et Ie Conseil d’Etat d’estimer qu’en prescrivant que I’appIication de l’ article 65 serait suspendue provisoirement pendant Ia durée de Ia guerre, avec facuIté cc pour les intéressés de se pourvoir, après Ia cessation des hostilités, en révision des décisions qui auraient été ainsi prises à Ieur égard, Ie Président de la République n’a fait cc qu’user Iégalement des pouvoirs qu’il tient de I’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février r875 )l. Si, quoi qu’en dise le ConseIL d’Etat, on ne peut guère admettre qu’en l’espèce L’usage fait par Ie gouvernement de ses pouvoirs était à proprement parIer légal, Ia Ioi constitutionnelle étant en réalité hors de cause, il faut reconnaître qu’indépendamment de tout argument de texte, la mesure pri.se par le gouvernement était parfaitement régulière en droit parce que dictée en vue de l’obtention d’un but parfaitement.
– Cette remarque nous ramène aux développements de la première partie de notre étude par lesquels nous tentons de démontrer qu’en matière administrative, l’important n’est pas tant, polir apprécier la valeur d’une mesure prise, de rechercher si elle est, en tous points, régulière eu égard !lux prescriptions légales, que de savoir si, étant donnés les principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement des services publics et les nécessités de la sauvegarde des intérêts généraux rlu public, elle a été déterminée par un but régulier de service, les considérations tirées du principe de légalité, dont nous nous défendons d’ailleurs de contester la valeur certaine et la vertu stabilisatrice du droit, devant, dans certains cas, exceptionnels il est vrai, céder le pas aux exigences supérieures d’une bonne administration. Ces idées se retrouvent, en dernière analyse, à la base de l’arrêt Couitéas, que nous avons déjà eu l’occasion de citer à plusieurs reprises (I). Rappelons que, dans cette affaire, le juge avait à se prononcer sur la régularité du refus, opposé par le gouvernement, d’exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée dans un pays de protectorat. Si ce refus était intervenu dans des circonstances normales, le Conseil d’Etat n’aurait certainement pas manqué de le qualifier d’illégal, l’administration n’étant pas libre de ne pas faire exécuter un jugement régulièrement rendu lorsqu’elle en est requise. Dans sa note publiée sous cet arrêt au Recueil Sirey (2), M. Hauriou remarque très justement qu’avant la guerre, le Conseil d’Etat n’aurait peut-être pas résolu la question de la façon dont il l’a résolue en I923. Si, dit-il,le litige avait été tranché en février 1914, avant la guerre, il est probable que la décision du Conseil d’Etat eU! été autre ; sans doute, l’indemnité eut été accordée, mais parce qu’une faute eût été reconnue à la charge de l’administration du fait d’ avoir refusé pendant plusieurs années de suíte de prêter main-forte à L’exécution d’un jugement. Le fait est que, si des considérations d’opportunité peuvent justifier l’administration, lorsqu’elle diffère d’accomplir une obligation de ce genre pendant un court {{ espace de temps,cette excuse disparaît, lorsque tout loisir cc lui a été laissé de choisir son moment et de réunir les (C moyens d’action nécessaires ; o on peut même faire obser- (C ver que, si Ie gouvernement français ne croyait pas pour- (C voir assurer l’ exécution des jugements des tribunaux (C français en Tunisie, il n’avait qu’à ne pas y organiser des tribunaux français. Nous croyons que, même en I923, on est parfaitement compris et admis La théorie d’une cc faute de l’Etat dans ces conditions )l. Voilà, certes, l’aspect légal du problème. Mais Ies questions soulevées par la guerre ont fourni au Conseil d’Etat l’occasion de réfléchir sur les exigences d’une bonne administration qui impliquent, pour l’autorité administrative, responsable du maintien de l’ ordre public, une large indépendance à l’égard de la loi. Les circonstances de I ‘affaire Couitéas présentaient un caractère tellement exceptionnel que le juge s’est vu amené à disculper l’administration de tout reproche et à reconnaître la régularité de l’attitude que ]le ,gouvernement avait observée, le but poursuivi par ce dernier ayant d’ailleurs été absolument conforme aux règles de la moralité administrative. cc Si le gouvernement, dit M. Rivet, s’est refusé à mettre (C en mouvement la force publique pour assurer l’ exécution du jugement rendu au profit du sieur Couitéas, c’est, dit-il, parce qu’une résistance très sérieuse était à crain- (C dre qui elle pu exiger une expédition véritable et avoir des répercussions dangereuses sur la situation de notre c: protectorat. C’est bien là le moyen de défense tiré des nécessités vitales du pays ». Dans ces conditions, M. Rivet propose aux juges de déclarer légale la décision intervenue.