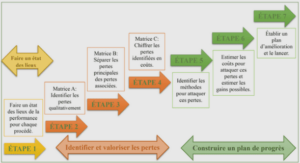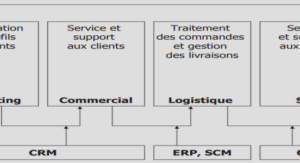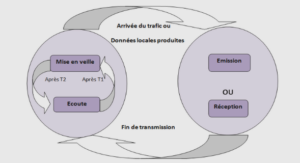Le standard dans la hiérarchie des normes
L’approche juridique dominante est caractérisée parune réflexion sur le statut de la norme technique dans l’arsenal du droit positif. Si pendant longtemps, les normes techniques se sont développées parallèlement au droit, pour devenir progressivement une source du droit, leur multiplication, ces dernières années, conduitcertains juristes à se demander si l’on n’assiste pas à un envahissement du « droit » par l a « norme »54. Au cœur de cette interrogation réside la question de l’origine des normes et de leur légitimité à organiser la vie des citoyens, notamment sur les plans sanitaire, sécuritaire et environnemental. Le problème principal soulevé par les normes techniques du point de vue juridique est qu’elles sont souvent produites par un petit nombre d’acteurs privés ou semi privés qui ne peuvent légitimement décider au nom de l’intérêt générale .problèmeL se pose de la même manière, quoique dans une moindre ampleur, au sein d’un secteur d’activité considéré. Une norme peut avoir pour effet de retirer du marché certainsproduits au « risque d’assurer le diktat de quelques grandes sociétés industrielles » . Tel était le cas de l’application la directive
Agence nationale la recherche
Action Concertée Incitative: Normes, Pratiques et Régulations des politiques publiques européenne sur le lait cru , qui risquait non seulement de faire disparaître des produits du patrimoine alimentaire mais tout aussi sûrement les petits producteurs. Le risque ainsi perçu ne concerne pas seulement les citoyens et les acteurs économiques courant le risque d’être exclus d’un marché, mais bien le droit lui-même, qui en s’appuyant sur des sources « lobbystiques », serait menacé de perdre et son objectivité et sa légitimité.
Les travaux sur les groupes d’intérêt ou les politiques publiques ont évidemment établi depuis bien longtemps que nombre d’acteurs, sans être des représentants du peuple ou des agents de l’Etat, élaborent et déploient des formesd’action publique, dont la standardisation peut apparaître à première vue comme une forme dépolitisée . Bourdieu expliquait quant à lui que les Etats modernes occidentaux sont détenteurs de cet espèce de méta-capital donnant pouvoir sur tous les autres, et que le capital juridique en est une forme objectivée et codifiée. Selon ce type d’analyse, le travail de normalisation doit nécessairement, à un moment ou un autre, s’appuyer sur l’autorité étatique (ou plus précisément sur ce capital symbolique dont parle Bourdieu) pour s’imposer à to us59. La diffusion des normes techniques s’appuie évidemment, d’une manière ou d’une autre, sur le relais des Etats (par la répression des fraudes, la certification, le soutien des promoteurs au sein d’organisations internationales ou supranationales, etc.). De mêmeque, comme le disait Durkheim, « tout n’est pas contractuel dans le contrat »60, tout n’est pas strictement conventionnel dans la normalisation technique.
Parce qu’ils en sont peut-être plus conscients queles juristes, les sociologues et les politistes sont donc moins inquiets des évolutions normativesen cours. Se départissent-ils pour autant si facilement d’un mode de raisonnement consistant à analyser la production normative à partir de ses modes de stipulation, plutôt que par leurs modalités empiriques de construction ? Dans l’ouvrage A World of Standards61, les chercheurs du SCORE proposent une typologie des normes distinguant le standard, la norm et la directive. Si on met de côté la norm qui, dans les sciences sociales anglo-saxonnes, désigne plutôt des communautés de valeurs d’origine diffuse (ce que nous appellerions mœurs ou normes communautaires ou traditionnelles), on retrouve dans la caractérisation de la directive et du standard l’exacte mise en forme de l’opposition des juristes sur l’or igine de la norme technique et son caractère volontaire. Alors que la directive d’inspiration publique à valeur d’obligation et s’impose aux acteurs concernés, le standard, produit par la société civile,est volontaire et n’a pas force d’obligation. Le standard aurait cet avantage par rapport à la directive qu’il laisserait l’acteur libre d’entrer ou non dans l’es pace de régulation qu’il définit. Il en tirerait une part substantielle de sa légitimité, puisque l’acteur serait à tout moment libre d’accepter ou de refuser le standard, selon un modèle philosophique contractualiste qui permet d’entretenir l’opposition entre régulation étatiqueet régulation privée.
On peut opposer au moins trois critiques majeures à cette typologie. Premièrement, la force d’obligation d’une règle, que ce soit un standard ou une directive, ne peut se fonder uniquement sur le degré de contrainte prévu par lesproducteurs, contrairement à ce que continuent de croire les tenants du positivisme juridique. Le droit international est émaillé de dispositions qui n’ont jamais été respectées oude normes enfreintes chaque jour. Si les textes sur les drogues sont aussi bien respectés, cela n’est pas attribuable à la valeur juridique de leurs dispositions, mais, à la structu re politico-économique particulière de l’offre licite des drogues 62. De même, le fait que la plupart des standards soient des règles soumises à l’acceptation volontaire ne signifie pas qu’elles soient, a priori, faiblement contraignantes. L’acceptation volontaire n’est pas synonyme de libre arbitre, ni forcément d’une adhésion rationnelle, établie sur la base d’un calcul coût/bénéfice. Les raisons qui poussent des acteurs à adopter une norme relèvent parfois du simple réflexe de « faire comme tout le monde » ou encore de la conviction que la norme adoptée est effectivement une garantie d’amélioration, mais plus sûrement de la nécessité économique de « se mettre à la norme », soit pour suivre l’évolution, soit pour bénéficier d’un instrument de légitimation dans la redéfinition d’une stratégie d’entreprise . Deuxièmement, l’absence de contrainte objective de type juridique, n’implique pas, comme nous l’avons souligné précédemment, l’absence de toute contrainte, notamment de nature hiérarchique. Il suffira d’évoquer les demandes faites par les entreprises à leurs fournis seurs pour être en conformité avec telle ou telle norme pour comprendre que la contrainte n’a pas besoin d’être juridique pour se déployer dans toute son ampleur. Des rapports de domination informelle peuvent amplement suffire, tout spécialement quand ils sont de nature économique. L’économiste comme en témoignent les interrogations des juristes: les deux tendent à s’interpénétrer fréquemment et à s’appeler mutuellement, notamment quand le standard devient source de droit, voir s’immisce dans les flous et les lacunes du droit positif. L’un des exemples les plus manifestes est certainement celui des nouvelles règles de comptabilité (IFRS) que les entreprises doivent adopter en 2005 selon le règlement européen (CE) n°1606/2002. Ces règles qui ont valeur d’obligation sont la reprise assumée comme telle des standards proposés parl’International Accounting Standards Board (IASB)65. En ce cas, la distinction entre standard et directive n’est absolument pas opérationnelle pour détermine la nature de la spécification. Inversement le travail de standardisation peut venir en aval d’un dispositif juridique. On peut citer à cet égard l’harmonisation des pratiques en matière de contrôle des drogues sur le plan national. L’efficacité des conventions internationales sur les drogues reposent, en effet, en grande partie sur des savoirs faire pratiques homogénéisés (nomenclatures statistiques, pureté des produits, organisation administrative de contrôle) qui ont été diffusés en dehors de toutes contraintes ridiquesju et qui relèvent de ce fait de la définition du standard que proposentA World of Standard. Envisager les normes d’après leur source (autoritépublique ou arène privée ou semi-privée), leur force de contrainte juridique, ou encore le caractère volontaire ou non de leur adoption relève plus d’une distinction idéologique que d’un examen sérieux des raisons pour lesquelles une norme est adoptée, diffusée et miseen œuvre. Ontologiquement, il est difficile de penser un fait institutionnel quel qu’il soit exclusivement à partir d’une stipulation ; il faut aussi comprendre le processus social par lequel il se construit. L’approche en terme de hiérarchie des normes ou de cohérence du droit pose des questions intéressantes sur le statut de la norme technique au regard des sources légitimes du droit et du fonctionnement démocratique, mais ne nous en apprend guère sur les processus de normalisation et les raisons de leur essor.
Les enjeux de la régulation
De nombreux travaux de science politique étudient depuis une dizaine d’années les évolutions de la régulation des industries de services. Nul ne peut contester que les dynamiques de libéralisation du marché aient été aucœur d’importantes reconfigurations institutionnelles. A la suite de Vogel , Jordana et Levi-Faur ont ainsi montré que la diffusion du modèle de régulation concurrentielle des marchés par des agences indépendantes s’est intensifiée dans les économiesavancées au cours des quarante dernières ème la première moitié du 20 siècle (notamment pour la répartition des fréquences radio) a en effet connu une extension croissante de ses domaines d’application (sécurité alimentaire, médicaments, transports, énergie, marchés financiers, etc.). Les nouvelles théories de la gouvernance comme les théories de l’agence justifient souvent théoriquement cette solution institutionnelle, autour de l’idée d’une relation principal-agent produisant un dynamisme des agents économiques par des mécanismes compétitifs ansd la définition des contrats et incitatifs dans la pérennisation de l’accès aux resources publiques68. Le phénomène de diffusion de ce modèle de régulation du marché a étanalysé comme l’un des piliers de ce que l’on a appelé le nouveau management public, au point que toute une littérature spécialisée s’y attache aujourd’hui. Celle-ci tend parfois à généraliser les propositions théoriques, sans tenir compte des spécificités dea lproduction dans certains secteurs.