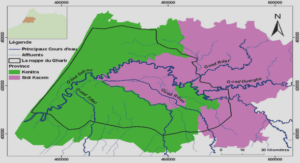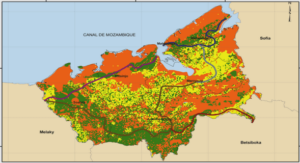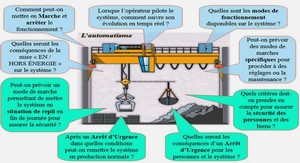La société d’aujourd’hui
Un système capitaliste mondialisé basé sur le pétrole
À l’heure actuelle, nous sommes plongés au sein d’une société globalisée dans laquelle l’argent, le profit, la consommation ou encore la vitesse sont des maîtres mots. Une société basée sur le matériel et l’ « avoir » et où la publicité joue un rôle non négligeable. Posséder est devenu, pour beaucoup synonyme de bien-être (ou de bienêtre relatif). Or, tout ce mode de vie ne fonctionne principalement qu’à travers les énergies pétrolières. Il faut du pétrole et, de préférence, du pétrole pas cher pour le transport et la fabrication d’une grande majorité des objets qui nous entourent : aspirine, colle, isolation, sacs, vestes, plastiques ou encore contenant de jus de fruits n’en sont que quelques exemples.
Cette société de la consommation n’est pas nouvelle. En effet, tout a commencé avec la révolution industrielle. C’est à partir de ce moment-là qu’on est passé du monde de l’agriculture à celui de l’industrie. Ce changement s’est généralisé au fil des décennies et a naturellement influencé nos modes de vie. De petits producteurs locaux et d’artisans, on est passé à un système de production en masse grâce à la machine et au travail à la chaîne. Le savoir-faire et penser des artisans s’est perdu petit à petit en créant un travail déshumanisant et rares sont ceux qui pouvaient encore trouver une satisfaction envers leur propre travail. Ce phénomène a d’ailleurs été mis en lumière dans le célèbre film de Chaplin, Les temps modernes, en 1936.
Au 20e siècle et après les guerres 14-18 et 40-45, la société de consommation a évolué. En effet, au fil des années, les usines ont fermé, et, dans les années 60, on est progressivement passé du monde industriel au monde tertiaire, celui des services. Par la suite, la politique du « tout à la voiture » a été privilégiée. Le moteur individuel remplaçant les systèmes collectifs en place (ex : trams, tramways de l’Expo universelle de Liège en 1905 dans le quartier des Vennes).
Aujourd’hui, nous sommes dans la continuité de l’époque d’après-guerre. Les anciennes usines ont laissé place à de grandes friches industrielles et si elles ne sont pas déconstruites, elles sont régulièrement occupées par les grandes chaînes de magasins actuels. Les usines locales sont de plus en plus rares. La délocalisation vers d’autres pays où la main d’œuvre est moins chère semble être devenue une règle. Nous ne produisons presque plus rien de ce dont nous avons besoin tous les jours. Nous sommes devenus complètement dépendants des productions mondiales et donc des différents moyens de transport qui livrent chaque jour nos différents magasins favoris. Ces délocalisations profitent naturellement aux grands patrons qui s’enrichissent mais sont la cause de nombreuses inégalités, de pertes de travail et de savoir-faire, de gaspillage…
Une autre différence marquante entre en jeu. En effet, à l’époque, seule la société occidentale était marquée par le monde de la consommation. Aujourd’hui, les peuples africains et asiatiques sont attirés par le mythe de notre société comme nous avions, nous, été attirés par le mode de vie américain après la Seconde Guerre mondiale. Ils veulent donc vivre « comme en Occident ». Or, nous sommes aujourd’hui près de 8 milliards de personnes sur Terre et elle possède ses limites. Ainsi, « le jour de dépassement » comme l’appelle l’ONG Global Footprint Network en partenariat avec la WWF (Fonds mondial pour la nature) tombe chaque année de plus en plus tôt (en 2018, ce jour tombait le 1er août). Ce jour symbolise en fait la date à partir de laquelle l’homme est en dette par rapport à la nature. Il a « pêché plus de poissons, abattu plus d’arbres et récolté plus que ce que la nature peut nous fournir en une année. » Il a « émis plus de carbone que ce que les océans et les forêts sont en mesure d’absorber. » .
Nous vivons aussi dans un monde où des experts de tous horizons, tout comme différents mouvements citoyens, s’accordent pour dire que nous ne pouvons pas continuer à vivre comme aujourd’hui. Ils prennent conscience des absurdités du système mondial. Est-ce normal d’importer des pommes de Grande-Bretagne et d’en exporter en même quantité? Est-ce normal de confectionner un produit dans un endroit, le faire emballer dans un autre puis de l’exporter dans le monde entier et tout ça pour avoir un maximum de bénéfices ?
Cette façon de faire, ce monde globalisé va de pair avec une immense consommation d’énergie. Nos habitudes sont dès lors, en quelque sorte, responsables du changement climatique.
Ces changements climatiques sont aujourd’hui, enfin, pris au sérieux mais il aura fallu beaucoup de temps. Le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement : « il a pour mission de rendre compte de l’état des connaissances scientifiques relatives à l’évolution du climat mondial, ses impacts, et les moyens de l’atténuer » .
Quant aux COP (conférence des parties), la première a eu lieu en 1995 à Berlin suite au « sommet de la Terre de Rio » en 1992 où plus de 178 pays se sont rencontrés pour la conférence décennale de l’ONU sur l’environnement et le développement. C’est là que la déclaration de Rio de Janeiro donne pour la première fois une définition du développement durable et qu’on fixe une convention sur le climat qui appuie la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de minimiser l’impact humain sur le changement climatique. Ainsi, chaque année, les pays se retrouvent pour trouver des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique. La dernière COP, La COP 24 a eu lieu en décembre 2018 en Pologne à Katowice. La création de ces deux organismes est donc très récente par rapport aux nombreuses années où on a produit et pollué sans vraiment s’en rendre compte.
L’intérêt pour le climat n’est pas présent qu’au niveau global ou d’ailleurs les accords entre pays sont difficiles à obtenir et à respecter. Cela touche aussi, de plus en plus, un grand nombre de citoyens. Ainsi, les films comme « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, les marches pour le climat, des documentaires comme « La planète est-elle vraiment foutue ? » de David Mutaner reflètent tout l’intérêt et les questions portées sur le climat et le futur de notre planète.
La difficulté des personnes à se poser des questions et à adapter leur comportement réside dans le fait que tant qu’on n’est pas touché personnellement, on a souvent du mal à mesurer les conséquences de nos habitudes journalières. Les feux de forêt, les inondations, les tremblements de terre, etc., qui surviennent dans les pays étrangers, semblent éloignés de notre vie en Belgique. Un exemple simple mais pourtant très proche de nous permet d’illustrer ce propos : lors des inondations à Tilff en 2016, la population interviewée nous expliquait lors d’un travail sur la ville que l’entraide et la collectivité avait pris le pas sur les individualités. Tous les gens étaient logés à la même enseigne et étaient forcés de trouver des solutions ensemble. Il faut donc dans beaucoup de cas, le voir, le vivre, pour y croire. Un exercice simple est peut-être à faire pour mieux se rendre compte de la société dans laquelle on vit et des impacts que cela peut provoquer. Il suffit, sur une journée, de nous interroger sur nos comportements journaliers. D’où vient mon café, ma nourriture? D’où viennent mes habits et comment sont-ils confectionnés ? Comment fonctionne mon frigo, ma voiture ? Grâce à quoi ?
Ce monde décrit en quelques lignes est le monde d’aujourd’hui mais également celui de demain, celui dans lequel l’architecte devra concevoir ses projets mais surtout celui où la vie humaine s’épanouira. Or, comme on vient de le voir, c’est aussi le monde de la controverse et des exagérations. C’est dans ces circonstances qu’est née la discipline de la collapsologie et qu’est pensée une société de la transition. Nous allons examiner ces différents « concepts » dans la suite de ce travail en abordant, entre autres, des auteurs comme Philippe Bihouix, Rob Hopkins, Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Cela nous permettra de voir dans quel contexte et avec quoi l’architecte de demain sera amené à travailler.
La collapsologie ou « comment tout peut s’effondrer »
La collapsologie (du latin collapsus, tomber d’un bloc, s’écrouler, s’affaisser) est la science appliquée et transdisciplinaire s’occupant de l’effondrement. Comme nous le disent Servigne et Stevens :
« Il ne s’agit pas de la fin du monde, ni de l’apocalypse. Il ne s’agit pas non plus d’une simple crise dont on sort indemne, ni d’une catastrophe ponctuelle que l’on oublie après quelques mois, comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est « le processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un coût raisonnable] à une majorité de la population par des services encadrés par la loi » » . Tous les êtres vivants sont donc potentiellement concernés. L’étude sur l’effondrement part d’une analyse globale du monde, le décortique et s’interroge sur son avenir, sur notre avenir. Pourquoi parler d’effondrement ? Tout simplement parce que si l’on continue comme aujourd’hui « on va droit dans le mur ».
Les scientifiques nomment la nouvelle époque géologique dans laquelle on est entré l’Anthropocène. Ils la caractérisent comme étant « une époque où les humains sont devenus une force qui bouleverse les grands cycles biochimiques du système terre » . On est de plus en plus nombreux sur Terre, on consomme toujours plus d’eau, de ressources en tout genre, on pollue et on déforeste toujours plus.
Introduction |