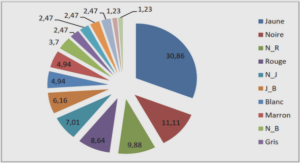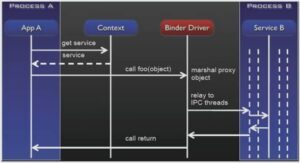La rivalité entre le théâtre et les Églises en France et en Angleterre
LA RIVALITE AU XVIE SIECLE
Les rivaux s’opposent lors d’affrontements spectaculaires, alimentés par des tensions plus discrètes mais tenaces. On connait bien ces conflits ponctuels marqués par des écrits emblématiques. Les querelles anglaises ont également fait l’objet d’études ciblées, notamment concernant les puritains1 et les enjeux de l’idolâtrie2 . Dans ces quatre premiers chapitres, je propose une histoire synthétique des polémiques théâtrales en France et en Angleterre, du milieu du XVIe jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Je m’attache à déterminer dans ce chapitre la singularité des querelles, en identifiant leurs caractéristiques. Les divers conflits qui émaillent les XVIe et XVIIe siècles répondent à des contextes historiques spécifiques, et accompagnent l’évolution de la pratique dramatique. Il s’agit à la fois d’identifier les auteurs des polémiques, et de mesurer leur façon d’appréhender l’objet « théâtre ». Sous couvert d’une relation conflictuelle gouvernée par le sentiment de rivalité, se cache de multiples rivalités spécifiques entre des formes scéniques et diverses institutions religieuses. La France connaît des querelles plus précoces qu’on ne l’a longtemps pensé, mais de façon encore ponctuelle3 . De plus, la rivalité avec les Églises reste encore marginale, ne s’exprimant qu’au détour d’une phrase ou d’un chapitre. À l’inverse, les premiers sentiments de rivalité apparaissent en Angleterre avec l’implantation de salles spécifiquement dédiées au théâtre : l’enjeu social est prédominant dans les querelles anglaises, où l’on ne convoque les arguments d’ordre religieux que dans un second temps, pour relancer la dynamique polémique. Plus généralement, les conflits anglais ont une intensité plus forte et plus précoce qu’en France, où la rivalité est encore faiblement exprimée. Cela dit, la polémique couvait depuis de nombreuses décennies, voire depuis le Moyen Âge1 ; et en 1541, éclate une affaire à Paris qui a pour particularité de poser d’ores et déjà les enjeux déterminants des polémiques à venir. L’un des premiers textes du XVIe siècle relatifs aux controverses sur le théâtre, apparaît de façon très ponctuelle, sans s’inscrire dans une dynamique polémique particulière ni être suivi d’autres traités ou libelles similaires. Malgré son caractère exceptionnel, il fait état de la plupart des arguments antithéâtraux avant même que les grandes querelles n’éclatent. Il s’agit d’une retranscription juridique du procès qui s’est tenu en décembre 1541 à Paris, au sujet des récentes représentations du Mystère des Actes des Apôtres2 . À l’origine du scandale, les confrères de la Passion : des bourgeois constitués en société de dévotion, qui se sont réunis en groupe économique pour monter cet onéreux spectacle. Face à eux, le représentant du pouvoir royal et les parlementaires leur intentent un procès, pour des motifs qui ont la particularité de concentrer presque l’essentiel de la logique théâtrophobe à l’œuvre dans le siècle suivant. On peut recenser cinq types de reproches3 : moraux, religieux, économiques, sociaux et politiques. L’argument moral consiste à faire du théâtre un lieu de débauche qui engendre un relâchement des mœurs : le public qui en revient inonde les rues de ses plaisanteries bruyantes, se moquant autant du spectacle que du Saint Esprit, commettant même « adultères et fornications infinies4 », à cause de ces représentations qui s’étendent sur plusieurs mois et invitent à l’oisiveté. Le procureur brandit également l’argument religieux du blasphème, accusant les confrères d’avoir profané l’histoire sainte en y ajoutant des récits « apocryphes » et des farces. Ces gens qui ne sont pas formés pour transmettre la doctrine religieuse, finissent par enseigner des erreurs et dévoyer la mission catéchétique du mystère. Leur manipulation irresponsable du texte biblique pourrait ainsi pousser le public ignare à « judaïser », c’est-à-dire qu’ils encourageraient l’hérésie et le protestantisme. Sans compter qu’ils se permettent de jouer durant les heures dévolues au prêche, empiétant ainsi sur le temps sacré1 . La confrérie trahit donc sa mission de dévotion en devenant une activité économique rentable tenue par des commerçants avisés. Le théâtre est en passe de basculer d’une pratique religieuse vers une opération commerciale mue par le seul appât du gain. Il en résulte un refroidissement des charités et des aumônes, et un enrichissement indécent de la confrérie, accusée de gonfler les prix d’entrée, et d’inciter à des dépenses annexes considérables, menant à la ruine des familles. Les conséquences sociales se font jour dans un Paris chaotique, où le peuple s’enivre et se bat, menant à des assignations en justice. Le public déserte aussi la messe et la prédication, prouvant la concurrence déloyale du théâtre avec la prédication. Le théâtre corrompt même toute la hiérarchie catholique, puisque les clercs de la Sainte Chapelle décalent les vêpres pour se rendre au spectacle. Le procureur accuse enfin les confrères de se prévaloir à tort d’un accord du roi, révélant ainsi les tensions politiques à l’œuvre dans cette affaire, où les positions royales s’opposent aux décisions parlementaires. Ce procès témoigne d’une crise de la définition du théâtre, dont le statut est encore ambigu, et où sa mission auparavant dévotionnelle devient économique. Mais il révèle également les positions de l’Église, bien qu’elle n’y apparaisse qu’indirectement par la référence aux sermons et aux chapelains. Elle semble dans une phase de transition, en ce qui concerne la catéchèse, les querelles religieuses et les liens entre l’économie et le culte. En effet, dans ce procès, le mystère n’est plus considéré comme un outil de transmission populaire du savoir religieux, et les confrères sont même dénoncés comme faisant le jeu du protestantisme. Accuser les acteurs du mystère de « judaïser » le peuple, c’est en effet retourner l’argument protestant qui voit dans l’image et le théâtre une arme proprement catholique.
Les débuts de la rivalité en France
Après l’affaire du Parlement de Paris, le XVIe siècle voit peu de publications de polémiques contre le théâtre. Il faut attendre plus de trente ans pour qu’un texte attaque la comédie. Jean Bodin est le premier auteur à faire mention en 1576 des « joueur », des « comiques » et « jongleurs », dans ses Six livres de la Republique. Il s’ensuit une petite série de traités dénonçant les effets délétères du théâtre. En 1578, le minime Pierre Nodé publie la Déclamation contre l’erreur excécrable des maléficiers, dans laquelle il blâme autant les astrologues que les « basteleurs aussi, et mommeurs ou farceurs ». Un an plus tard, un avocat du Mans, Pierre Massé, rédige De l’Imposture et tromperie des diables, où il s’en prend plus spécifiquement à deux types d’artistes : les « bouffons » et les « mathassins4 ». Toujours en 1579, René Benoist, prêtre de l’église Saint-Eustache à Paris surnommé le « pape des Halles5 », publie quant à lui un Petit fragment catéchistic où il cible plus précisément les « jeux de théâtres et les danses » comme une science diabolique, et s’y réfère comme des « jeux de récréation mondaine1 ». Après cette petite vague éditoriale, concentrée sur quelques années seulement, aucun autre texte ne prend le théâtre pour sujet, jusqu’en 1588, ou un certain Rolland du Plessis adresse ses Remontrances au roi Henri III, et accuse les spectacles de créer le chaos dans Paris. Ces auteurs accordent en outre une place assez mince à la comédie, qu’ils mettent en cause au sein d’une argumentation plus vaste. Le théâtre n’est qu’un signe parmi d’autres de la corruption du monde. Ce n’est par exemple qu’au détour d’un chapitre que le démonologue Pierre Nodé en fait mention, s’inquiétant d’abord de ces « Maleficiers, sorciers, enchanteurs, Magiciens, devins, & semblables observateurs des superstitions » qui « pullulent maintenant couvertement en France ». Il fait référence aux « bateleurs » comme faisant partie d’autres perturbateurs sociaux, et semble en réalité plus préoccupé par les poètes que par les acteurs ou les dramaturges : selon lui, la poésie est l’un des trois fléaux du monde, avec la philosophie païenne et la magie . La mention des acteurs apparaît comme une exception, en rappel d’une anecdote sur Constantin qui les aurait chassés en même temps que les « Astrologiens ». Le poète dramatique n’existe pas encore en tant que tel ; il est pour le moment un simple « polygraphe pratiquant l’écriture dramatique parmi d’autres genres d’écriture3 », englobé dans la catégorie générique de « poète ». La pratique théâtrale est quant à elle noyée dans d’autres pratiques plus dangereuses, mais qui lui sont assez étrangères, comme l’astrologie. Jean Bodin la mentionne également en passant. Le sixième livre de sa République s’ouvre sur un premier chapitre dévolu à la censure, dans lequel le juriste et philosophe s’interroge sur la meilleure façon d’encadrer la population, et plus particulièrement la jeunesse. Il propose de mettre en place une censure, c’est-à-dire un contrôle et un recensement au sein du Royaume, pour qu’une république puisse y fonctionner correctement. Selon lui, la censure peut remédier aux vices les plus fréquents, comme « le parjure, les ivrogneries, les jeux de hasard, les paillardises et lubricités », car les républiques sont remplies de « vagabonds, de fainéants, de rufiens, qui corrompent et de fait, et d’exemple tous les bons sujets »
Introduction |