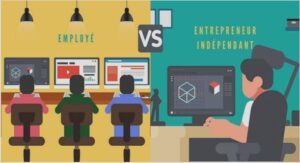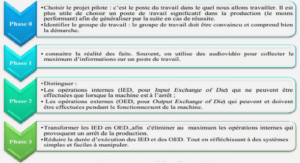La religion naturelle, une religion statique.
La religion statique s’inscrit dans le même registr que la morale close. Elle attache l’individu à lui-même, l’individu à l’espèce et l’i ndividu à la vie. Elle est « coextensive à notre espèce, doit tenir à notre structure »22 ; cela veut dire qu’elle plonge ses racines dans la société ; autrement dit, la religion est d’origine sociale. Cependant, BERGSON porte un regard critique sur les différentes religions et constate que les spécialistes ont frôlé le problème de son origine. Ils considèrent comme origine soit le « mana » des Mélanésiens, soit une âme transcendant l’espèce humaine. L’avènement de la religion n’est pas accidentel mais il montre l’effort constant de l’individu, devant l a nature de plus en plus imprévisible et indomptable, de donner un sens à son acte. Pour l’a uteur, l’origine des religions réside dans le dépassement et la maîtrise de la nature. Autrement dit, l’individu sent le besoin de réussir avec succès son acte, invoque, mime dans ses gestes la nature et s’accapare de ses pouvoirs 23.
L’adjectif statique désigne ce qui est fixé dans letemps et dans l’espace ; la religion ainsi entendue se définit comme la constance et l’immuabilité des pratiques. Autrement dit, la religion dite statique est invariable et inchangeable; elle tourne autour de la cohésion sociale. En ce sens, la religion statique est l’aptitude à a ttacher l’individu à la société et à la vie. BERGSON adjoint à l’intelligence discursive la fonc tion fabulatrice. Cette dernière porte les mêmes traits et les mêmes fonctions que l’intelligence-régulatrice. Il la définit comme : « convenons alors de mettre à part les représentations fantasmatiques, et appelons « fabulation » ou « fiction » l’acte qui les fait surgir »24. Dans ce sens, la fabulation se fonde sur l’imagination, sur la représentation maginaire des choses apparemment qui n’existent pas. Elle s’exprime dans les contes et l es légendes ; la religion se distingue dans son attitude à raconter « des histoires comparables à celles dont on berce les enfants »25. Autrement dit, l’homme, pour expliquer la création de l’univers, s’appuie sur des récits mythiques. On peut dire que la fabulation joue un rôle capital dans la socialisation de l’individu. En effet, tout comme l’intelligence, la fabulation circonscrit l’individu dans la société. L’intelligence fabrique des outils utilesà l’espèce qui lie cette dernière à la vie ; de même, la fabulation monte pièce par pièce des histoires. Ces histoires calment l’inquiétude grandissante de l’individu et assurent une harmonie illusoire. Ces deux antagonistes favorisent l’équilibre de la religion. A cela s’ajoute que ces antagonistes ont en commun un point de jonction : la représentation. Dans l’idée de représentation, il y a l’idée de projection en image d’une chose ; c’est-à-dire que la représentation donne chair à quelque chose qui n’existe pas pour faire valoir une existence effective. La religion statique se fonde sur des représentations. Selon BERGSON, les plus anciennes représentations sont les elfes, les gnomes et les esprits ; ils occupent des lieux, voire la nature. Leurs présences régissent la conduite du groupe. Elles forment une religion, dite populaire. Cette dernière est abstraite et incomplète. L’évolution de la société primitive permet de constater le glissement de la religion populaire à la mythologie. En effet, la mythologie, loin d’abandonner les anciennes représentations, les prennent et les rehaussent à un niveau plus concret. Ces anciennes représentations deviennent une personne, ont une histoire et une existence effective dans la société : « Tous ces dieux sont attachés à des choses. Mais il en est- souvent ce sont les mêmes, envisagés d’un autre point de vue- qui se éfinissentd par leurs relations avec des personnes ou des groupes…Toutefois, c’est pour notre commodité que nous définissons et classons ainsi les dieux de la fable. Aucune loi n’a présidé à leur naissance, non plus qu’à leur développement ; l’humanité a laissé ici libre jeu à son instinct de fabulation…on pourrait alors trai ter un récit mythologique comme un récit historique et se poser dans un cas comme dans l’autre la question d’authenticité » .
La mythologie laisse voir dans un côté la cohabitation et les rapports mutuels entre les dieux et les hommes. C’est un pur anthropomorphisme dans la mesure où ces dieux ont les mêmes caractéristiques, les mêmes traits et les mêmes fonctions que les hommes. D’un côté, la mythologie s’inscrit dans la lignée de la fabulation, de raconter des histoires. En fait, la fonction fabulatrice est fondamentalement dans la mythologie. Bergson souligne ici le fondement et l’essence de l’apparaître de la mythol ogie. Son clin d’œil critique dévoile le vrai visage de la mythologie qui est la représentation spatiale des dieux et cohabitation dans la société des dieux et des hommes. Par là, il veut montrer que la fuite vers l’imaginaire et l’abstrait ne peuvent constituer une vraie religion . Cette attitude atténue l’importance et le rôle de la religion ; c’est une voie par lequel l’indivi du a la possibilité de se défaire de sa condition existentielle misérable pour parfaire son être. Delà, cette croyance est figée dans le temps et fixée dans l’espace. D’où la nécessité de l’auteurd’employer le terme de statique pour la désigner.
L’intérêt que BERGSON porte sur le totémisme dépasse le cadre ethnologique. Le philosophe va au-delà de l’idée que se fait l’ethnologue et montre que la relation du totem et de l’individu réside dans l’affirmation de l’identification. L’individu s’identifie au totem. Ce rapport est tel qu’ « on dirait que son individualité se dissout dans un genre»27. Madeleine BARTHELEMY-MADAULE pense que ce rapport est une tentative d’ « individualisation d’un être concret et son appartenance à un genre »28. Cela veut dire que l’individu cherche à se définir et à se situer dans un monde où la nature s’avère hostile à lui et un obstacle pour s’affirmer. Alors que cette identification de l’ind ividu au totem s’avère qu’elle tourne court dans la mesure où c’est dans un être contingent, unêtre symbolique représentatif de l’espace qu’il cherche son salut.
L’expérience mystique comme manifestation de la morale ouverte et de la religion dynamique.
L’évolution de la vie servait à BERGSON pour montrer le contraste qui existe entre l’individu et la vie. C’est un contraste d’attachem ent de l’individu à la vie. Dans la société close, l’agir de l’individu est réductible à l’espèce et par extension à la société. Cet auteur se voit d’abandonner ce vitalisme et trouve une humanité proche de la nature. Son dessin est de rendre compte ce qui l’advient. L’avènement de la société ouverte nécessite, de facto, une rupture, une coupure et un fracas avec l’évolution. Désormais, c’est dans et par une autre configuration que le philosophe se positionne pour mettre en lumière le sort de l’humanité ; c’est-à-dire, l’irruption fracassante des mystiques , des saints et des héros dans la civilisation humaine change la donne et instaure la marche en avant comme essence de l’homme.
La morale ouverte, une source d’aspiration.
BERGSON fait de l’intuition de la durée son fer de lance. Chaque problème qu’il traite est mis au crible par cette intuition. L’intuition de la durée échelonne la liberté, l’esprit et le corps, l’évolution et la mystique. Elle se transmet dans chaque problème. En effet, cet auteur aborde n’importe problème en philosophe ; cela veut dire qu’il ne tient autre chose comme valide que les faits et l’expérience. Dans Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, il met en exergue la morale et la religion. Dans cette investigation, il se résout aux faits et à l’expérience et en distingue deux sources de la morale et deux sources de la religion : la pression, l’aspiration, la fabulation et l’amour .
La morale close se distingue de son caractère fonctionnel : La pression. La pression détermine et façonne l’agir de l’individu. Les lois sociales aussi régissent son comportement. L’obéissance à des lois est le seul critère de validité de son acte. Sous le poids de cette pression, l’individu obéit. Tandis que sa sœur, la morale ouverte revêt un autre caractère diamétralement opposé à celui de la morale close :l’aspiration. Ce détour à la morale close ne prétend pas donner davantage une explication très xhaustive, mais nous tenons à montrer qu’elle est le premier jalon où l’individu, déchu, essaie de pérenniser la survie de l’espèce. La morale ouverte est en ce sens, la libération de l’individu du joug social et de la vie. BERGSON souligne la nécessité et l’importance de démembrer la morale close, elle laisse champ libre à l’intérieur, à la subjectivité ou à l a conscience de prendre le pas sur l’agir de l’individu. La morale ouverte est la manifestation de la vie intérieure de l’individu comme un acte. En fait, dans la conscience, il n’existe pas de lois, de pression et de spontanéité ; il y a une succession discontinue et de l’immédiat. L’individu obéit sans contrainte. Il agit librement au sens fort du terme. Mais pour cet auteur, pour rendre sa thèse plausible, il confère à la morale ouverte le pouvoir de traîner l’humanité, par le truchement d’une poignée d’individus à part et hors du commun des mortels, à des destinées dépassant l’intelligence humaine.
La morale ouverte n’est pas le fruit de la raison, quoi qu’elle y participe, dans l’obligation morale. Loin de là, BERGSON prend l’hi stoire comme témoin et source et met en lumière le surgissement des grands hommes et leur impact dans la société humaine. Il constate que leur manière d’agir ou de vivre bouleverse les mœurs et change la vie des gens. Pour lui, l’obligation morale doit inclure à la fois une prat ique et une théorie ; cette nouvelle formule redessine l’essence de la morale qu’est une action. Elle se base sur l’imitation. En ce sens, ces hommes sont des dépositaires de ce qu’il appelle la morale ouverte, complète et absolue. Il affirme : « De tout temps ont surgi des hommes exceptionnels en lesquels cette morale s’encornait. Ils ne demandent rien, et pourtant ils détiennent. Ils n’ont pas besoin d’exhorter ; ils n’ont qu’à exister ; leur e xistence est un appel. Car tel est bien le caractère de cette autre morale »29.
La morale ouverte se fonde par delà la société ; elle est au-delà de toute forme de pression. Bergson la caractérise comme un appel, une invitation. La morale ouverte devient une attraction au sens étymologique du terme. Ces grands hommes attirent les hommes de leur entourage dans leur sillage. Cet auteur les compare à des conquérants. En fait, ils ont brisé le cercle dont la vie les avait emprisonnés ; ils se constituent alors comme des modèles et des icônes. De là, ils deviennent un miroir où le reste du groupe essaie de copier leur mode de vie. Dans cette perspective, l’enjeu est de taille ; la conscience prime sur l’extérieur ; autrement dit, l’acte de l’individu dérive de ce qu’il perçoi t chez un grand homme privilégié. BERGSON souligne que l’obligation pure n’a pas de place dan s la morale ouverte ; il entreprend de dépouiller tout caractère coercitif et contraignant. Il ne reste que l’ossature ; autrement dit, la morale ouverte absorbe la morale close de telle sorte que cette dernière ne contraint pas, elle devient selon l’expression de cet auteur « un cas particulier»30. Gabriel MADINIER exprime avec clarté et pertinence sur le nouveau visage del’obligation, il la considère comme absolue. En ce sens, l’individu se sent impliqué dans la société. Il affirme : « Fonder l’obligation, c’est la considérer comme un absolu et reconnaître que je dois m’y soumettre humblement et totalement»31.
La morale ouverte s’inscrit dans un autre registre dépassant les cadres de la morale close ; elle est supra-sociale ou supra-rationnelle. Cela veut dire qu’elle se situe au-delà de l’intelligence et de la société. En effet, BERGSONdifférencie les deux morales, celle close et ouverte, dans le niveau d’intellectualisme ; la morale close fondée sur l’intelligence fabricatrice, circonscrit l’individu à l’espèce et à la vie ; tandis que la morale ouverte basée sur l’intuition de la durée, donne l’occasion à l’i ndividu de se mettre en marche et briser le cercle vicieux de la société. L’âme s’ouvre alors. Mais cet auteur montre que l’élément responsable de cette ouverture n’est rien d’autre q ue l’émotion. L’auteur, ingénieux dans cette approche, prend l’émotion au sens étymologique du ermet et lui confère le pouvoir de transcender l’être de l’homme. Autrement dit, cet affect, l’émotion, définie comme un mouvement, est le processus par lequel l’individu se transcende et essaie de saisir l’élan originel.