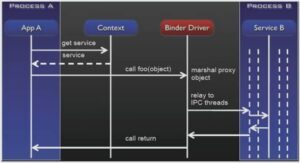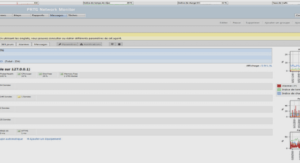La réception de l’avant-garde artistique dans la presse politique en France, de l’impressionnisme au fauvisme (1874-1905)
Art et politique dans la presse antirépublicaine
Les métaphores politiques
Francis Haskell évoque dans « L’art et le langage de la politique » la politisation générale de la vie à la suite de la Révolution française. Cette politisation touche particulièrement la vie artistique à travers la critique. Les historiens de la presse constatent, en effet, une dissémination du politique dans toute la surface du journal. Rappelant, dans sa contribution à La Civilisation du journal, l’omniprésence de la politique dans la presse du XIXème siècle, Thomas Bouchet cite l’ouvrage de Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant L’An I de l’ère médiatique : « le politique devient le paradigme de la représentation. Tout est politique : les débats législatifs, les débats judiciaires, les chroniques, les faits divers, la littérature, la publicité même » . Dès le deuxième quart du XIXème siècle les liens entre l’art et la politique sont rendus visibles à travers des métaphores politiques qui contaminent le discours sur l’art. Francis Haskell note les dangers de ces métaphores qui « se mettent bien souvent à vivre de leur vie propre, d’une vie qui se détache de plus en plus des sujets qu’à l’origine elles étaient destinées à éclairer » 115. Se développant souvent au préjudice de l’objet d’art et radicalisant sa réception, elles ne témoignent pas tant, selon Pierre Vaisse, de la politisation de la vie artistique elle-même que « de la façon dont elle a été perçue au cours du XIXème siècle » 116. Elles ont, selon lui, contribué à forger une vision manichéenne de « l’opposition absolue entre la bonne peinture, celle qui s’inscrit dans la voie royale de la modernité, et la mauvaise, officielle, académique ou bourgeoise » 117. L’étude de ces métaphores nécessite, afin d’être pertinente, l’analyse approfondie du contexte dans lequel elles se développent. Il est pour cela primordial de prendre en compte les organes de presse qui hébergent ces critiques ainsi que l’idéologie des mouvements politiques auxquels ces organes sont associés. Dépassant le statut de simples formules au service du scandale, elles deviennent le reflet d’un discours politique qui se développe au sein même de la critique d’art et est suscité par l’art lui-même. La lecture des comptes rendus de Salons contemporains des premières expositions du groupe impressionniste parus dans les organes de presse des groupes bonapartistes et légitimistes révèle de nombreuses métaphores politiques. Est ainsi constatée, au moment de la mise en place du régime parlementaire, une porosité, au sein de ces organes, entre vie politique et vie artistique. Le Salon est alors comparé à l’Assemblée nationale qui occupe tous les esprits entre 1874 et 1879. Le critique Albert Wolff assimile l’ouverture du Salon de 1874 à celle de la Chambre des députés pour le bonapartiste Gaulois : « L’Exposition de Paris ouvrira demain et celle de Versailles le 12 mai. Déjà messieurs les députés vernissent leurs discours ». Le critique d’art file la métaphore dans le premier paragraphe de son article en présentant les députés des différents mouvements politiques élus lors des élections du 8 février 1871 comme des artistes exposant leurs œuvres qui annoncent leurs attachements politiques : « une page énorme intitulée : les Questions institutionnelles, et signée : de Broglie ; un portrait en pied du comte de Chambord, par M. Lucien Brun ; une autre grande toile représentant les princes d’Orléans, par M. le comte d’Haussonville ; une statue équestre de Napoléon IV, par M. Gavini, et une douzaine de républiques de tous les calibres : à l’huile, en plâtre, et même en marbre, signées des artistes aimés qui ont nom : Adolphe Thiers (de l’Académie) ; Léon Gambetta (du café Procope), et Edmond Adam (du Comptoir d’Escompte) » 123 . L’Assemblée très conservatrice élue en 1871 a certes renoncé à la restauration monarchique après l’échec de l’union des orléanistes 124 et des légitimistes à l’automne 1873, néanmoins la question du régime n’est alors pas résolue. Dans ce contexte, Albert Wolff, critique d’art dont Gustave Toudouze note la discrétion politique 125, profite du Salon pour présenter les forces politiques en présence au moment de la définition de la République. Le chroniqueur du Gaulois Émile Blavet rappelle, quant à lui, dans son compte rendu du Salon de 1875 ce contexte de mise en place du régime. Le salon devient pour ce bonapartiste le lieu d’un appel à la mobilisation de sa famille politique : « Ce qui distingue les choix du jury pour l’année 1875, c’est l’éclectisme, c’est-à-dire le parti-pris d’être agréable à tout le monde et ne mécontenter personne. […] Ce système a du bon en politique ; il sauvegarde le présent et prépare l’avenir. En art il favorise la médiocrité et fait du chemin vicinal de la décadence une route impériale… pardon ! Nationale » . Outre jouer sur les mots et rappeler la chute de l’Empire, à travers cette critique de l’attribution des médailles par le jury du Salon, Émile Blavet fait également référence à l’alliance des orléanistes et des républicains modérés afin de fonder un régime libéral et parlementaire. En effet, la remontée des bonapartistes lors des élections législatives partielles à partir de 1873 encourage orléanistes et républicains modérés à se rapprocher et à adopter des institutions républicaines. Ce compte rendu de Salon révèle le constat amer fait par un bonapartiste de l’efficacité de cette alliance réalisée au détriment de son groupe politique. Ce journaliste apparaît particulièrement concerné par l’unité du clan bonapartiste dans ses chroniques politiques appelant, lors des élections d’octobre 1877 pour le renouvellement de la Chambre des députés, à la mobilisation afin de mettre en échec les républicains 129 . Pierre Vaisse note cette métamorphose du Salon en Chambre des députés : « les contemporains, et les historiens de l’art à leur suite, ont vu le problème des Salons, et imaginé les solutions à travers le modèle de la démocratie parlementaire, c’est-à-dire à travers la question du droit de vote, dont on connaît l’importance dans la France du XIXème siècle, comme si le jury avait été une Chambre des députés, et les artistes les citoyens d’une République des arts » 130. Néanmoins, cette assimilation ne semble pas être, métaphore superficielle, une simple transposition du langage parlementaire sur l’institution du Salon. L’art surgit également dans des articles narrant cette vie parlementaire tumultueuse. Le journaliste politique Jules Billault, commentateur des débats de l’Assemblée nationale pour le Gaulois, intitule son article du 19 mai 1875 consacré à la nommination des sénateurs inamovibles par l’Assemblée nationale : « Le Sénat des Refusés » 131. Le journaliste choisit d’emprunter à la vie artistique son vocabulaire pour évoquer cette nommination problématique, rapprochant ainsi les sénateurs des artistes refusés par le jury du Salon de 1863. Le bonapartiste note par ailleurs les ambiguïtés de la nouvelle Constitution dans cet article qui jouxte le salon de son confrère Émile Blavet. C’est, en effet, lors de crises, lorsque la vie politique, par son agitation, déborde la place que la presse lui attribue en temps normal, que les acteurs artistiques et politiques apparaissent particulièrement mêlés. Ainsi le salonnier de la Gazette de France , Simon Boubée, dans son compte rendu de Salon du 25 juin 1877, déplore l’invasion du quotidien par l’actualité politique : « Voici bien des jours que les débats parlementaires envahissent les gazettes. Les humbles chroniqueurs ont dû faire place nette aux magnifiques discours de M. le duc de Broglie… et aux onomatopées féroces des fougueux représentants ». Ce conservateur évoque la crise du 16 mai 1877 à la suite de la démission du ministère de Jules Simon. La Chambre des députés refuse la confiance au ministère de Broglie et, après son ajournement par Patrice de Mac Mahon, le renverse le 18 juin.
La critique de la République
La critique d’art et plus particulièrement les comptes rendus de Salons se transforment en tribunes politiques où les adversaires du nouveau régime expriment leurs craintes visà-vis de la République. Les légitimistes ultras lisent dans les œuvres exposées au Salon l’état déplorable de la société française des années 1870. En effet, le critique d’art de l’Union Léonce Dubosc de Pesquidoux ne peut oublier le contexte politique alors qu’il rédige ses salons. La plupart de ses articles commencent par un rappel de la situation politique, telle l’introduction de son premier compte rendu du Salon de 1876 : « Jamais, je crois, un Salon ne s’est ouvert sous des auspices moins riants, et jamais la situation ne prêta moins aux sereines jouissances de l’art. Nous avons presque l’air de victimes parées qui se récréent un moment avant de marcher au sacrifice. Les événements, poussés dans une sorte d’engrenage fatal, se déroulent avec une force irrésistible, et semblent gros des plus lugubres conclusions. Nous ne devons point désespérer de l’avenir parce que le désespoir ne sied ni au lutteur ni au chrétien ; mais il est constant que l’espérance devient une vertu de plus en plus surnaturelle » Ce légitimiste déplore l’échec des monarchistes lors des élections législatives de 1876, il appelle néanmoins au combat et au rassemblement du groupe légitimiste se faisant l’écho du rédacteur en chef du quotidien 141. Refusant d’abdiquer face à la mise en place du régime parlementaire, Léonce Dubosc de Pesquidoux lie l’art au contexte politique dans lequel il est produit : « Dans les jardins d’Armide où nous allons rêver, est-il possible de ne point songer à la mêlée et à ceux qui combattent ? » Considérant qu’en tant qu’écrivain il a un rôle à jouer dans la société de son époque il affirme, jusque dans sa synthèse consacrée à l’exposition universelle de 1878, cette volonté d’étudier l’art à travers le prisme de ses convictions politiques et religieuses : « Convaincu que l’écrivain a charge d’âmes et doit apporter son contingent, si modeste qu’il soit, dans la grande lutte des idées qui divise notre temps et prépare l’avenir, j’ai nettement affirmé ma foi religieuse et politique » . Il défend ainsi la pratique d’une critique d’art légitimiste et catholique et recherche au Salon les symptômes de l’effondrement de la société française causé par l’installation de la Troisième République. Si dans un premier temps, lors du Salon de 1874, le critique ne formule que des craintes, cette toute jeune république ne semblant pas avoir eu de véritable influence sur le monde des arts – « On est surtout étonné que l’art ne porte pas plus profondément l’empreinte des effroyables coups qui ont frappé notre patrie » – il met en garde dès 1877 contre le désordre qui règne dans la société et commence à imprégner la vie artistique : « L’état d’anarchie maintes fois signalé à cette même place et manifeste depuis de longues années s’accentue chaque jour. L’art, dont le rôle historique se borne communément à refléter les mœurs publiques, rappelle en ce moment les nôtres avec exactitude. La confusion n’est pas moindre dans l’école que dans la nation » . Léonce Dubosc de Pesquidoux rédige en effet cet article dans le contexte de la crise de mai 1877 que le rédacteur en chef de l’Union considère comme le résultat de « deux années de politique révolutionnaire ». Le critique s’inquiète de la disparition des traditions et des maîtres au Salon, la seule direction qu’il croit distinguer étant le développement de
la peinture de paysage
Le légitimiste établit alors un parallèle entre l’artiste et l’homme politique qu’il met sur le même plan, tous deux reflètent l’état du pays mais n’en sont pas les seuls responsables : « Les artistes, comme les politiques, reproduisent exactement l’état de la nation. Un peuple désagrégé ne saurait avoir une École ni un Parlement compacts. Si toute nation a le gouvernement qu’elle mérite, on peut dire également qu’elle a toujours des mandataires et des artistes à son image ; et quand l’anarchie règne dans l’une et l’autre de ces sphères, elle ne doit s’en prendre qu’à sa propre folie » 150 . Ainsi, ce critique légitimiste fait peser sur la nation tout entière la responsabilité des crises politiques qui rejaillissent sur l’art. Dénonçant l’influence néfaste de la République sur les artistes, Léonce Dubosc de Pesquidoux affirme le rôle primordial que joue l’art au sein de la société mais également face à l’étranger. L’art doit être, selon lui, un soutien, un facteur de cohésion dans la France post-révolutionnaire. Il reconnaît à l’art la capacité d’être un refuge en cette période politiquement troublée : « Au milieu des agitations et des tristesses de la politique, on éprouve, à se réfugier dans le domaine de l’art, la même impression qu’un voyageur harassé ressent à se reposer dans un bosquet frais et ombreux » 151. Le légitimiste ne considère pas pour autant l’art comme un simple lieu de recueillement, il l’investit d’un rôle politique actif. Son salon de 1876 est l’occasion de définir la place de l’art dans le relèvement du pays : « Nos artistes paraissent voir que la France traverse des heures décisives et que chacun de nous lui doit l’appui de son dévouement et le contingent de sa pensée. Beaucoup d’entre eux ont compris que l’art est une Parole au service des nobles causes, et destinée à réaliser […] le beau pour le Bien et en l’honneur du Vrai ! » 152 Influencé par la philosophie de Victor Cousin 153, ce légitimiste encourage un art qui par sa beauté idéale suscite chez le spectateur des sentiments moraux et religieux qui élèvent son âme vers Dieu. Cet art ne doit pas, chez Victor Cousin, être mis directement au service de la religion et de la patrie, ce qui, diminuant sa liberté, en diminuerait la force, mais doit être uni à elles dans la volonté de transmettre la beauté idéale que le philosophe considère comme une manifestation de Dieu . L’art que le critique appelle de ses vœux doit en effet prendre sa source dans la nation sans pour autant lui être assujetti 155 : « L’art, pour être véritablement populaire et vivant, doit, comme toutes les grandes choses de la vie, se relier à la trame de nos destinées éternelles et temporelles »
Avant-propos |