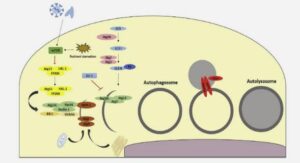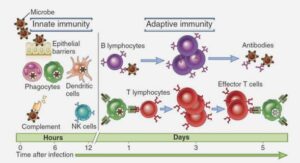Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
La pratique de la psychiatrie et de l’enfermement à travers les âges dans le Monde
Le mot folie a été évoqué à différentes époques dans plusieurs domaines tels que la Médecine, la Religion, l’Art, la Philosophie, ainsi que la Justice. Son histoire en occident va de l’antiquité à l’époque de la Révolution française en passant par le moyen âge et l’époque du grand renfermement (Morel 1985 ; Foucault1972 ; Hochmann1994 ; Pelicier 1971) [37].
Dès le 1er siècle de la République, le droit romain a institué l’incapacité de l’aliéné. Il précisait dans des termes assez clairs : « est responsable toute personne qui peut être convoquée devant un tribunal parce que pèse sur elle une certaine obligation, qui procède ou non d’un acte de sa volonté libre » [16].
Plusieurs lois ont été votées pour maintenir les fous sous contrôle. A cet effet, la loi du 16 Août 1790 demande à l’administration « le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté ». Dans le même sens la loi de juillet 1791 fait obligation aux familles de ne pas « laisser divaguer des insensés ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces » [16, 35, 8].
Devant la nécessité de justifier l’internement de certains types de malades mentaux, le législateur français va entreprendre un long processus juridique de plusieurs années (1795-1838) qui aboutira à la promulgation de la loi sur les aliénés ou loi du 30 juin 1838 qui codifie l’internement en psychiatrie. La loi du 30 juin 1838 précisait que les malades mentaux jugés irresponsables devaient être internés dans des lieux de soins appelés asiles psychiatriques par l’autorité administrative [16, 8].
La loi du 27 juin 1990 « relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux » a succédé à celle du 30 juin 1838, avant d’être remplacé par la loi du 5 juillet 2011, « relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge » [8].
Dans l’ensemble, chacune de ces lois s’est efforcée de trouver un équilibre entre la défense sociale et l’intérêt public, une garantie du droit des personnes malades et un respect de leur droit à la santé, de même qu’une protection des personnes saines d’esprits [37, 8]. A ce titre, le concept de défense social conduit par la Belgique a servi d’exemple en Europe [35]. La loi de défense sociale est promulguée le 9 avril 1930 et est mise en exécution le 1er janvier 1931. Elle a maintenu dans ses grandes lignes jusqu’aux réformes de 1964 la notion d’internement thérapeutique à la criminalité. La mesure d’internement est prononcée pour une durée précise par le tribunal (cinq, dix ou quinze ans), mais si la commission de défense sociale déconseille la remise en liberté au bout de ces termes, le procureur du roi peut soumettre cette décision à la juridiction ayant ordonné l’internement. Il s’agit d’un traitement adapté à l’état de dangerosité, celui qui y est astreint au motif de mesure préventive ne peut voir ce temps soustrait à une éventuelle condamnation à l’internement [35].
En Angleterre, le médecin de prison faisait systématiquement l’examen psychiatrique des détenus entrants. De plus, l’appréciation de la dangerosité est également entrée dans la loi de 1908 dite de « Prévention of crime Act » [35].
En 1924, en URSS (Union des républiques socialistes soviétiques actuelle Russie), la notion de peine a disparu au profit de mesures de préservation de l’ordre social. Cette révolution pénale visait trois objectifs typiques de la défense sociale : la prévention des délits, la neutralisation des individus socialement dangereux et la rééducation par le travail. Le code aussi encourageait le dépistage des individus dangereux n’ayant pas encore commis de délits et leur prise en charge [35].
Ainsi pour la première fois dans tous ces pays, on prévoyait de traiter des individus dangereux non criminels.
La Psychiatrie et la Justice
En France, dans le cadre de la relation entre les pouvoirs psychiatriques et judicaires, la Psychiatrie a été rattaché à un dispositif complexe qui servait à la fois de structure d’accueil pour les anormaux et d’instrument pour la défense de la société dans le cas des individus dangereux qui la menaçaient de l’intérieur [35]. L’apport de la Psychiatrie dans la recherche de la vérité dans la justice pénale a eu une large influence dans l’établissement des lois. Suite au courant humaniste inhérent de la Révolution française, le psychiatre Philippe Pinel a fait adopter, au début du XIXe siècle, l’article 64 du code pénal français disant : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou qu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister » [37, 14]. Durant tout le XIXe siècle, ainsi que le XXe siècle, la notion de responsabilité pénale a été étroitement associée à celle de la responsabilité morale [14].
Le poids accordé à la responsabilité morale d’un délinquant a incité les psychiatres-criminologues à solliciter la possibilité de nuancer leurs avis et d’accorder la responsabilité pénale avec le degré de liberté intérieure. La circulaire Chaumier de 1905 a officialisé cette position en prévoyant non seulement l’irresponsabilité pour état de démence, au sens de l’article 64 du code pénal, mais aussi de la possibilité d’atténuation la responsabilité liée à l’existence chez le prévenu de troubles psychiques susceptibles d’influencer son jugement et sa détermination à commettre l’acte répréhensible [14].
La loi du 25 février 2008 n’a ajouté aucune solution satisfaisante ; elle prévoyait des mesures de sureté à l’issue d’un placement d’office lorsque le délinquant présente une dangerosité potentielle persistante malgré son traitement en milieu psychiatrique. Ceci est dû au fait que ces mesures succédaient à un projet théoriquement thérapeutique qui a été peu efficace avec une orientation purement sécuritaire, alors que l’obtention d’un bon résultat nécessitait la poursuite continue de mesures essentiellement thérapeutiques [35].
L’intervention du psychiatre dans le champ de la justice peut se situer à trois niveaux. Au début des procédures judiciaires, le psychiatre peut être appelé à évaluer la présence et le lien entre un délit et une maladie mentale possible. Si un lien est établi, le deuxième niveau d’intervention consiste à la dispensation des soins au patient détenu. Enfin, le psychiatre peut être appelé à se prononcer sur la dangerosité du détenu avant sa remise en liberté [35, 32, 4, 3].
Aspects cliniques de la dangerosité
L’évaluation de la dangerosité du malade mental est une préoccupation clinique ancienne et complexe. Cependant, la définition de la dangerosité et de l’état dangereux est variable. La dangerosité criminelle est souvent associée à une pathologie psychiatrique dont il faut la distinguer. La dangerosité psychiatrique est une question complexe, ancienne, qui est à l’origine des fondements même de la psychiatrie et des premières mesures thérapeutiques pour les malades mentaux [5, 29, 1]. La dangerosité en tant que telle est définie comme l’état dans lequel une personne est susceptible de commettre un acte violent [29].
Diverses définitions de l’état dangereux ont été proposées. Cependant la définition de la dangerosité criminelle la plus claire est sans doute celle de Bénézech et al. [5, 1] : « État, situation ou action dans lesquels une personne ou un groupe de personnes fait courir à autrui ou aux biens un risque important de violence, de dommage ou de destruction ». La dangerosité psychiatrique quant à elle est une manifestation symptomatique liée à l’expression directe de la maladie [20].
De multiples pathologies psychiatriques peuvent amener le patient à être dangereux pour lui-même ou pour la société. La dangerosité peut se manifester dans toutes les pathologies psychiatriques à des degrés différents. Elle est évolutive, transitoire ou durable, parfois fluctuante en fonction du temps et des circonstances. Le risque peut être auto ou hétéro-agressif [29, 42]. Des actes de violence et d’agressivité peuvent être rencontrés dans la bouffée délirante aiguë. Il peut s’agir d’un patient qui commet une agression en cherchant à se défendre contre ses persécuteurs imaginaires, sous l’emprise d’hallucinations auditives impératives ou d’un syndrome d’influence lui intimant l’ordre de tuer. Le passage à l’acte est violent, soudain, impulsif et non prémédité [29].
Dans la confusion mentale, la désorientation temporo-spatiale, le délire onirique et les perturbations du champ de la conscience peuvent être à l’origine de passage à l’acte auto et /ou hétéro agressif [2].
L’accès de manie furieuse avec violence extrême est classique mais rare, de même, l’homicide « altruiste » du mélancolique s’inscrivant dans un contexte de suicide collectif élargi aux proches est classique quoique, également rare en pratique. L’épilepsie fronto-temporale semble volontiers plus à l’origine des comportements violents [2].
Pour ce qui est des conduites addictives, on remarque que l’usage de substances psychoactives peut être à l’origine de vols avec violence, du fait d’un besoin de se procurer le produit [16].
Le passage à l’acte dans la schizophrénie est plus fréquent dans les formes paranoïdes et héboidophréniques, et aboutit généralement à un homicide [16]. L’automatisme mental et le syndrome d’influence peuvent être à l’origine d’actes médico-légaux dans la psychose hallucinatoire chronique [16].
La notion de « dangerosité » prend actuellement une importance croissante au niveau de la Justice. Les magistrats et les surveillants de prison sont amenés à devoir fréquemment l’évaluer. Les résultats des entretiens réalisés par Przygidzki-Lionet et al. [34] confirment l’existence de dangerosités sociale, pénale et carcérale. Ils estiment que toute évaluation de la dangerosité ne peut être satisfaisante que lorsqu’elle s’inscrit dans une approche à la fois clinique et sociale. Psychologues et psychiatres participent largement au travers de leur mission expertale, à cette catégorisation des individus. Ils sont en effet régulièrement sollicités par les magistrats quant à cette question de la dangerosité potentielle d’un individu [29].
Le consentement
Il est important de définir le consentement vu que nous parlons de l’internement qui est une hospitalisation sous contrainte. Le verbe « consentir » signifie « accepter qu’une chose se fasse et ne pas l’empêcher ; approuver et souscrire ; autoriser et permettre ». Cependant, il n’est pas facile de calquer le consentement libre et éclairé en médecine somatique à la psychiatrie [24, 40].
En psychiatrie la question de la compétence à consentir se pose, déclinée en termes d’« aptitude à comprendre l’information et à prendre une décision » et de « rationalité du vouloir ». Cette notion de « rationalité du vouloir » étant à interroger tant elle laisse dans l’indétermination les critères à partir desquelles celle-ci est évaluée. «Dans les services de psychiatrie, le refus de soins et les sorties contre avis médical sont particulièrement fréquents. Il s’agit d’un droit du patient. Le refus de soins s’appuie sur la liberté qu’il possède sur son propre corps » [41, 24, 25]. « Ce refus du traitement ou de soins n’est pas a priori une question pathologique mais peut témoigner de processus psychologiques : de persécution, du sentiment d’une intrusion de l’autre dans son propre monde en particulier chez les psychotiques » [24, 25].
Le fait de redéfinir le consentement en termes de capacité, joue un rôle clef dans les processus d’imposition de la contrainte et de sa légitimation chez certains malades mentaux [24, 25]. Au « consentement éclairé » se substitue le « consentement recevable » ou « valable », dont l’exactitude est appréhendée sur l’horizon de raisons partageables par autrui. Le rôle du médecin psychiatre dans la qualification du consentement est net dans le travail en précarité, ainsi que dans les formes les plus graves des maladies psychiatriques et dans l’interprétation suivante de la « perte de la capacité à faire un choix ». On considère par exemple que le patient « n’est plus libre de son choix puisqu’il est envahi par son délire et que son délire le met en danger ou met les autres en danger » [24]. La compétence est remise en question dans la mesure où « en psychiatrie, ce qui permet de consentir sont : le jugement, l’affectivité et la relation à autrui. Ces trois aspects sont soit atteints, perturbés ou bouleversés lors de la maladie mentale [24, 27, 40, 25].
Dans la pratique quotidienne, lorsqu’un patient montre une abolition de son discernement, il prévaut le principe de l’intervention médicale dans l’intérêt d’un sujet dont on estime qu’il n’est pas en état de donner un consentement libre et éclairé [24, 27, 40].
Les types d’hospitalisation
L’hospitalisation sous forme d’internement qui était la règle il y a un siècle en France, est devenue moins fréquente au profit de l’hospitalisation en « service libre ». Le placement en service libre suppose que le malade consent à son hospitalisation et qu’il n’est pas dangereux et n’exige pas une surveillance spéciale [47, 21].
L’hospitalisation d’autorité : l’internement selon la loi de 1838
En France, l’hospitalisation d’office (HO) concerne les malades mentaux compromettant l’ordre public et la sécurité des personnes [21]. Il existe deux modalités d’internement :
Le placement volontaire régit par l’article 8 de la loi de1838, s’applique à « tout malade pour lequel l’internement est indiqué sans être exigé par la police (arrêté préfectoral) ». Il s’agit d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, il est demandé par un membre de la famille, un ami, un assistant social ou toute autre personne capable et pouvant justifier son identité. S’il est signé par le malade même, on parle « d’auto-placement » [21, 23].
Une demande d’admission du demandeur doit être rédigé et signé sur papier libre et adressé au directeur d’établissement. Elle doit contenir les noms, prénoms, âge, profession et domicile du malade et du demandeur, le degré de parenté ou la nature de leur relation. Une pièce d’identité du demandeur doit y être jointe [21].
Un certificat médical sur papier timbré doit être obligatoirement établit par un médecin qui n’est ni rattaché à l’établissement psychiatrique, ni parent ou allié du demandeur, du directeur ou du propriétaire de l’établissement. Ce certificat doit être daté de moins de quinze jours et contenir les noms et adresses du médecin certificateur et du malade. Enfin, il doit décrire les symptômes constatés (parole et réactions caractéristiques du malade) de manière simple et précise sans mentionner le diagnostic. Le « certificat d’internement» doit conclure nettement l’indication de la nécessité de traiter le malade dans un établissement « réservé aux maladies mentales » ou « régi par la loi du 30 juin 1838 ».
Il est aussi requis une pièce d’identité du malade [21].
La sortie doit se faire à la demande de l’initiateur ou sur décision du médecin qui rédige simplement un certificat pour le préfet précisant l’état mental à la sortie. La sortie d’essai est établie par la circulaire ministérielle du 4 juin 1957. Elle est décidée par le médecin qui en informe le préfet [21, 47, 23, 9].
Le placement d’office est ordonné par le préfet de police par un arrêté préfectoral et dans les cas d’urgence par un réquisitoire du maire ou du commissaire de police (article 19). Le réquisitoire doit être ratifié dans le plus bref délai. L’arrêté autorisant le placement est la pièce essentielle. Il doit être motivé soit par un certificat médical soit par un procès-verbal du maire ou du commissaire de police (témoignages plus faits recueillis) [47, 21]. Le certificat médical non obligatoire peut servir à motiver l’arrêté. Il doit répondre aux exigences du certificat de placement volontaire. Cependant, il doit être délivré par le médecin traitant ou un médecin requis par l’autorité administrative ou présent dans un hôpital général où le malade a été mis sous placement provisoire par l’autorité administrative [21, 23]. Il est nécessaire d’établir un état de renseignements sur la situation des biens personnel et familiaux du malade et sur la détermination de son domicile de secours [21]. De même, les pièces d’identité justifiant l’état civil du malade sont exigées.
Selon l’article 24, le transport doit être assuré par le maire, le commissaire ou le préfet, il doit aussi éviter les étapes intermédiaires [21]. La sortie ne peut se faire qu’après un nouvel arrêté préfectoral établi à la vue du certificat médical du médecin traitant indiquant la guérison ou l’amélioration du malade concluant à une proposition de sortie. La sortie d’essai résulte d’un arrêté préfectoral suite à une proposition du médecin. Elle a une durée de 1 à 3 mois avec des rendez-vous rapprochés. Lorsque l’hospitalisation n’est plus indiquée, la sortie définitive est faite avec possibilité de réhospitalisation directe sans formalité en cas de rechute [21].
Afin de protéger la liberté individuelle et rendre impossible un internement abusif, la loi de 1838 avait prévu un contrôle allant des différentes modalités de l’instauration de l’internement à la tenue par chaque établissement de registres côtés et paraphés par le maire, le procureur, etc. Dans ce registre sont inscrits les noms des malades. Les certificats médicaux y sont recopiés, et tous changements de l’état de santé du malade y sont mentionnés chaque mois. Les établissements doivent être visités par le procureur en charge au moins tous les six mois, ainsi que le président du tribunal de grande instance, le juge des instances et le maire de la commune. S’il y a des recours, le tribunal statue en chambre du conseil et ordonne la sortie s’il y a lieu et cela même contre l’avis du préfet en cas de placement d’office [24, 21].
Le placement en service libre
Le placement en service libre a été inauguré en France en 1922 par E. Toulouse [21]. Il concerne les malades qui désirent se soigner librement. Un simple billet d’hôpital rédigé par le médecin suffit pour entamer l’hospitalisation. Cependant des vicissitudes pratiques ont été notées avec l’usage des moyens de contrainte.
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE
1. Histoire de la psychiatrie au Sénégal
2. Histoire des soins sans consentement
a. La pratique de la psychiatrie et de l’enfermement à travers les âges dans le Monde
b. La Psychiatrie et la Justice
3. Aspects cliniques de la dangerosité
4. Le consentement
5. Les types d’hospitalisation
a. L’hospitalisation d’autorité : l’internement selon la loi de 1838
b. Le placement en service libre
DEUXIEME PARTIE
1. METHODOLOGIE DE L’ETUDE
1. Objectifs
a. Objectif général
b. Objectifs spécifiques
2. Type d’étude
3. Cadre d’étude
4. Population d’étude
5. Période d’étude
6. Critères
a. Critères d’inclusion
b. Critères de non inclusion
7. Collecte des données
8. Instruments
9. Difficultés de notre étude
10. Considérations éthiques
2. LES OBSERVATIONS
2.1. Observations cliniques
2.2. Entretien avec les médecins
2.2.1. Concernant les autorités
2.2.2. Concernant le patient
2.2.3. Concernant les médecins
2.2.4. Concernant la structure d’accueil
3. Discussion
1. Sur le plan juridique
1.1. La Clinique Moussa Diop et son statut juridique
1.2. Nature de la décision administrative
2. Sur le plan clinique
2.1. Aspects socio-démographiques
2.2. Antécédents psychiatriques
2.3. Conduites addictives
2.4. Durée d’évolution du tableau clinique
2.5. Signes cliniques de dangerosité
2.6. Les Diagnostics
2.7. Nature de la prise en charge
2.8. Durée du séjour et exéat
2.9. Suivi en ambulatoire
3. Les difficultés
3.1. Les difficultés liées à la famille
3.2. Difficultés liées à la structure
3.3. Les difficultés liées aux autorités
3.4. Les difficultés liées au patient
3.5. Les difficultés des médecins
CONCLUSION
RECOMMANDATIONS
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES