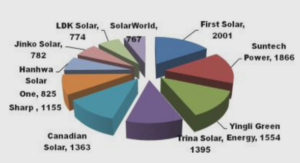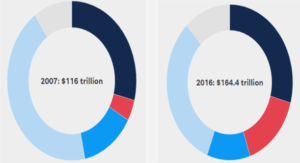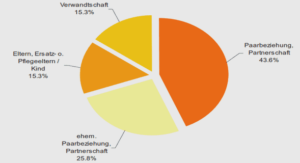La notation sociétale, ou screening
Une évaluation objective et complète de la performance des entreprises, sur des critères éthiques, sociaux ou environnementaux est indispensable à la crédibilité des fonds socialement responsables. Des organismes non bancaires agissent donc comme de véritables agences de recherche et d’information sociale sur les entreprises.
Certaines ont une vocation purement commerciale et « objective ». Un des plus fameux aux États-Unis est le cabinet KLD (Kinder, Lydenberg, Domini & Co), dont l’une des fondatrices, Amy Domini, a donné son nom à l’indice DSI 400 (Domini Social Index) et à un des plus grands fonds socialement responsables (Domini Social Investments). En France, ARESE, créée par Geneviève Ferone en 1997 avec le soutien de la Caisse des Dépôts et de la Caisse d’Épargne, avait rapidement pris la plus grande part du marché, avant d’être absorbée, comme la plupart des fonds français créés entre 1997 et mi-2002, par Vigeo.
D’autres sont à but non lucratif et militants. Le plus connu aux États-Unis est le Council on Economic Priorities (CEP), fondé par Alice Merlin-Teppler, et qui est aussi à l’origine de la création de SA 8000, norme sociale internationale. CEP a publié Shopping for a better world, ce best-seller a pour objectif de permettre aux consommateurs de faire leurs courses selon des critères éthiques. Un modèle suivi en France par l’Observatoire de l’Éthique, association qui fait également de l’évaluation sociétale et qui a publié, en mai 2001, le Guide du consommateur éthique. Enfin, le Centre Français d’Information sur les Entreprises (CFIE), association créée en 1999, réalise des monographies sur les entreprises du CAC 40 et publie une lettre bimestrielle.
Enfin, certains organismes bancaires importants préfèrent avoir des équipes en interne (in-house). C’est le cas, par exemple, de la Dresdner Bank qui gère un montant record de fonds socialement responsables (8 Mds d’euros) et qui a créé sa propre base de données (1 500 entreprises dans le monde).
Par ailleurs, le screening sociétal s’appuie sur plusieurs sources :
• des questionnaires envoyés aux entreprises ;
• des rencontres avec les dirigeants ;
• la compilation d’informations venant des entreprises (bilan social, rapport de développement durable…) ;
• le tracking d’informations dans la presse ou sur Internet ;
• la remontée d’informations en provenance des syndicats et des ONG.
Le croisement sociétal / financier
À partir de ces évaluations sociétales externes, parfois croisées par les données de leurs services internes, les gestionnaires de fonds constituent des portefeuilles éthiques généraux ou thématiques (environnement, social, etc), en choisissant ou au contraire en évitant d’investir dans certaines entreprises. Ces données sociétales sont alors croisées avec les données financières pour assurer une bonne performance : certaines valeurs, sociétalement correctes, sont sur-pondérées, les « incorrectes » étant sous-pondérées. Le gestionnaire de fonds doit alors décider du nombre de valeurs qu’il veut mettre dans son fonds, sachant que la théorie financière évalue entre 30 et 60 valeurs, le point d’équilibre entre diversification et performance. Il devra également se demander s’il peut se passer de certaines valeurs qui représentent un pourcentage important de l’indice.
L’activisme actionnarial
Aux États-Unis, les gestionnaires de fonds responsables ont depuis longtemps pris une position active : ils préparent et votent des résolutions d’actionnaires (Shareholder Proposal), entament des discussions et négociations avec le management des entreprises (Shareholder Dialogue) et annoncent publiquement leurs prises de position sur des sujets à traiter lors des assemblées générales annuelles, grâce à leurs bulletins d’information et leurs sites. Par exemple, il y a deux ans, le Domini Social Equity Fund a annoncé qu’il publierait, sur son site Web, chacune des positions prises lors des votes de résolutions aux assemblées générales annuelles de chacune des sociétés dont il détient des actions.
La naissance des droits des actionnaires aux États-Unis, remonte au crach bousier de la fin des années 1920, analysé comme un manque de transparence de la part des entreprises et qui a entraîné la création de la SEC (Securities and Exchange Commission).
L’activisme actionnarial socialement responsable remonte aux années 1970, avec la création d’une coalition d’investisseurs « religieux », Interfaith Center for Corporate Responsability, qui commença à déposer des résolutions lors des AG d’entreprises travaillant avec l’Afrique du Sud en plein apartheid. Puis, en 1989, avec la marée noire causée par l’Exxon Valdez, c’est une coalition d’investisseurs et d’ONG environnementalistes qui créa le Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES), avec pour objectif d’obliger les entreprises à adopter un ensemble de principes sur l’environnement et à publier un rapport environnemental standardisé. Ainsi, le CERES est à l’initiative de la norme Global Reporting Initiative (GRI) qui pose les principes internationaux pour établir un rapport de développement durable. Depuis, l’activisme actionnarial s’est développé. En 1997, le Social
Investment Forum estimait que les investisseurs jouant un rôle actif dans ce domaine pesaient trois quarts d’un trillion de dollars !
La redistribution : le community-based investment
Aux États-Unis, faire de l’argent n’est pas suspect, à condition d’en redistribuer une partie à la communauté dans laquelle on opère. Les fonds socialement responsables n’échappent pas à cette règle. Le Social Investment Forum recommande ainsi aux gérants de fonds socialement responsables de réserver au moins 1 % de leurs investissements à l’investissement communautaire, qui permet l’accès au capital à des personnes qui ne peuvent le faire par les opérateurs conventionnels : micro-crédit pour les socialement défavorisés, développement local pour les PME, artisans, etc.
On n’en est pas là en France. Seule la loi sur l’épargne salariale prévoit, dans son article 9, que certains fonds issus de l’épargne des salariés devront investir 5 à 10 % de leurs actifs dans des entreprises d’économie solidaire. En fait, en France, la tradition de redistribuer est plutôt orientée « charité » : ce sont les fonds de partage (créés par des organismes à tendance catholique), dont une partie des intérêts va à des ONG, souvent impliquées dans le développement des pays du Sud. Mais, ces fonds, basés sur des obligations, ont des rendements assez faibles (5 % en moyenne) et semblent moins attractifs que les fonds socialement responsables. D’ailleurs, aucun nouveau fonds de partage n’a été créé depuis 1995. Toutefois, certaines associations comme Habitat et Humanisme ou le CCFD essaient de dynamiser leurs fonds en y introduisant des actions.
Signalons enfin qu’un organisme a été créé en 1995, à l’initiative de la fondation C.-L. Meyer et de plusieurs organismes de l’économie sociale et solidaire (Adie, les Cigales, France Active, Nef…) : Finansol est un outil de sensibilisation et d’information du grand public, un outil de lobbying, mais aussi un label. Les organismes financiers qui veulent l’obtenir doivent respecter des critères de transparence et de solidarité : au moins 10 % de la collecte et / ou 25 % du revenu généré doivent être directement investis dans des activités solidaires ou de lutte contre l’exclusion.
LES FONDS SOCIALEMENT RESPONSABLES : QUELLE CRÉDIBILITÉ ?
Le risque marketing ou l’effet de mode
Toutes les sociétés de gestion veulent offrir au moins un fonds socialement responsable. Le risque est, bien entendu, de monter rapidement un produit « bidon », soit avec un processus de screening pas assez transparent, soit qui n’est pas vraiment appliqué.
Les autres risques
Il existe, selon P. Bollon, trois écueils à éviter :
• l’idéologisme qui pourrait, par exemple, exclure les investissements faits en Israël (fonds islamiques) ou, à l’inverse, en Palestine ;
• le passéisme qui pourrait, par exemple, éviter toute entreprise conduite à licencier ;
• le subjectivisme et le confusionnisme, alors qu’un gérant doit avoir de vrais critères, de vrais processus de gestion qu’il peut et doit clairement expliquer à ses clients.
Légitimité et crédibilité des agences de notation
Ces agences ont une lourde responsabilité puisqu’elles jugent la performance sociétale des entreprises, au même titre que les analystes financiers jugent les performances économiques. Leur crédibilité ne peut être fondée, selon G. Ferone6, que sur leur professionnalisme. Or, ce professionnalisme dépend de deux facteurs :
• des moyens mis en place ➥ ARESE, avant d’être reprise par Vigeo, revendiquait quinze analystes pour surveiller 400 entreprises, alors que Sustainable Asset Management7 (SAM) aurait dix-huit analystes pour analyser les performances de 2 500 entreprises du Dow Jones Global Index et 600 entreprises du DJ Stoxx Index. Soit plus de 150 entreprises par analyste ! De toute façon, les organismes de notation sociétale restent, au mieux, des PME qui jugent des « mammouths »…
• de la rigueur méthodologique ➥ G. Ferone, qui avait travaillé avec ses homologues européens pour créer le Sustainable Investment Research International (SIRI Group, réseau de onze agences internationales), s’était aperçue que leur travail se bornait souvent à compiler des données. L’harmonisation internationale est un autre point d’achoppement de la notation sociétale. Comment prendre en compte les différences de mentalités nationales et locales ?
Par exemple, les Anglais sont très attentifs aux expériences de laboratoire réalisées sur des animaux : leurs associations sur le sujet sont virulentes. En France, en revanche, le problème ne défraie pas la chronique, alors que les licenciements (cf. Danone, Mark’s & Spencer) sont un sujet sensible. Les Anglais, en revanche, y voient un acte de gestion normale. De même, les Américains sont focalisés sur les discriminations – on demande aux entreprises combien il y a de noirs, de jaunes, d’hispaniques, etc., dans leurs boards, dans leur management, alors que cette approche, en France, est en contradiction avec la tradition républicaine.
Pour rendre le marché de la notation extra-financière plus transparent, l’ORSE, l’Entreprise Pour l’Environnement (EPE) et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) ont publié, en octobre 2001, le premier Guide des organismes d’analyse sociétale8. Les principales conclusions du groupe de travail, formé pour ce guide, montrent un marché encore immature :
• le résultat de l’évaluation sociétale d’une entreprise dépendrait directement de l’organisme qui la mène ! Ce serait la conséquence de la diversité des acteurs (associations militantes, agences de rating, gestionnaires de fonds) et des méthodes (exclusion / pas exclusion, manière de collecter l’information, etc.). Selon le groupe de travail, cette diversité nécessite une meilleure transparence de ces organismes et un meilleur dialogue avec les entreprises notées.
• la facilité d’accès aux informations est l’un des éléments clés d’évaluation de la transparence de la politique d’entreprise, certains organismes considérant même qu’une non-réponse indique que l’entreprise n’a pas mis en place de politique de développement durable. D’où l’importance cruciale de répondre aux sollicitations des organismes d’analyse sociétale, même si les entreprises sont submergées de questionnaires de sources diverses (le guide recense une trentaine d’organismes de certification).
• les organismes d’analyse sociétale fondent leur évaluation sur un périmètre (géographie et activités) le plus large possible, mais toutes les informations n’ont pas le même degré de précision et de vérification. Ainsi, l’évaluation d’un groupe international et multi-sectoriels reste problématique, d’autant plus qu’il n’y a pas de consensus sur la limite de la responsabilité d’une entreprise (problème de la sous-traitance, impacts culturels ou lié à l’utilisation des produits chez le consommateur…).
• le modèle anglo-saxon, largement dominant, n’est pas forcément adapté aux entreprises françaises (par exemple, la place des femmes et des minorités pose le problème du principe de non-discrimination en France).
La commission qui a produit ce guide formule donc quelques recommandations aux entreprises, pour améliorer la situation :
• l’élaboration d’un code de bonne conduite mutuelle entre les entreprises et les organismes de notation (engagements de confidentialité, de feedback et d’échange d’informations…) ;
• la structuration et la simplification du processus de réponse aux questionnaires, avec, entre autres, la création d’un « puits de données » recensant l’ensemble des informations ;
• la publication d’un rapport de développement durable et l’engagement dans une démarche de certification ;
• la communication des résultats sociaux et environnementaux des entreprises vers toutes les parties prenantes ;
• la participation aux initiatives nationales et internationales, telle la GRI.