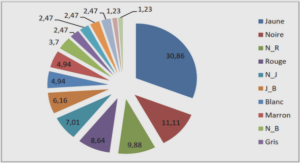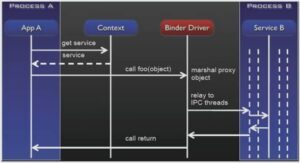La philosophie de l’amour dans l’Espagne du XVe siècle
L’ORDRE AMOUREUX : LE POUVOIR STRUCTURANT DE L’AMOUR
Première partie : L’ordre amoureux — Introduction 24 Les différentes formes d’amour vertical servent à configurer un ordre, l’ordo amoris. Selon le vieux postulat de Grégoire le Grand, tout ordre repose sur une hiérarchie et, par conséquent, sur un échange affectif inégal. D’un côté la dilection, de l’autre la révérence. La verticalité implique donc l’amour autant que celui-ci l’exprime. Ces formes verticales de l’amour peuvent alors s’inscrire dans les architectoniques médiévales de la hiérarchie, à l’instar d’autres représentations symboliques comme celles des « arbres », qui tendent à signifier une relation d’inégalité pouvant être ontologique, politique ou sociale, suivant les cas. Dès lors que l’amour est une forme verticale de relation il constitue le moyen d’un classement (taxis), d’une organisation (ordo) auxquels viennent se greffer des représentations sociales. L’amour se confond ici avec une vision du monde; il est intégré aux trois champs fondamentaux de l’univers médiéval : l’espace métaphysique, l’espace privé et l’espace public, ou, en d’autres termes, la religion, la famille et le pouvoir. Qu’il s’agisse du rapport au divin, des liens entre ceux qui partagent un même sang, ou des relations entre souverains et vassaux, c’est toujours de l’amour que parlent les textes. C’est « par amour » que Dieu nous donne la vie, et c’est seulement de l’amour que nous sommes tenus de lui rendre en échange. De même, il est le fondement de toute cellule parentale : les conjoints s’aiment, et de leur amour naît une descendance qui sera à son tour aimée et aimante. Enfin, le devoir principal du souverain est d’aimer sa terre et ses vassaux, et grâce à cet amour son gouvernement ne peut être que bon. De leur côté, les vassaux sont liés à leur souverain précisément par l’amour, beaucoup plus que par un besoin de protection ou un simple pacte de soutien, et surtout pas par intérêt. Cause et point de départ de toute action, condition de toutes les vertus, seul lien vraiment absolu au-delà de toutes les affinités et les alliances particulières, l’amour finit par être le principe et le fondement de la vision médiévale du monde. Les textes médiévaux, quelles que soient leur provenance et leur destination, ne cessent d’affirmer cette primauté qui est laissée à l’amour comme principe organisateur de l’univers, autant du monde d’ici-bas que des rapports avec l’au-delà. On n’a pas suffisamment insisté sur cet aspect qui est sans doute une des caractéristiques de la pensée médiévale. A la recherche d’un principe centripète universel capable, au moins d’une manière idéale, de réunir, de rassembler tous les hommes, la religion, la morale et le droit n’ont trouvé que l’amour. Le Moyen Age est probablement, par rapport aux autres moments de l’histoire, le temps de l’amour, c’est-à-dire le temps où l’amour a joué, ne serait-ce que d’une manière théorique, le rôle le plus important dans la constitution des idéaux et des représentations d’une société. Le Christianisme en a fait non seulement le fondement de son dogme par opposition à la Loi judaïque, mais aussi son principe social, par le biais de l’agapè, de la charité chrétienne. Pour les médiévaux, nourris d’augustinisme et de patristique, la société chrétienne idéale est, d’une part celle que le Christ aime et qui aime le Christ, et d’autre part celle dont les membres s’aiment les uns les autres d’un amour sans faille. La tradition exégétique chrétienne du Cantique des cantiques, extrêmement intense lors du renouveau culturel roman, avec des figures comme saint Bernard, s’est aussi chargée de donner à l’amour une telle primauté. L’intellection mystique des rapports entre le Christ et l’Eglise, l’ensemble des fidèles, se fait alors à travers la métaphore des Epoux spirituels, des amants mystiques. En outre, l’adaptation au christianisme de certains éléments de la mystique arabe, en particulier celle des Soufis, à partir du XIIIe siècle, a définitivement fait de toute expérience mystique une expérience amoureuse. Dans la Péninsule Ibérique, cette adaptation a été favorisée par le triculturalisme qu’exprime tout particulièrement l’amantia de Raymond Lulle, autant dans son versant mystique, celui de l’Amic e amat, que dans le versant métaphysique, par exemple dans le Llibre de filosofia d’amor. Parallèlement à cette primauté de l’amour dans la religion et la mystique, la morale, assujettie aux mêmes sources textuelles, a développé une conception des liens parentaux tout aussi fondée sur l’amour. Les textes moraux ont cherché à donner au principe contractuel de l’alliance conjugale — apparentée, dans les faits, à une simple transaction entre des « clans », dans le but d’un accroissement de pouvoir, comme l’a montré Georges Duby1 — une dimension symbolique et religieuse dont le fondement se trouve dans l’idée chrétienne de l’amour. A la suite des écrits de saint Paul et des Pères, on a voulu faire du mariage chrétien un mariage d’amour, une espèce de micro-équivalent social de la grande union mystique avec le Christ. L’amour a donc servi d’opérateur d’une entière analogie entre le religieux et le social. C’est une même conception de l’amour qui a permis d’associer intimement le plan métaphysique, voire mystique, et le plan strictement social. Bien entendu, cette association s’étend aux rapports entre les parents et leurs fils. L’idée d’un Dieu « père » aimant ses fils a été projetée sur l’amour paternel dans la cellule parentale. Sur le plan politique, la diffusion des doctrines hiérocratiques sur la théocratie royale, à partir de la consolidation idéologique de l’Empire carolingien2, a permis d’appréhender la relation politique selon les modèles de la relation religieuse. En tant que bras séculier, le monarque théocratique est l’un des représentants sur terre du pouvoir divin. De ce fait, il en épouse certaines propriétés et, tout particulièrement, la bonté. Or, la manifestation première de la bonté divine est l’amour qu’Il porte à ses créatures. Aussi, le monarque lui-même doit-il, à l’image de Dieu, être un parfait amoureux des êtres que Dieu, selon la thèse politique descendante, a placés sous son autorité. Le monarque « par la grâce de Dieu » est le commanditaire sur terre de l’amour divin. L’amour est donc le seul lien qui l’unit symboliquement à son peuple. Il est l’équivalent rituel, sacré, du lien naturel, de la terre. De la terre, le monarque tire sa légitimité naturelle; de l’amour à son peuple la légitimité supra-naturelle. Le souverain, en effet, qui n’aimerait pas son peuple ou qui ne régnerait pas sur la terre qui lui appartient naturellement, briserait les deux pôles de sa légitimité. Sa légitimité spirituelle, par le non-respect de la mission sacrée que Dieu lui a confiée qui est de faire régner l’amour par l’amour. Sa légitimité matérielle, en usurpant une terre qui ne lui a pas été donnée par Dieu. S’il manque à ces deux engagements, il devient tyran et peut être dépossédé de son pouvoir. Le mauvais roi est celui qui n’aime ni son peuple, ni sa terre, comme l’affirment la plupart des textes politiques, autant hispaniques qu’européens. Comme nous le verrons plus loin, les Partidas d’Alphonse X constituent le modèle ibérique de cette légitimité par l’amour du souverain médiéval qui arrive jusqu’au Breuiloquio de amor & amiçiçia d’Alfonso de Madrigal. Il apparaît donc que l’amour n’est pas uniquement ce principe centripète qui permet d’unir les hommes dans la religion, la famille et le pouvoir. Il est aussi ce qui permet une association intime entre ces trois champs. C’est une même conception de l’amour qui permet de réunir le religieux, le parental et le politique, en adéquation avec cette recherche d’un principe unique, de l’harmonie, de la similitude qui caractérise le Moyen Age. Il y a pour les médiévaux une unité substantielle entre l’amour religieux, l’amour familial et l’amour politique, ne serait-ce que parce que, comme on l’a exposé succintement, c’est l’extension du modèle religieux qui permet une compréhension amoureuse des rapports familiaux et politiques. De ce fait, l’amour est un des principaux opérateurs de la cohérence et la cohésion du monde médiéval, tel que se le représentent idéalement les auteurs. Et nous apportons cette précision puisqu’il va de soi, comme les historiens modernes l’ont montré, que de tels principes censément fondamentaux peuvent être compris, d’une manière critique, comme étant les moyens que s’est donnés une société dans un temps donné, pour légitimer des actions et entériner des pratiques, afin de les rendre incontestables. La sacralisation des rapports que permet cette conception de l’amour masque bien d’autres intentions. Le fondement éthico-religieux de l’amour a toujours accompagné depuis ses débuts l’expansion et la consolidation du christianisme. De même, l’idée chrétienne de la famille permet d’évacuer, au moins superficiellement, la fonction socio-économique première du mariage. Enfin, la relation politique d’amour entre souverains et vassaux est inhérente à l’adoption par l’Occident médiéval des thèses politiques descendantes, au détriment des thèses ascendantes, fondées non pas sur le principe vertical de la participation amoureuse, mais sur l’idée de l’intérêt commun de la res publica. Cette conception de l’amour vertical est donc entièrement prise dans ce que nous pouvons appeler un discours idéologique. Elle hérite de présupposés et elle a pour but de fonder en raison des idéaux et des interdits ou, pour reprendre des termes de l’anthropologie, des totems et des tabous. Cela revient à dire qu’elle met sans cesse en place des oppositions, des antinomies, des rapports de force. La conception verticale de l’amour s’insère dans une idéologie en ceci qu’elle fonde des rapports dialectiques, somme toute indissociables de toute forme de verticalité, de hiérarchie. L’idée d’un haut et d’un bas implique nécessairement la détermination d’un bon et d’un mauvais, d’un meilleur et d’un pire, d’un fort et d’un faible, d’un dominant et d’un dominé. Si l’amour est une hiérarchie, il devient la structure sur laquelle peuvent se greffer ces différents degrés. Et c’est là aussi que réside la force idéologique de l’amour. Il permet d’exclure en incluant. A l’instar d’un filet qu’on fait remonter à la surface, il permet de saisir tous les éléments épars en les plaçant les uns au-dessus ou au-dessous des autres, en rehaussant certains et en abaissant d’autres. Tel est le sens médiéval de l’ordre, de l’ordination, comme le suggère Georges Duby : « l’ordination rassemble en même temps qu’elle trie »3. Ainsi, l’idée religieuse de l’amour peut exclure toutes les autres formes d’amour considérées comme basses et fausses, et, tout particulièrement l’amour charnel. De même, l’amour conjugal passe par la supériorité de l’homme sur la femme et des parents sur les fils. Enfin, l’amour du seigneur pour ses vassaux est la marque de l’infinie distance qui le sépare d’eux. L’amour vertical est tout le contraire d’un mélange, d’une fusion. Il instaure un rapport, il crée un lien, il inclut dans une relation, tout en opposant, tout en excluant, c’est-à-dire en interdisant l’idée d’une identité. On ne peut aimer verticalement que dans la différence.
L’AMOUR ET LE SACRÉ
Les deux amours et les deux archiprêtres, Juan Ruiz et Martínez de Toledo L’extension conceptuelle de l’amour dans les textes médiévaux est productrice d’équivocité. Un seul et même terme s’applique à des champs sémantiques différents, voire opposés comme dans le cas du sacré et du profane. Car, c’est bien de l’amour et uniquement de l’amour qu’il est question autant dans le sacré que dans le profane. Qu’il s’agisse de la chair ou de l’esprit le terme employé est celui d’« amour ». Le meilleur témoignage de cette ambiguïté fondamentale de l’amour se trouve dans le Libro de buen amor de l’Archiprêtre de Hita qui non seulement se propose de la mettre en lumière mais aussi de l’exploiter littérairement. Tout d’abord, Juan Ruiz, comme tant d’autres, commence par opposer le sacré et le profane en se servant d’une adjectivation. Il y a un « buen amor » et un « loco amor ». Si on prend au pied de la lettre le prologue en prose du Libro de buen amor1, on y trouve une traditionnelle reprobatio de l’amour mondain, du « loco amor ». L’existence de deux amours, chez un Juan Ruiz qui se fait, au moins formellement, l’écho de la tradition moraliste chrétienne, entraîne l’exclusion de l’un d’eux. Le sacré évacue le profane. Si l’amour est double, il faut que l’un soit « bon » et l’autre « mauvais »; l’un correspond à la sagesse, à l’entendement conçu comme un don de Dieu — comme l’exprime le thème de l’intellectum tibi dabo, par lequel commence le « sermon » de Juan Ruiz —, l’autre, en opposition directe, n’est que le fruit de la folie, de la corruption des facultés de l’âme2 : « E desque está informada e instruida el alma que se ha de salvar en el cuerpo linpio, e piensa e ama e desea omne el buen amor de Dios e sus mandamientos. […] E otrosí desecha e aborresçe el alma el pecado del amor loco d’este mundo. » De même qu’il est un bon et un mauvais amour, il est aussi une bonne et une mauvaise âme; une âme corrompue et une âme qui peut aspirer au salut. Le péché de l’amour mondain est, bien entendu, l’oeuvre de l’âme corrompue : « Comoquier que a las vegadas se acuerde pecado e lo quiera e lo obre, este desacuerdo non viene del buen entendimiento, nin tal querer non viene de la buena voluntad, nin de la buena [memoria] non viene tal obra; ante viene de la flaqueza de la natura humana que es en el omne, que se non puede escapar de pecado […]. E viene otrosi de la mengua del buen entendimiento, que lo non ha estonçe, porque omne piensa vanidades de pecado […]. E aún digo que viene de la pobredad de la memoria que non está instructa del buen entendimiento, ansí que non puede amar el bien nin acordarse d’ello para lo obrar… »4 On retrouve donc cette dialectique que met en place l’idée verticale de l’amour. Pour que l’amour sacré puisse trouver la place prédominante qu’on veut lui donner il faut rabaisser, écarter son contraire, il faut l’assimiler au néant. Cette dialectique devient beaucoup plus violente dans l’Arcipreste de Talavera de Martínez de Toledo qui se présente, d’une manière plus tranchée que dans le Libro de buen amor, comme une véritable reprobatio amoris. Selon Martínez de Toledo, le seul amour possible est celui que l’on doit à Dieu, affirmation qui est le point de départ de son long sermon contre l’amour mondain : « E por quanto nuestro senior Dios todo poderoso sobre todas las cosas mundanas e transitorias deve ser amado no por miedo de pena, que a los malos perpetua dara, salvo por puro amor e delectacion dél, ques tal e tan bueno ques digno e merecedor de ser amado. »5 L’amour ne se confond plus avec ce timor dominis qu’on peut trouver sous la plume d’autres auteurs religieux. Il n’est ici question que d’amour et de délectation, c’est-à-dire, une terminologie qui pourrait s’appliquer aux formes mondaines de l’amour. L’opposition est donc d’autant plus grande que les deux éléments contraires semblent recourir aux mêmes modes d’expression. L’amour est plaisir, joie, mais celle-ci, loin d’avoir pour objet les délectations matérielles, doit se borner aux délectations spirituelles. D’où cette exclusion sans degrés, ce refus catégorique, chez Martínez de Toledo, de tout amour qui ne soit celui de Dieu : « amar sólo Dios es amor verdadero, e lo ál amar todo es burla e viento e escarnio »6. L’amour mondain est plus que « mauvais », il est purement et simplement du néant; la source directe de tous le maux, « por amar vienen todos los males », ce qu’il essaie de montrer, avec une exhaustivité qui dépasse de loin celle du modèle suivi — le livre III du De Amore — tout le long de la première partie du Corbacho. Pour mieux l’opposer à la « religiosité » de l’amour sacré, Martínez de Toledo, cherche à démontrer comment l’amour mondain en vient à détruire tous les liens sociaux — amitié, famille… —, toutes les normes de conduite prescrites par le droit et la morale, la perfection du corps et de l’esprit — il détruit la santé et le savoir —, mais aussi, bien entendu, comment il s’oppose systématiquement aux dix commandements et accompagne, d’une manière tout aussi systématique, les sept péchés capitaux. Autrement dit, la réprobation de l’amour mondain chez Martínez de Toledo passe par une complète opposition à tout ce qui est véhiculé par l’autre amour, par l’amour sacré
L’amour de Dieu et l’amour pour Dieu
Comme on l’a vu, même une oeuvre telle que le Libro de buen amor tend à mettre en lumière, ne serait-ce qu’implicitement, le fait qu’au Moyen Age la dimension métaphysique de l’amour est première. Comme l’affirme et le répète Martínez de Toledo et avec lui nombre d’auteurs, seul l’amour de Dieu est véritable, authentique; seul cet amour est vraiment fondateur d’un ordre amoureux. Mais quelle est la situation dans la Péninsule au XVe siècle de ces idées qui traversent tout le Moyen Age? Le XVe siècle espagnol est une période assez mitigée pour ce qui est de la spiritualité. Sur le plan théologique, c’est le temps d’un certain ressassement, coincé entre les grands systèmes scolastiques des deux siècles précédents et le renouveau méthodologique et doctrinal qui poindra au XVIe siècle dans les grands centres culturels, à Salamanque et à Alcala. Les universités s’enferment dans des systèmes de pensée d’autant plus sclérosés qu’ils deviennent non pas des contenus d’enseignement mais des « matières » figées d’enseignement, officiellement reconnues dans des « chaires » spécifiques, comme celles de « scotisme » ou de « thomisme » dans l’université de Salamanque et ses différents collèges. La pensée s’institutionnalise ainsi, se fige dans des institutions, c’est-à-dire des ordres religieux et des établissements, de sorte qu’elle en vient vite à tourner à vide sur elle-même. Le lien intime entre la pensée thomiste et l’ordre dominicain au sein du collège de San Première partie : L’ordre amoureux — I. L’amour et le sacré 34 Esteban à Salamanque est un bon exemple de cette clôture doctrinale qui se maintiendra, d’ailleurs, pendant tout le XVIe siècle, jusqu’à faire des collégiens de San Esteban des « frayles dominicos modorros », selon l’expression du Brocense. Le résultat en est que la théologie espagnole au XVe siècle a sans doute affiné certains concepts et approfondi l’étude des scolastiques mais n’a donné lieu à aucun système philosophique nouveau. Et ce d’autant moins que l’Inquisition espagnole, dès le dernier quart de siècle, favorisée dans les universités par des querelles personnelles qui font déjà prévoir les fâcheuses délations du siècle suivant, a été très attentive à tout risque d’hétérodoxie inhérent aux idées « nouvelles » qui pourraient jaillir des chaires. Si le Saint Office n’avait pas été si présent, si vigilant, les universités espagnoles auraient sans doute pu se joindre aux idées nouvelles pré-réformistes qui surgissaient en Europe. Le meilleur exemple de cette entrave imposée par l’Inquisition à tout renouveau doctrinal est celui de l’oeuvre théologique de Pedro de Osma. A partir de 1476, ce docteur en théologie de l’université de Salamanque défend une série de thèses réformistes avant la lettre sur la confession et la pénitence qui rappellent, comme le suggèrent les frères Carreras i Artau11, les théories de Wycliff et Huss. Le Tractatus de confessione d’Osma fit l’objet d’un procès d’inquisition qui réunit vingt-six théologiens pour débattre de l’orthodoxie de cinq propositions d’Osma. On convoqua, en même temps, à Alcala un synode qui devait décider du degré d’hérésie du traité. Dans les deux cas, le résultat fut le même : le traité fut condamné, tous les exemplaires furent détruits par le feu et leur auteur, sur le seuil de sa mort, abjura ses erreurs. Il en va de même pour les textes de divulgation spirituelle. Le XVe espagnol n’est pas un siècle mystique. L’histoire de la mystique espagnole saute souvent de Raymond Lulle à sainte Thérèse et à Saint Jean de la Croix12. Ce manque de mystique contraste, d’ailleurs, avec l’essor, au même moment, de la prédication13. On pourrait même affirmer que ce développement de la prédication est, en quelque sorte, le chaînon qui unit historiquement la mystique médiévale espagnole et celle qui se déploiera au XVIe siècle. Entre Raymond Lulle, écrivain mystique et fervent prédicateur sui generis, et sainte Thérèse, on trouve saint Vincent Ferrier. De ces deux pôles de la spiritualité qu’illustre Raymond Lulle — la mystique et la prédication—, le XVe siècle espagnol a surtout favorisé celui de la divulgation à travers le sermon. Si ce n’est pas un siècle mystique, il est assurément moral, ou plus exactement moraliste. La partie la plus importante de sa spiritualité se confond avec le projet édifiant, des prédicateurs qui implique une vision « sociale » de la spiritualité, en opposition avec l’individualisme monastique de l’expérience mystique. La spiritualité se veut surtout « séculière », près du peuple, des fidèles, de l’ensemble de la société qu’elle doit guider vers Dieu en lui indiquant le droit chemin. Sans doute l’une des raisons du succès de la prédication en cette fin espagnole du Moyen Age a été son côté populaire. On sait que les sermons des grands prédicateurs étaient des événements attendus et intensément vécus par les fidèles, avec ce pathos, ce dramatisme populaire dont parle Huizinga. C’est sans doute cette « popularité » que la mystique moderne, tout particulièrement celle de sainte Thérèse, héritera de la prédication. Il n’en demeure pas moins qu’un tel essor a concentré les efforts des auteurs spirituels, surtout ceux qui relevaient des ordres mineurs, sur les problèmes moraux d’une société jugée décadente et corrompue. Dès lors, dans la question de l’amour spirituel, de l’amour comme fondement des relations entre les créatures et le créateur on s’est souvent contenté de reproduire les grandes synthèses précédentes, du XIIIe et du XIVe siècles, celles qui mêlaient Augustin, Denys et Bonaventure, et la mystique « orientale », judéo-islamique. Comme pour la théologie, le spiritualisme amoureux du cuatrocientos vit du reliquat doctrinal d’époques antérieures sans se poser la question d’un renouveau de ses formes et de ses modes d’expression. Mais, de même que les systèmes théologiques sont affinés et systématisés, l’amantia du XVe siècle connaît une certaine restructuration qui prétend l’insérer dans un système complet de pensée.
PREMIERE PARTIE L’ORDRE AMOUREUX |