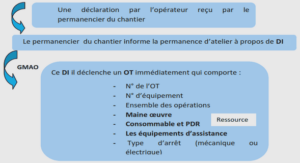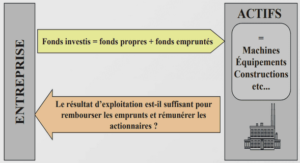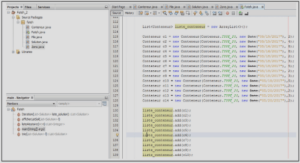Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
De la phénoménologie de HUSSERL
Avec Husserl lui-même « Nous prenons notre point de départ dans un renversement qui eut lieu au tournant du siècle dernier dans l’attitude à l’égard des sciences. Ce renversement, concerne la façon générale d’estimer les sciences. Il ne vise pas leur scientificité, il vise ce que les sciences, ce que la science en générale avait signifié et peut signifier pour l’existence humaine. La façon exclusive dont la vision globale du Monde qui est celle de l’homme moderne s’est laissée, dans la deuxième moitié du XIXème siècle, déterminer et aveugler par les sciences positives et par la « prosperity » qu’on leur devait, signifiait que l’on se détournait avec indifférence des questions qui pour une humanité authentique sont les décisives. De simples sciences de faits forment une simple humanité de fait. »1.
En réalité dans la seconde moitié du XIXéme siècle « les sciences, croit-on généralement, épuisent la totalité de ce qu’il y a de connaissable dans l’être, de sorte que la philosophie, à première vue, se trouve sans objet. Mais, si la science connaît tout ce qu’il y a de connaissable dans l’être, restent les sciences elles-mêmes qui peuvent devenir des objets d’études. A côté de la connaissance de l’être, reste place pour une connaissance de la connaissance, pour une théorie de la connaissance… »2.
En effet, les sciences avaient cloisonné la connaissance scientifique dans le monde expérimental. Celle-ci devenait un savoir des phénomènes c’est-à-dire ce qui est manifeste, de ce qui est là. Et la place vacante revient à la philosophie qui dépasse le point de vue épistémologique pour une réflexion globale sur l’être.
Elle a constitué à la fois un symptôme et une tentative de solution à cette crise. Son essor s’explique par son « effort désespéré ( et certainement pas le dernier) pour résoudre cette crise de l’intérieur en maintenant intacte l’idée d’une philosophie première, d’une enquête fondamentale assurant, dans son déroulement même, sa propre fondation.»1 .
La crise de l’humanité
Husserl a très tôt compris cette tendance de la science à aller vers une perte de sens par la façon dont la raison a été investie dans ces sciences. En effet, la raison a suivi la tendance naturelle de l’esprit humain en s’oubliant dans les œuvres scientifiques. Les sciences considéraient les lois de la pensée comme de simples formes de l’esprit incapables de savoir quelles sont les conditions qu’une connaissance doit remplir pour pouvoir être validée.
Elles ont pris leur propre existence, leur démarche et leur orientation comme relevant de l’évidence c’est-à-dire une vérité qui ne se questionne pas et pire ne permet aucune interrogation. Cette crise est donc marquée par cette limitation de la science aux faits réduisant la vérité à un objectivisme incapable de fournir un savoir solide sur des bases qui soient non seulement sûres et certaines mais également stables.
Il s’y ajoute cette conception du psychologisme ou naturalisme qui construit les lois de la pensée sur la structure de la pensée. Ce psychologisme, en fait, comme source du savoir, a cette particularité d’unir, d’identifier le sujet de la connaissance et le sujet psychologique. Il prétend réduire les conditions de la connaissance vraie aux conditions effectives du psychisme, de telle sorte que les principes logiques garantissant cette connaissance ne seraient eux-mêmes garantis que par des lois de fait établies par le psychologue.
Alors que pour Husserl, il n’y a aucune science qui peut permettre de connaître l’intérieur d’un autre être d’où la négation de la psychologie comme science. Il réfute aussi le naturalisme ce d’autant que, sur notre existence, ces sciences n’apportent pas des réponses adéquates. Elles restent désarmées face aux interrogations brûlantes de cette époque marquée par la guerre qui a fini de monter la fragilité de cette civilisation européenne.
Ce bouleversement du destin de l’Europe a suscité des questions sur le sens ou sur l’absence de sens de toute cette existence humaine . Les sciences en restent aphones, de même que « sur la raison et sur la non-raison, sur nous-mêmes les hommes en tant que sujets… »1.
Devant toutes ces inquiétudes du moment, la science reste muette. Tout ce passe comme si la rationalité scientifique ne pouvait investir l’objet qu’en délaissant les sujets existants, comme si l’établissement des vérités objectives laissait encore plus désemparée dans ses choix et dans ses conduites la liberté humaine . Ainsi « dans la détresse de notre vie …cette science ne signifie rien pour nous. Elle exclut par principe justement ces problèmes qui sont les plus brûlants pour les hommes de notre malheureuse époque, exposés sans défense à des bouleversements mettant en question leur destin : les problèmes du sens ou du non-sens de toute cette existence humaine. Ces problèmes qui se posent d’une façon générale et nécessaire pour tous les hommes, n’exigent-ils pas aussi des réflexions générales et des connaissances rationnelles pour leur solution,… ? »2. Pour Husserl, la crise reste une manifestation de l’éclatement du monde scientifique. En effet ce « monde de la science, tel que la science le constitue et le voit, s’est détaché du monde de la vie (Lebenswelt).»1. Il affirme dans ses Ideen que : « pure-(…)- n’est pas une psychologie »2, parce que différente des explications psychologiques qui entraînent l’objectivité dans un subjectivisme relativiste.
La phénoménologie diffère de la psychologie « aussi important que soit le rôle méthodologique auquel la phénoménologie doit prétendre à l’égard de la psychologie »3 concernant surtout les fondements, même si cette science avance des prétentions philosophiques se voulant une science fondamentale de l’esprit et différente des sciences positives. La crise interpelle, de ce fait, aussi bien le domaine scientifique et philosophique à travers la considération de toutes ces conceptions. Ce d’autant plus que la science avait, comme nous l’avons souligné plus haut portée par ses résultats, pris une orientation positiviste radicale sans concession à la subjectivité transformant l’homme en objet.
Toute la vérité scientifique, objective, se résume à la manifestation du monde, aux faits. L’objectivisme ou le naturalisme avait réduit la connaissance aux savoirs mathématisés de la nature matérielle. Cette orientation, en la personne de Kant, avait son défenseur. En effet, pour lui, le savoir concerne les phénomènes, l’homme étant incapable de porter sa connaissance au noumène. Il établit, comme chez Platon, une séparation ontologique des objets de la connaissance. La connaissance est confinée au monde phénoménal, le monde nouménal en tant que connaissance de la réalité en soi, n’est pas, selon lui, à la portée de la raison humaine.
Il n’y a chez Kant de connaissance que celle objective scientifique, la raison qui s’investit dans un autre champ est en situation de se fourvoyer. La philosophie s’en est dès lors résolue à abandonner toute ambition de penser le réel dans sa totalité et son fondement se présentant en une pluralité de conceptions arbitraires et subjectivistes donc relativistes. La science en a perdu, en définitive, sa signification vitale en occultant la question du sens de sa pratique, de son fondement et de sa finalité.
Ainsi nous dit Husserl dans l’introduction des Méditations : « Du point vue de l’unité scientifique, la philosophie occidentale est, depuis le milieu du siècle dernier, dans un état de décadence manifeste par rapport aux âges précédents.»1. Et cela « qu’après s’être brillamment développées pendant trois siècles, ces sciences se sentent aujourd’hui entravées dans leurs fondements mêmes. »2 poursuit-il. En fait, la crise des sciences reste une crise de l’orientation positiviste de la science contemporaine.
Aussi sa phénoménologie sera, selon Merleau-Ponty, un effort philosophique destiné dans son esprit à « résoudre simultanément une crise de la philosophie, une crise des sciences de l’homme et une crise des sciences tout court,… »3. Autrement dit, la réflexion sera axée dans le champ scientifique, même si, la crise ne concerne pas la science dans ses succès théoriques et pratiques mais touche la signification de la vérité. Elle est autant une crise des sciences qu’une crise de la vie parce qu’elle pose un problème de fondement de la science dans lequel nous pouvons y voir un problème de fondement de la vie étant donné que la science soustend pour beaucoup les piliers de notre existence et de la façon dont nous comprenons ce monde qui nous entoure.
La conception positiviste qui régnait à cette période avait ignorait toutes les questions métaphysiques qui, elles, prenaient en compte ces problèmes de sens de la vie, lequel sens était à restaurer. Elles exprimaient « soit implicitement soit explicitement dans leur sens les problèmes de la raison, de la raison dans toutes ses figures particulières. »1. D’où leur revendication d’une dignité plus élevée que celle de la science des faits qui, en fait, est subordonnée à elle dans l’ordre des interrogations. En réalité, le positivisme sonnait la mort de la philosophie.
Dès lors prenant en charge les questions d’être la métaphysique se pose comme la science des questions ultimes et les plus hautes devenant, de fait, reine des sciences dans un esprit qui confère « leur sens ultime à toutes les connaissances, celles de toutes les autres sciences. »2. S’il a fallut revenir à une humanité nouvelle, avec un esprit hautement rétabli, c’est du fait de la perte chez l’homme de l’élan de la philosophie universelle et de son idéal. En fait, la philosophie était devenue elle-même problème, avec la question de la possibilité de la métaphysique qui met en cause, dans son ensemble, le sens implicite et la possibilité de la problématique rationnelle.
Dans sa tentative de solution, Husserl va réactiver le doute cartésien qu’il investit comme attitude de remise en cause de ce qui va de soi. Toutes les connaissances jusque là jugées apodictiques vont être remises en question pour tester leur légitimité par l’entreprise du doute comme méthode opératoire de vérification de la scientificité des savoirs déclarés.
En effet, « l’existence du monde, fondée sur l’évidence de l’expérience naturelle, ne peut plus être pour nous un fait qui va de soi ; elle n’est plus pour nous elle-même qu’un objet d’affirmation ( Geltungsphänomen ). »1.
Il convient donc d’opérer un retour au problème de l’idéal d’une philosophie authentique et de sa méthode. Cela devient nécessaire pour la seule raison que « la crise de la philosophie a la signification d’une crise de toutes les sciences modernes…»2parce qu’elles participent toutes à l’universalité philosophique. A cet effet, « pour sauver le savoir, pour permettre à la raison de s’épanouir dans l’acte de la connaissance, il faut enraciner cet acte dans un sol non mouvant. Or un tel sol ne peut être fourni que par la philosophie phénoménologique attendue comme « science des essences », elle-même ancrée dans un sujet transcendantal »3 d’après Delacampagne.
Ainsi face à la naïveté d’une science soit disante apodictique, il revient à la phénoménologie la tâche, celle plus spécifiquement phénoménologique, « de donner à la science une forme nouvelle et supérieure. »4.
Car si la vie peut, quant à elle, se contenter d’évidences et de vérités relatives pour ses fins relatifs et variables, la science, elle, pour pouvoir être jugée comme telle doit s’atteler radicalement à produire pour la postérité « pour toutes et pour tous, définitives ,… »5, et pour ce faire, elle procède à des « vérifications nouvelles et ultimes ».
La phénoménologie de Husserl
Née d’une réflexion sur la crise des sciences, la phénoménologie apparaît comme une nouvelle méthode de connaissance positive pour les philosophes et chercheurs lassés de l’étroitesse des perspectives du positivisme et méfiant à l’égard des systématisations métaphysiques. Elle a voulu trouver des réponses à cette crise multiforme et multidimensionnelle en reposant un projet refondateur qui restaure la pensée du sens dans la réflexion philosophique en tant qu’exigence de fondement de nos savoirs et pratiques. Pour Husserl, le monde est la somme des objets d’une expérience possible et d’une connaissance possible par expérience, la somme des objets qui, sur le fondement de l’expérience actuelle, peuvent être connus dans le cadre d’une pensée théorique correcte.
La phénoménologie se construit donc dans un processus par lequel la conscience découvre son sens et se pose comme une tentative de ramener la philosophie à sa tâche originelle qui consiste dans la question du sens de l’homme et de son existence conformément à son but général qui est de donner aux sciences un fondement absolu. Et ce dessein, malgré les bouleversements, est resté le même et le terme de fondement est pris ici dans toute son acceptation. Cette quête d’un fondement est, en fait, ce que lie Husserl à Descartes. Ils en arrivent à la même conclusion prenant l’être comme le point de départ suprême pour toute science. Bien que pour y arriver, ils ont cheminé différemment et ont présenté l’être de manière tout à fait opposée. La phénoménologie de Husserl ne consiste pas à un renouvellement de la pratique des sciences humaines mais elle leur offre un fondement pour leur apodicticité d’où son aspect métaphysique et rigoureusement scientifique.
Elle ne se veut pas la profondeur mais la vérité ; autrement dit, la vérité absolue et refuse d’être une suite de réflexions plus ou moins profondes sur l’âme ou sur la connaissance : «La phénoménologie ne s’intéresse ainsi ni aux faits ni à leurs causes. Elle cherche à apercevoir des raisons et à comprendre des significations.»1dira Berger. Avec la phénoménologie, la réflexion est orientée vers la recherche de solutions de sortie à ce bouleversement scientifico-philosophique.
Au fond, juge Husserl « Le naturalisme empiriste procède -nous devons le reconnaître- de motifs hautement estimables. C’est, du point de vue méthodologique, un radicalisme qui, à l’encontre de toutes les « idoles », des puissances de la tradition et de la superstition, des préjugés grossiers et raffinés de tout genre, fait valoir le droit de la raison autonome à s’imposer comme la seule autorité en matière de vérité. »2.
Par conséquent, la phénoménologie husserlienne se présente comme une démarche de recherche, dotée d’une méthode efficiente, et se veut un savoir édifié sur des évidences absolues et capable de penser le monde comme une totalité. Elle est, dira Husserl en fondateur, une philosophie en tant que « science rigoureuse », c’est-à-dire « une science réalisée en vertu d’évidences dernières tirées du sujet lui-même et trouvant dans ces évidences sa justification absolue . »3.
Elle évite les spéculations et théories a priori préférant tirée ses conclusions à partir d’un examen du réel. Il y a donc, dans la phénoménologie, l’idée d’un objet en face de soi et sur lequel porte la réflexion.
Selon Hegel : « la vérité de la conscience est la conscience de soi, et celle-ci est le fondement de celle-là de telle sorte qu’aussi toute conscience d’un autre ob-jet est en même temps conscience de soi. »1 montrant l’idée de quelque chose en face de soi dans le savoir.
La phénoménologie trouve sa source dans l’antimétaphysique indéniablement. S’inscrivant « contre les systèmes, elle préconise une méthode différente de toute spéculation ou construction métaphysique. »2en d’autres termes, elle reste un réalisme métaphysique intempérant. La phénoménologie s’installait donc dans une zone métaphysique neutre, celle où « les choses mêmes, avant toute intervention de l’esprit, se montrent et se donnent elles-mêmes. »3. Ainsi tendant vers un objectif de fondation d’une science véritable, Husserl joue la prudence en affirmant : « aucun jugement , si je ne l’ai puisé dans l’évidence, c’est à dire dans des « expériences » où les « choses » et « faits » en question me sont présents « eux-mêmes »… »4 ne peut être tenu comme
valable.
Toutefois, la phénoménologie n’est pas un phénoménisme concevant le phénomène comme seul réalité. Chez Husserl, le phénomène n’est pas différent de l’être, il n’est pas une chose pour nous en face d’une chose en soi ni non plus une moindre réalité, ni une apparence, ni une simple représentation. Le phénomène est ici ce qui se manifeste immédiatement dans la conscience. En fait, la phénoménologie installe la réflexion dans le rapport du monde et de la conscience ou sujet, de la façon dont celui-ci se présente à la conscience et de la manière par laquelle celle-ci saisit cette manifestation.
Autrement dit, c’est une philosophie pour laquelle le monde est toujours « déjà là » avant la réflexion comme une expérience inaliénable et dont tout l’effort est de retrouver ce contact naïf avec le monde pour lui donner enfin un fondement voir un statut philosophique. Husserl, dans l’introduction des Ideen, montre son particularisme en ces mots : « La phénoménologie pure à laquelle nous voulons ici préparer l’accès, en caractérisant sa situation exceptionnelle par rapport aux autres sciences, et dont nous vous voulons établir qu’elle est la science fondamentale de la philosophie, est essentiellement nouvelle ;… »1 . Elle est une philosophie qui replace les essences dans l’existence et ne pense pas qu’on puisse comprendre l’homme et le monde autrement qu’à partir de leur « facticité ». Elle dépasse tout ce que le mot de phénomène a laissé entendre, jusque là, posant une autre attitude toute différente qui va changer le sens de ce terme d’une manière plus déterminée que celle dont les sciences nous le présentaient. La phénoménologie se laisse pratiquer et reconnaître comme une manière, comme un style, elle existe comme mouvement, avant d’être parvenue à une entière conscience philosophique. Elle est l’essai d’une description directe de l’expérience telle qu’elle est et sans aucun égard à sa genèse psychologique et aux explications causales qui peuvent en être fournies. Au préalable pour « comprendre ces modifications, ou, pour parler plus exactement, réaliser cette attitude phénoménologique, élever par la réflexion au niveau de la conscience scientifique ses caractères propres et ceux de l’attitude naturelle, c’est la première tache et non la plus facile à laquelle nous devons satisfaire pleinement si nous voulons prendre pied dans le domaine de la phénoménologie et acquérir de son essence propre une certitude scientifique. »2 précise Husserl. Dès lors pour lui toute théorie de la connaissance, si elle se veut véritable et douée de sens, doit se conformer aux exigences phénoménologiques et transcendantales du savoir en tant qu’elles constituent les caractères nécessaires de la philosophie. Husserl inaugure une nouvelle méthode dite phénoménologique qu’il conçoit comme l’instrument par excellence du philosophe qui tente de retrouver les significations fondamentales du réel.
Table des matières
Introduction
PREMIERE PARTIE : De la phénoménologie de Husserl
Section 1 : La crise des sciences
Section 2 : la phénoménologie husserlienne
DEUXIEME PARTIE : La méthodologie husserlienne
Section 1 : Le doute cartésien
Section 2 : La démarche husserlienne
TROISIEME PARTIE : Le cogito de Husserl
Section 1 : L’épochê phénoménologique
Section 2 : Les aspects du cogito de Husserl
Sous-section : a – Le cogito-cogitatum
Sous-section : b – L’intersubjectivité
Conclusion