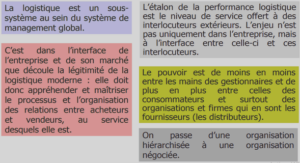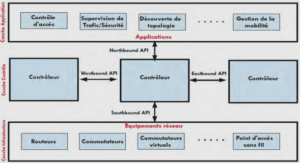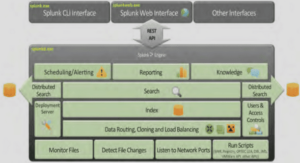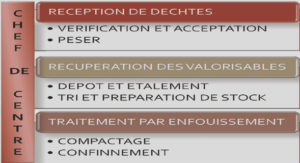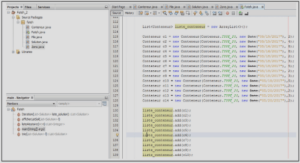Un monde à multiples facettes
Peut-être serait-il banal de faire le constat que nous vivons dans un monde où il n’est question que du libéralisme économique triomphant, de la globalisation des échanges commerciaux multiformes et du processus d’une mondialisation plurielle touchant et bouleversant tous les aspects de la vie des hommes en ce début du XXI siècle.
De même serait-il encore plus banal de rappeler qu’avec l’explosion des technologies de la télécommunication, de la télévision et des transports aériens, l’appréhension de cette mondialisation néolibérale plurielle dominante est essentielle pour comprendre et dépeindre le paysage de notre monde actuel caractérisé fondamentalement par la complexité et l’incohérence de ses manifestations mais aussi par une déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles dont , principalement, le rôle et les fonctions de l’Etat.
Une autre caractéristique en est l’émergence371 progressive de nouveaux entrants dans le circuit de la consommation et de la production capitaliste à l’occidental à savoir les puissances dites « Pays émergents ou BRICS372 ) au moment où, paradoxalement, la crise « La logique de la mondialisation met notre diplomatie à l’épreuve, et l’oblige à être inventive.
Il importe, certes, de moderniser notre action culturelle extérieure, à commencer par notre superbe réseau de lycées, collèges et écoles françaises à l’étranger, au formidable potentiel d’influence. Mais l’influence se joue aussi ailleurs en ces temps de diplomatie globale : elle s’appuie de plus en plus sur les acteurs de la société civile, sur une capacité d’anticipation, de mobilisation et de travail en réseau. C’est davantage de l’attention portée et des moyens donnés aux marchés d’expertise, aux think tanks, aux échanges scientifiques et universitaires, à la formation des élites, à l’innovation, à la communication par Internet, à notre présence dans les réseaux internationaux de toutes sortes que dépend l’excellence de la diplomatie française ».
Institute et auteur de « Le renversement du monde – Politique de la crise » (Gallimard, 2010), l’émergence ici soulève de « redoutables trompe-l’œil » et n’est , en fin de compte, qu’une simple « inscription d’une économie dans les conventions du libéralisme financier anglo-américain » ce qui revient à dire que l’ émergence n’ est autre qu’un « commerce de la souveraineté » : « Qu’en est-il d’une émergence basée sur la vente d’éléments de souveraineté et d’éléments du patrimoine national ? Qu’en est-il d’une émergence basée sur le commerce de ressources manifestement non renouvelables ? ». (Extraits de l’intervention d’Hervé Juvin, Président d’Eurogroup Institute au colloque du 10 décembre 2012 « Les Etats émergents : vers un basculement du monde ? », organisé par la Fondation Res Publica financière de 2008 perdure à secouer les membres les plus fragiles de l’Union européenne, ceux que l’on a surnommés les PIIGS373.
Face à l’enchevêtrement des faits et à l’incohérence du monde où nous sommes englués de nos jours, et voulant tenter de dégager les concepts qui pourraient aider à mieux appréhender les enchainements tout en séparant l’accessoire de l’essentiel, Jacques Lesourne374 nous indique que trois regards possibles sont à porter sur le monde d’aujourd’hui et à chaque regard correspond un type de problèmes de ce monde :
▪ Le premier regard pose un œil de manière globale sur la Terre. Ce regard de cosmonaute a la capacité de cerner un premier type de crise : celui de la détérioration de l’environnement, du changement climatique et de leurs conséquences inévitables sur les diverses ressources terrestres et par conséquent sur l’avenir même de l’Humanité375.
▪ Le second regard est porté sur l’organisation des civilisations, sur le rôle de l’Etat par rapport à la société ou sur les accords et autres relations complexes entre Etats ou entre Etats et marchés. Ce regard de sociologue-anthropologue observe à la loupe le monde des humains telle une fourmilière.
▪ Quant au troisième regard, il étudie le « glissement des plaques politiques ». Ce regard de géographe-géomorphologue observe l’évolution des pôles d’influence, un type de changement comparable à la tectonique des plaques terrestres. Il constate que le monde est passé d’un système bipolaire (régi par deux grandes puissances, l’ex-URSS et les Etats-Unis) à un système unipolaire, pour aujourd’hui tendre à devenir non-polaire ou multipolaire (Etats-Unis, UE, BRICS en tant qu’acteurs majeurs). Ce monde multipolaire se met donc lentement et difficilement en place. Les négociations sont en cours, et des avancées sont à noter : L’entrée de la Chine dans l’OMC376, sa signature du protocole de Kyoto, l’avènement du G20 réunissant tous les grands de ce monde (dont l’Inde, l’Arabie
jour, dont les expressions manifestes sont l’augmentation du revenu moyen, la modernisation des activités, la part dans les échanges mondiaux » Saoudite, le Brésil, la Chine) et finalement l’adhésion de la Russie à l’OMC377 avec sa présidence du G20378. Cette multipolarité encore en gestation de nos jours (2012) nécessitera un nouveau paradigme de compréhension, d’organisation et de gestion.
Un monde en transformation continue
Depuis la chute du mur de Berlin et la dislocation du bloc soviétique mais surtout depuis le 11 septembre 2001 puis la double invasion « illégale » de l’Afghanistan et de l’Irak (2001/2003) , le monde est entré dans une période de « turbulence généralisée » que M. Alain Joxe379 qualifie de « période mutatoire » remettant en question tous les aspects du monde hérité de la Deuxième Guerre Mondiale et de l’équilibre fragile hérité de la bipolarité EU/URSS. C’est aussi un ordre mondial en transformation constante dont le centre se déplace progressivement vers l’Asie et vers les États « émergeant » susceptibles de menacer la suprématie économique des pays développés et par là remettre en question le « modèle occidental » de développement : « la crise financière de 2008 et la récession internationale qui l’a suivie n’ont donc pas, loin de là, provoqué cette dérive géopolitique, mais elles l’ont révélée plus clairement 380».
Ainsi, la fin de la Guerre froide entre les deux blocs Est/Ouest a eu globalement pour effet immédiats deux conséquences majeures :
▪ D’une part, ledéclenchementdela déconstruction systématique sinon de l’obsolescence de nombreux concepts et certitudes juridiques, politiques ou organisationnelles qui semblaient définitivement acquis après un long processus d’élaboration et à la suite de bien des péripéties parfois dramatiques: Nation, Etat souverain, droit international, , Système onusien mais aussi solidarité et coopération internationales avec tous les codes de valeurs et tout l’arsenal juridique national ou international constitué autour de chaque concept. C’est aussi la remise en question des Relations internationales traditionnelles élaborées et établies entre les Etats depuis la consécration du système westphalien consigné dans le droit pratiqué dans les divers organes et institutions des Nations Unies. A titre d’illustration, ce fait s’est clairement révélé dans l’intervention américaine en Irak et son occupation en avril 2003, signe certain d’un dédain envers le droit, la légitimité, la souveraineté et indice d’un début du retour hégémonique de la force. Le système internationaliste onusien se trouve alors en décrépitude.
▪ D’autre part, malgré la tendance générale à la globalisation (ou bien, en réaction à cette globalisation), il y a résurgence de certains concepts qui, pensait-on, étaient à jamais révolus ou tombés en désuétude : appartenances à une culture, à une ethnie, à une région, à une confession, à une secte ou encore à une communauté quelconque ayant ses particularités propres. Revanche du culturel ? Revanche de la société ? Revanche du territoire et du terroir ?
De même, il y a résurgence des origines, des racines, des filiations ou des mythes du passé. Le social se trouve ainsi implosé, fracturé et atomisé en individualités engluées dans de multiples réseaux et soumises à des valeurs mercantiles et marchandes.
Paradoxalement, à ce niveau, une tendance est alors à relever, engendrée par ce processus multiforme qu’est la mondialisation enclenchée en tant que « système- monde » caractérisé essentiellement par la globalisation du Marché (expansion totale, sans limites ni obstacles) et par l’éclatement, l’effritement ou l’effacement des « frontières », géographiques et juridiques, tant devant les marchandises que devant les capitaux (mais pas devant les hommes !).
Cette tendance à caractère socio-culturel est un phénomène de « réancrage » des individus en tant que tels, isolément, dans leur « localité » (spatiale, ethnique, culturelle, confessionnelle ou communautaire). Sous le choc de cette mondialisation en marche, véritable déferlante « niveleuse », des micro-identités reémergent partout. Il semble même que plus la marchandisation généralisée se répand à travers le monde, plus les hommes, par réaction, tendent à vouloir se recroqueviller sur leurs racines : langue, ethnie, culture, religion ou communauté. Il y aurait même, parait-il, concomitance entre cette extension-expansion du Marché et la réapparition de certaines formes délinquantes de comportement (individuelles ou collectives) qui étaient en déperdition auparavant : violences, génocides, racismes, intégrismes, religiosité, ou mercenariat à tel point qu’on évoquerait avec Eric Delbecque : « Une sorte de reféodalisation du monde. C’est-à-dire à un affaissement du collectif, donc du politique, au profit d’intérêts particuliers ou privés, par un double effet de dissolution due à l’extension du marché d’une part, à la montée des communautarismes – voire du tribalisme – de l’autre. Cette dynamique qui s’observe à l’échelle internationale et traverse bon nombre de pays n’est pas nouvelle : elle est au cœur de la construction des Etats modernes, il y a à peine plus de deux siècles. Il nous revient de nous en souvenir »381.
On constate alors un regain de violence, un recours à la force et, parallèlement, une déchéance ou un mépris pour le droit. L’acquis de cinquante ans de réglementations internes ou de droit international se trouve bafoué et balayé par l’utilisation injustifiée de la force. C’est une ère de délinquance internationale qui commence à s’institutionnaliser doublée d’un relâchement sinon d’une dépréciation, à la limite de l’indifférence, envers toute action de solidarité internationale.
La revanche des territoires ?
Une autre tendance constatée, à caractère politico-économique, est une autre forme de réancrage. Il s’agit plutôt, penserait-on, à un antidote aux maux et dérapages de la globalisation néolibérale, d’un recentrage correctif sur les économies régionales, nationales ou même « territoriales ou locales » à tel point que certains comme Ali Sedjari382 et Pierre Calame383 dans les œuvres desquels il est question d’un inévitable « retour au territoire» et même d’une « revanche des territoires384 ». Des stratégies de projection à l’international deviennent ainsi partie intégrante des processus de gouvernance territoriale ayant pour objectif de fédérer acteurs publics et privés autour d’une vision commune cherchant à promouvoir le territoire.
Une autre tendance d’obédience écologique préconise aussi un « retour au terroir 385 », alors que, dans le cadre de l’action menée par « Alternatives Sud », certains comme Jean-Philippe Peemans386 parlent d’une « reterritorialisation des conditions du développement des peuples et de leur bien-être ».
Ainsi une « Initiative internationale pour repenser l’économie (IRE)» est initiée avec pour mission de « favoriser l’émergence de nouvelles propositions dans le domaine économique387 ». Se focalisant fondamentalement sur cinq grands thèmes (la monnaie et la finance, les agencements institutionnels, la régulation des biens et des services et le rôle des territoires), l’IRE considère que la globalisation, irréversible, est certes à la fois facteur de croissance et source de différenciation sociale à l’intérieur des sociétés sans pour autant que la relocalisation des échanges et le retour au protectionnisme soient l’unique réponse. Encore faut-il repenser la problématique de l’économie autrement que comme dichotomie opposant « l’enfermement dans l’autarcie locale » et l’ « insertion sans précaution dans un marché mondial indifférencié ».
De nos jours, toute gouvernance se devant de s’exercer à différents niveaux, du local au global, et aucun problème de la société ne pouvant se traiter à un seul niveau, l’économie elle aussi se doit de se réarticuler elle-même afin de reconsidérer et de traiter le marché des échanges selon le paradigme d’un réancrage spatio-géographique « aux multiples relations qui s’organisent à l’échelle des territoires » qui peuvent (et doivent) ainsi incarner le rôle d’acteurs pivots autour desquels se penseraient et s’organiseraient les relations entre l’économique, le social et l’environnement (outils de description des relations, modalités d’action, formes de coopération à envisager entre acteurs).C’est donc là une autre vision multidimensionnelle du territoire qui permettrait d’harmoniser la compréhension et les possibles agencements institutionnels des relations de tout territoire avec l’Etat mais aussi avec les multiples autres acteurs, à différents niveaux, intervenant dans le contexte de la mondialisation.
Est-ce à dire pour autant que la mondialisation/globalisation a atteint ses limites optimales ? Devrait-on se mettre en retrait de ses processus, décréter la « démondialisation » et faire marche arrière vers des politiques protectionnistes ? Devrait-on proclamer la décroissance ?
Transformation des enjeux de la coopération internationale
Au cours des deux dernières décennies, l’évolution du monde a donc engendré un système international dont les multiples composants sont à la fois excessivement interdépendants et très hétérogènes. Contexte dans lequel il devient de plus en plus compliqué de fixer et d’appliquer les règles du jeu au niveau international car les divers problèmes concrets qui se posent aux niveaux politique, sécuritaire, économique et en matière d’environnement et de développement ont provoqué de profondes transformations dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale appelant des comportements nouveaux et des décisions politiques à la mesure de trois enjeux fondamentaux :
▪ situer les questions de développement dans un contexte général marqué surtout par la mondialisation des échanges économiques et financiers tout en incluant la réflexion sur le développement durable ;
▪ améliorer la réponse des coopérations par une meilleure écoute des besoins et de la demande des sociétés civiles et des collectivités locales des Etats partenaires ;
▪ articuler les différents niveaux de toute action de coopération ou de solidarité :
– Public/ privé
– Local /national /régional /mondial
– Non-gouvernemental /gouvernemental – Bilatéral / multilatéral.
Dans cette optique, les nouveaux enjeux de la coopération pour la solidarité internationale consisteraient essentiellement à redéfinir l’action internationale dans une meilleure articulation entre les différents acteurs en action : la société civile, les collectivités territoriales, les structures de l’État, les institutions régionales et internationales. C’est la raison pour laquelle on ne peut comprendre les enjeux actuels de la politique de coopération franco-marocaine en général et ceux particulièrement de la coopération décentralisée reliant les entités territoriales des deux pays sans faire , au préalable, un détour par les mutations et tendances majeures en matière de politiques de coopération pour le développement et la solidarité à l’échelle internationale après la guerre froide résultant de la rivalité des deux blocs Est/Ouest et qui auront un impact certain sur les revenus nationaux bruts (RNB) respectifs des pays de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 388 et par conséquent sur les montants financiers totaux et les proportions que ces pays consacrent à l’Aide publique au développement (APD) entre le début et la fin des années 90.