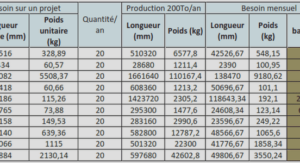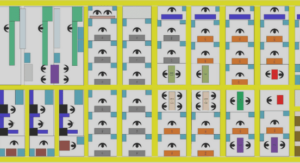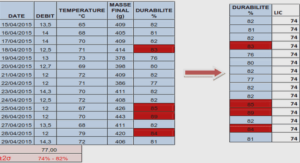La survie de la fonction ministérielle : une problématique circonstanciée en fait et en droit
« La révolution, imminente dans presque toute l’Europe, éclate en France parce que l’Ancien Régime y est plus usé et en même temps plus insupportable, plus détesté et plus facile à détruire qu’ailleurs ; parce que le gouvernement a rendu nécessaires des réformes qu’il est incapable d’accomplir ; parce que le pouv oir, impuissant à diriger l’opinion, n’a plus la force de la réprimer ; parce que la déroute de ’autoritél accompagne la banqueroute des finances ; parce que les changements semblent inévitables, et que toutes les avenues s’ouvrent aux novateurs ; parce qu’enfin les doctrines de la philosophie, plus populaires qu’en tout autre pays, ont pénétré davantage la nation et sont plusconformes à son génie »609. Cette vision romancée des circonstances de la chute de l’Ancien Régime pèche par ses accents manichéistes. Elle identifie les anciens méchants : un « Ancien Régime » « insupportable »et son « gouvernement » « impuissant »; elle désigne es nouveaux héros : les « philosophes » dont les écrits « novateurs » ont inspiré à la Révolution française les caractéristiques propres à son « génie », soit une conception éclairée de l’homme, de la société, de l’État en général. Au final, elle gagne en clarté historique ce qu’elle perd en réalisme politique et juridique. Car, il est un domaine sur lequel l’ esprit du siècle610 a pu difficilement étendre son emprise tout au long de la période révolutionnaire: celui des relations extérieures. A ce titre, la reconduction à son poste du dernier ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, le comte de MONTMORIN SAINT-HEREM, manifeste ostensiblement le souhait des « Patriotes » d’inscrire l’action internationale de la France pos t-monarchique dans une logique de continuité.
La régénération des fondements constitutionnels dela politique étrangère entreprise entre 1789 et 1791 participe d’un remarquable effort de conciliation entre le passé monarchique et le présent démocratique du chef du Département. Loin d’être évincé de la gestion de la politique extérieure comme pouvait le laisser croire le contexte réactionnaire décrit par le Professeur Albert SOREL, le ministre des Affaires étrangères est maintenu en l’état par les Révolutionnaires. Mais, qu’on ne s’y trompe pas : dans le contexte de crise diplomatique qui caractérise l’Europe de la fin du XVIIIème siècle, la bienveillance de l’Assemblée législative est dictée moins par un devoir de mémoire que par des considérations géostratégiques Paragraphe( 1). Pénétrée de sa mission fondatrice, l’Assembléeonstituantec se veut moins conciliante, car toute son attention est cristallisée autour de la démystification des pouvoirs internationaux du Roi. A ce titre, elle reconduit le ministre dans son rôle historique de commis du Pouvoir monarchique mais, à travers la personne du Roi, elle le contraint également à composer avec un nouvel acteur des relations internationales de la France, à savoir l’Assemblée représentative des intérêts du nouveau souverain qu’est le Peuple. La dualité du lien d’autorité qui lie désormais le ministre au Pouvoir politique suprême a été diversement appréciée en doctrine.rtainsCe auteurs l’ont interprétée comme une condition anticipée de la politisation de son rôle instrumental. Sur ce point, la pratique institutionnelle observée entre 1789 et août 1792 a souvent abondé dans le sens de leur analyse sans qu’elle ne parvienne, toutefois, à inf léchir le constitutionnalisme moderne. La définition restrictive que les premiers textes constitutionnels retiennent de la fonction de ministre des Affaires étrangères participerait, de ce point de vue, à la conciliation de la tradition monarchique et modernisme démocratique en matière diplomatique (Paragraphe 2).
La survivance de la fonction de ministre des Affaires étrangères : une problématique circonstanciée en fait et en droit
S’interroger sur les circonstances de la survie de la fonction de ministre des Affaires étrangères à la Révolution, revient à prendre le pouls des principaux acteurs politiques de la Révolution, et donc à s’intéresser à l’atmosphère idéologique dans laquelle ils évoluent . Ce rapport de cause à effet semble justifié par l’influence déterminante que les écrits des Lumières ont eue dans la survenance de la chute de l’Ancien Régime. Difficile, en effet, d’évoquer la Révolution sans que spontanément des omsn comme ROUSSEAU, VOLTAIRE, XVIIIème siècle ont porté au système de la monarchie administrative développée à partir de Louis XIV. Lorsque l’on connaît l’impact que cette pratique gouvernementale a eu sur l’autonomie relative concédée au secrétaire d’Étatsous la Monarchie absolue, on ne peut manquer de s’interroger sur l’incidence d’une confr ontation entre l’ esprit du Siècle et la figure classique du ministre des Affaires étrangères. La démocratisation du régime emporterait-elle une brutale remise en cause du monopole que le cardinal RICHELIEU avait aménagé en sa faveur à partir de 1626 615? Le fait que l’expression « esprit du siècle » renvoie traditionnellement au mouvement réactionnaire incarné par les auteurs des « Lumières » induit-il une signification particulière pour les juristes?
A première vue, cette formulation semble plus familière aux historiens et aux politologues. Ils trouvent, en effet, leur compte dans l’étude de l’activisme philosophique qui prévaut sous le règne de Louis XVI, en tant qu’il ournitf les bases théoriques du renversement de régime opéré à l’été 1789. Il ne serait, donc,aspexagéré de considérer les pamphlets du XVIIIème siècle comme les sources d’inspiration de la conception moderne – comprise au sens de « conception démocratique » – du pouvoir politique617. C’est en ce sens, a priori, que l’on doit comprendre l’affirmation du Professeur Albert MATHIEZ, historien spécialiste et non moins controversé de cette période, selon laquelle« la Révolution a été dans les esprits » avant de se concrétiser dans les faits. Les juristes, pour leur part, ne risqueront sans doute pas à mettre en cause la pertinence d’une telle asserti on compte tenu de la dimension 619 ou encore de éminemment libérale des premières déclarations derincipe révolutionnaires la retranscription constitutionnelle du « principe de spécialisation » des pouvoirs .
On est donc tenté de ramener le fameux esprit du siècle au souffle insurrectionnel qui anime Paris et les provinces à partir de 1787. L’hostilité manifeste des Lumières à l’égard du système ministériel augurerait, alors, d’un destin funeste pour « la charge dirigeante d’où [est sortie] les premiers ministres »621 qui ont contribué par leurs hauts faits politiques et diplomatiques à la consolidation de la puissance mo narchique (A). Toutefois, dans le domaine spécifique des relations extérieures, la pratique monarchique semble conférer un caractère très atténué à l’esprit du siècle. La crise diplomatique dont hérite l’Assemblée législative à l’été 1789 ne serait pas étrangère à cet infléchissement.Elle la conduit à placer les contraintes géopolitiques au-dessus des libelles philosophiques. Peu lui importe alors « l’ignorance »622, étranger dès lors qu’elle les maintient sous son contrôle ( B). Bien que fortement déterminé par des arrières-pensées politiques, la permanencede la fonction de ministre des Affaires étrangères suscite, au plan juridique, une réflexion sur l’émergence de garanties coutumières propres à transcender l’idéologie contestataire en matière d’action extérieure C().
Une fonction a priori incompatible avec la conception démocratique du pouvoir : les Affaires étrangères à l’épreuve de l’esprit du siècle
En 1789, le devenir du ministre français des Affair es étrangères est l’enjeu d’une conciliation a priori improbable entre une autorité monarchique qui s’essouffle et un esprit du siècle hostile aux traditions et aux conformismes héritésdu haut Moyen Age. Les critiques de l’intelligentsia française mettent spécifiquement en relief la pratique arbitraire et despotique des ministres. La majorité des auteurs « éclairés »y voit la source principale des dérives du régime monarchique. On aurait, donc, tort de faire des pères spirituels de la Révolution les dignes héritiers de la mouvance réactionnaire des «Monarchomaques » à laquelle était en butte Henri III et ses légistes . L’analogie est, pourtant, tentante au regard du contexte de crises qui alimente les pamphlets des Lumières. Les tensions et les enjeux politiques qui les animent628 ne sont pas sans rappeler ceux qui avaient présidéà l’institution de la charge de secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Mais, précisément, parce que la gestion des crises intérieures n’échoit plus, depuis 1626, au ministredes Affaires étrangères à quel titre sa fonction se trouverait-elle mise en cause, à la vei lle de la Révolution?
287. A priori éloignées de l’épicentre de la crise qui agite lepouvoir monarchique, les relations extérieures ne manquent pas d’attirer l’attention des Lumières. Deux raisons peuvent expliquer leur intérêt pour la « chose publique extérieure » : d’une part, le cycle de révolutions inauguré à l’échelle internationale parles insurgés américains, en 1776 – et au cours duquel, le comte de VERGENNES, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, s’est particulièrement distingué –629 mais aussi et surtout, l’importance acquise par la charge ministérielle dans le jeu politique à la fin du XVIIIème siècle630. Or, comme il a été souligné dans le Titre précédent, la répartition des affaires entre les divers secrétaires d’État avait consacré, à l’époque monarchique, la porosité des phères internes et internationales en même temps qu’elle avait fait du Roi le socle de leur unité. Dans cette optique, il n’y a pas lieu de leur impact accentué par le climat révolutionnairequi baigne les relations internationales depuis la rébellion des colonies anglaises contre l’Angleterre. Le résultat fut la proclamation de l’indépendance des États d’ Amérique du Nord, le 4 juillet 1776. Elle sera durablement entérinée par l’adoption d’une Constitution en septembre 1787. En Europe, les philosophes éclairés y voient l’espoir de voir leurs idées libérales inscrites dans lemarbre de la Loi. De fait, certaines monarchies ne tardent pas à s’embraser outre-atlantique. La révolution se prolonge, ainsi, en Suisse, aux Pays-Bas – avec la fameuse « Révolution du Brabant », selon la formule de Camille DESMOULINS – en Irlande, avant d’atteindre la Franc e de 1787 à 1789. De France, elle regagne les Pays- Bas et la Suisse, se développe en Allemagne rhénane et enItalie. Survenus dans des circonstances diverses et pour des causes multiples, ces évènements concourent à un même objectif : l’abolition du régime féodal. Cetteagitation, toutefois, n’est pas seulement politique. Les révolutions politiques s’accompagnent souvent d’émeutes sociales au cours desquelles la classe prolétaire, composéede salariés et de petits artisans, attaque les biens des riches. Tel est, notamment, le cas en Angleterre vers 1780, puis aux Pays-Bas de 1780 à 1787 [pour un descript if précis du climat politique, économique et social qui prévaut en France et en Europe, à la veille de la Révolution française, lire DREYFUS (F.-G.), « Le temps des révolutions. 1787-1870, Op. cit., pp. 17-44] s’étonner que les Lumières aient lié le sort politique du ministre des Affaires étrangères à celui de Louis XVI.
Pour la majorité des contemporains de Louis XVI, iln’est pas question de renoncer à l’institution monarchique mais de repenser les modalités d’exercice du pouvoir politique en le débarrassant « des restes odieux du régime féodal » . Cette posture nuancée n’atténue en rien le caractère éminemment critique de l’esprit du siècle. Elle pousse, au contraire, ses principaux contributeurs à resserrer leur critique autour des ressorts de la politique royale. Du côté des juristes et des publicistes, elle se veut plus mesurée, sans doute, parce qu’elle met davantage l’accent sur les dérives de la monarchie administrative (2) que sur la pratique abusive des « Grands ministres » (1).