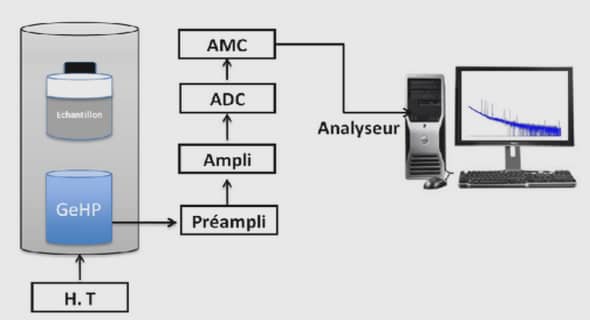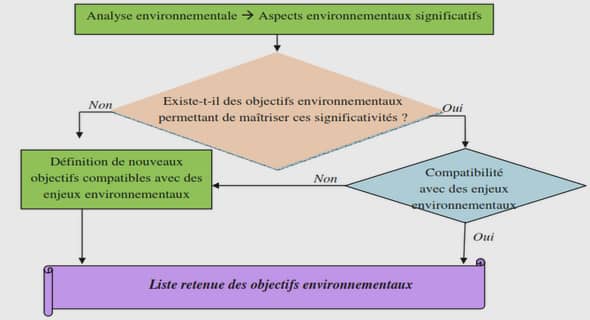LA MOBILITÉ QUELLE PLACE DANS L’ANALYSE DES DYNAMIQUES SOCIOSPATIALES
Les expériences de mobilité engendrent, de plus en plus, de profonds bouleversements en termes de réactivité aussi bien dans le monde de la recherche scientifique que dans la pratique de l’urbanisme. La prise de conscience d’une augmentation tant quantitative que qualitative des déplacements dans la ville oblige à repenser la façon dont on les analyse et dont on gère la ville. L’évolution des espaces métropolitains à travers le monde se traduit par une transformation des modes de vie et des pratiques de mobilité. Valorisée sur le plan économique au titre de vecteur de croissance, stimulée par la diffusion de systèmes techniques offrant des potentiels de vitesse considérables, la mobilité des personnes connaît une croissance continue depuis plusieurs décennies. La croissance des volumes de flux, de leur vitesse et de leur portée spatiale suscite beaucoup d’interrogations. Ces questionnements relatifs aux effets de la mobilité sur le devenir des territoires et des structures sociales font en réalité suite aux nombreuses évolutions qu’a connues le phénomène de mobilité spatiale. Mais en tant que géographe sensible aux problématiques d’aménagements urbains, le chercheur est plus enclin à s’orienter vers l’étude des mobilités urbaines [Certu, 2002 ; Marzloff, 2005 ; Wachter et al., 2005] qui se démarquent nettement des autres formes de mobilités spatiales par le fait que le déplacement se fait en direction d’un bassin de vie autre que celui d’origine. Ce faisant, il est plus à même à analyser et interpréter les dynamiques des structures sociales et des formes spatiales qui en émergent.
La mobilité : une notion transdisciplinaire à dominance spatiale
Le dictionnaire Petit Larousse (Édition 2001) définit la mobilité comme « [la] facilité à se mouvoir, à changer, à se déplacer », soit une aptitude qui renvoie à un potentiel (ce qu’il est possible de faire, que cette possibilité se concrétise ou non). La mobilité fait donc partie des notions les plus partagées au sein des sciences sociales, à commencer par les disciplines telles que la géographie, la sociologie, la démographie, l’aménagement et l’urbanisme, au point de devenir une question de société [Lassave et Haumont, 2001]. Mais que faut-il entendre par ce terme et comment se matérialise-t-il ?
Le caractère polysémique de la notion de mobilité
L’étude des migrations est au confluent de plusieurs disciplines. Géographes, démographes, économistes, sociologues, statisticiens et mêmes historiens et linguistes s’attachent à examiner et expliquer les phénomènes migratoires. Plusieurs disciplines ont donc produit des analyses différentes et complémentaires sur les mobilités. Même si ces travaux ont permis un progrès considérable des connaissances en la matière, les problématiques ne se traitent pas de la même façon en raison de la nature polysémique du concept de mobilité. En effet, les termes de mobilité géographique, migration, mobilités spatiale et quotidienne sont employés indifféremment pour désigner un changement plus ou moins durable de lieu [Bonvalet et Brun, 2000]. Pourtant, des différences existent dans leur définition et leur utilisation. Le concept de migration désigne souvent de manière plus ou moins explicite des déplacements internationaux ou interrégionaux. Le concept de mobilité géographique comprend généralement ces mouvements, mais également les mouvements à l’intérieur d’une agglomération. Mais ces deux concepts ne rendent pas compte des mouvements pendulaires [Girerd, 2004], ni des divers autres types de déplacements liés aux services, aux loisirs, etc. La mobilité spatiale quant à elle, se définit comme l’ensemble des déplacements des acteurs (individuels ou collectifs) dans l’espace physique (ou géographique), quels que soient la durée et la distance du déplacement, les moyens utilisés, les causes et les conséquences [Bassand et Brulhardt, 1980]. Aussi, lorsqu’un géographe évoque le terme mobilité, il ne parle pas forcément de la même chose qu’un ingénieur ou un sociologue qui utilise cette notion ; ce qui peut rendre difficile le dialogue en ce qui concerne leurs savoirs respectifs. Au stade où en est l’état de l’art, croiser les littératures est devenu une nécessité pour progresser. C’est potentiellement une source d’enrichissement considérable, les différentes acceptions de la mobilité formatent ainsi la recherche. Chaque définition relative à un aspect de la mobilité spatiale renvoie alors à un champ de recherche spécifique traitant d’un objet spécifique. Il résulte de cette situation qu’il n’est pas aisé de traiter d’objets de recherche transversaux échappant à ces définitions. Même si chacune de ces formes de mobilité fait l’objet d’une littérature abondante, on a parfois l’impression de “piétiner” car la plupart des recherches sur la mobilité sont orientées sur des thématiques sectorielles. Or, c’est par le biais des articulations entre les différentes formes de mobilité et les arbitrages effectués par les acteurs que se révèlent pleinement les phénomènes de mobilité et leurs enjeux. L’analyse des processus de croissance de la connexité des formes de mobilité et de leur réversibilité [Kaufmann et al., 2004], illustre l’importance de ces articulations car ils renvoient précisément à la combinaison des différentes formes de mobilité en termes de renforcement, de substitution ou de rythmes.
De la contiguïté à la connexité spatiale de la mobilité
Les notions de contiguïté et de connexité relèvent du vocabulaire de la géographie et se réfèrent à la spatialisation de la mise en relation des lieux. La connexité peut se définir comme la mise en relation par l’intermédiaire des systèmes techniques de transport et de communication ; et, la contiguïté comme la mise en relation par la proximité spatiale. En réalité, les nouveaux moyens de télécommunication et les transports rapides ont permis à la connexité de se développer et les acteurs s’insèrent désormais à plusieurs échelles spatiales [Offner et Pumain, 1998]. La croissance de la connexité a fortement retenu l’attention des chercheurs en sciences humaines, et notamment des géographes. Il ressort de ces travaux trois aspects. D’abord « l’archipelisation » du territoire : les espaces vécus se caractérisent de plus en plus par une dilution territoriale et des discontinuités dans l’espace. Ce phénomène concerne la mobilité quotidienne avec l’éloignement croissant entre les lieux de travail et les lieux de résidence. Mais il concerne également les autres formes de mobilité, et notamment les résidences secondaires de week-end ou la bi-résidentialité. Dans tous ces cas, la connexité conduit à développer une forme d’ubiquité dans l’insertion sociale, ubiquité consistant à avoir plusieurs vies en parallèles dans des lieux spatialement éloignés [Kaufmann et al., 2004, op. cit.]. Ensuite, la croissance de la connexité correspond à une dépendance graduelle des moyens de transport : il est de moins en moins possible de s’insérer socialement sans avoir accès aux potentiels de vitesse offerts par les moyens de transports motorisés. De plus, l’ancrage de la pratique des moyens de transport dans les modes de vie fait que ceux-ci sont de moins en moins interchangeables, car chaque moyen de transport définit des opportunités spécifiques de combinaison d’activités dans l’espace et dans le temps. Ainsi, par exemple, l’usage des transports publics multiplie généralement des opportunités de s’approprier les centres-villes pour des micro-activités, car l’offre de transports collectifs est souvent de structure radiale. A l’inverse, l’usage de l’automobile produit souvent des opportunités d’appropriation des équipements commerciaux d’entrée de ville, l’accessibilité routière de ces derniers étant presque toujours excellente. Enfin, on peut noter que la connexité matérialise le passage d’un modèle de différentiation socio-spatiale aréolaire à un modèle fragmenté : jusque dans les années 1960, nos sociétés occidentales étaient marquées par la séparation des fonctions dans l’espace social (division sexuelle du travail, primat de la catégorie socioprofessionnelle dans l’identité) et spatial (spécialisation fonctionnelle du sol). Changer de rôle impliquait généralement de changer de lieu [Schuler et al., 1997]. Ce modèle s’est maintenant estompé pour laisser place à une superposition spatiale et temporelle accrue des rôles. L’effacement progressif de la répartition des tâches (travail féminin, père au foyer, etc.) et le développement du temps libre multiplient les mobilités sociales horizontales sans qu’il y ait forcément d’autres mobilités spatiales qui leur soient associées. Ainsi, par exemple, le logement est-il désormais non seulement investi comme espace domestique et familial, mais de plus en plus souvent comme espace de loisir (vidéo, TV, Internet) ou comme lieu de travail (grâce notamment à l’ordinateur relié à Internet pour le télétravail).
De l’irréversibilité à la réversibilité de la mobilité
Les notions de réversibilité et d’irréversibilité sont empruntées à l’astrophysique et ne sont que récemment entrées dans le langage des sciences humaines [Bellanger et Marzloff, 1996]. Elles se réfèrent au temps ou plus précisément à la possibilité ou non de revenir à un état antérieur. Ces deux notions sont définies en référence à l’impact de la mobilité sur l’identité des acteurs [Schuler et al., 1997, op. cit.]. En sociologie, l’irréversibilité est une expérience sociale totale. C’est-à-dire qu’elle a forcément un effet sur l’individu. A l’opposé, la réversibilité est une expérience sociale que l’on peut annuler. Les mobilités les plus réversibles sont toutes celles dont on ne se souvient pas précisément. Souvent répétitives, elles relèvent de l’univers du non événementiel. La pendularité et le voyage d’affaire en sont de bons exemples : un actif va travailler tous les jours, mais il ne se souvient pas précisément de chaque trajet quotidien, un consultant international va beaucoup voyager mais ne se souvient pas précisément de chaque fois où il a pris l’avion ou le volant. Il ne faut pas déduire de cette absence de souvenir précis que les mobilités les plus réversibles sont sans impacts sur l’identité. Leur caractère répétitif les rend souvent structurantes de l’identité, pour soi, et par le regard d’autrui. Par contre, le jour où ces expériences sociales cessent, elles ne laissent pas de trace dans l’identité, au contraire des mobilités irréversibles. Comme l’opposition “contiguïté-connexité”, réversibilité et irréversibilité doivent être considérées comme des idéaux-types dans la mesure où les formes de mobilité ne sont jamais purement réversibles ou irréversibles. Le processus de réversibilisation de la mobilité spatiale a retenu l’attention des chercheurs [Cwerner, 1999 ; Urry, 1990 ; Urry, 2000], même si elle a fait l’objet de moins de travaux que la croissance de la connexité. De ces travaux, il ressort également trois phénomènes non négligeables dans l’analyse des structures socio-spatiales. D’abord, un phénomène de substitution des formes les plus irréversibles de mobilité (migration, mobilité résidentielle) vers des formes plus réversibles (mobilité quotidienne, voyage). C’est par exemple le cas de l’usage des potentiels de vitesse procurés par les autoroutes pour vivre loin de son lieu de travail et éviter de déménager [Wiel, 1999 ; Putnam, 2000]. Cette substitution implique la transformation des temporalités du long terme vers le court terme. Surtout, elle correspond à une modification de l’impact de la mobilité sur l’identité. En voyageant plutôt qu’en migrant, en pendulant plutôt qu’en déménageant, on préserve son identité d’origine et l’ensemble de ses réseaux sociaux, car ces formes de mobilités impliquent des retours très fréquents. En fait, cela préserve l’acteur de tout un travail de repositionnement identitaire et de reconstruction qu’impose une migration ou un déménagement. L’une des recherches de Colin Pooley et Jean Turnbull sur l’histoire de la mobilité en Grande Bretagne [Pooley et Turnbull, 1998] illustre la réversibilisation par substitution d’une forme à l’autre en y ajoutant le recul de l’analyse historique. Les données recueillies montrent en particulier une substitution entre les migrations et la mobilité résidentielle, substitution perceptible depuis 1880 et qui s’est accentuée à partir de 1920. Il apparaît en effet que cette forme de substitution est un processus qui naît avec les moyens de transports motorisés et se développe parallèlement à leur essor.