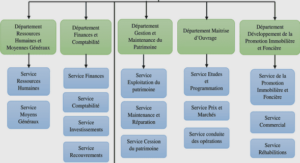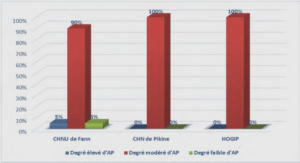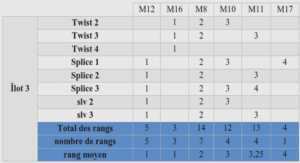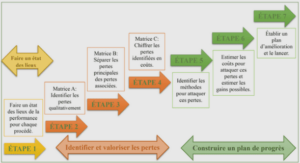La maîtrise sociale de l’économie
Opulence et pauvreté
The Affluent Society est le premier ouvrage véritablement marquant de Galbraith. Sa lecture permet de repérer la position qu’il va constamment privilégier face aux réalités économiques, sociales, culturelles de son temps: une position vigilante, très proche du theâtre des évènements lui permettant alors de proposer un bilan critique qui, tout en n’étant pas totalement en rupture avec l’opinion, se ménage toutefois un décalage significatif. L’ouvrage est publié au coeur des années 50 période heureuse de stabilité et de prospérité pour les Etat-Unis sous le double mandat de DW. Eisenhower. Ces années enregistrent l’essor des classes moyennes qui adoptent le très consumériste American Way of Life dans un contexte général célébré comme rendant définitivement obsolètes idéologies et luttes de classes. Les économistes célèbrent de leur côté l’acquisition d’un remède apparemment définitif aux différents maux économiques, – récession et chômage – avec l’application automatique des politiques keynésiennes de soutien de la demande garantes d’une croissance équilibrée.
En 1950, publiant son American Capitalism, Galbraith avait en partie sacrifié à cette ambiance lénifiante. Observant l’essor de la grande firme et l’extension de son pouvoir il exprimait sa confiance en l’affirmation d’un pouvoir compensateur représenté par les grands syndicats qui permettait de restaurer providentiellement le pluralisme sur lequel s’appuyait la démocratie américaine. Par contraste, The Affluent Society – auquel doit être associé son autre ouvrage, de facture plus politique, The Liberal Hour – constitue un rappel à la vigilance. S’il ne nie pas les acquis indéniables de la nouvelle société américaine et s’il partage relativement l’optimisme ambiant, Galbraith se focalise sur un phénomène nouveau constituant en quelque sorte l’envers de cette société : l’apparition de nouvelles formes de pauvreté au sein même de l’opulence[1]. Il serait d’ailleurs peu judicieux selon lui d’arguer de la marginalité de ce phénomène et de ne pas prendre ce problème à bras-le-corps[2]. En effet cette pauvreté constitue l’indice d’un péril tendanciel beaucoup plus important pour la démocratie : l’aliénation progressive du jugement sur les fins de l’activité humaine plus encore que sur les moyens, la perte de vue d’une solidarité commune, tout cela au profit d’un bien-être économique individuel largement produit par un conditionnement extérieur.
Économie et désespoir
Une partie non négligeable des écrits de Galbraith constitue une sorte de clinique des idées. Il adopte sans conteste une position keynésienne attentive au rôle moteur que peuvent jouer les idées dans l’histoire : le progrès social passe par une adaptation perpétuelle au changement et cette maîtrise commune du changement nécessite une perception claire. Par inertie ou par calcul certaines traditions maquillent les changements en cours, protègent les intérêt particuliers et perpétuent les hiérarchies; ces traditions porteuses « d’idées conventionnelles », véritables « structure d’idées fondées sur ce qui est acceptable »[EO, 24] sont « par nature conservatrices »[EO, 26] et ont toujours retardé l’adaptation aux nouvelles réalités : au 18e siècle, elles ont fait obstacle à la reconnaissance de la citoyenneté civile alors qu’aux 19e puis 20e siècles, elles ont menés longtemps avec succès un combat d’arrière-garde face aux avancées de la citoyenneté politique, puis économique.
Galbraith estime que la théorie économique charrie aujourd’hui une part importante d’idées conventionnelles. Les différentes traditions, souvent rivales, qui se sont échelonnées sur les deux derniers siècles partagent en fait un socle commun d’idées formées au contact d’une réalité dominée par la nécessité. Comme il l’exprime alors :
« les idées économiques commencèrent à prendre leur forme moderne à la fin du 18e siècle et au début du 19e. C’est sur cet arrière-plan de stagnation séculaire, amoindrie alors par l’accroissement de la richesse – mais de la richesse de quelques-uns et non des masses – qu’elles furent conçues et formulées… en science économique, le malheur et l’échec étaient considérés comme normaux »[EO, 29].
Adam Smith inaugure ce credo puisque, s’il s’interroge sur les causes de la richesse, c’est pour mieux présenter en matière de répartition un diagnostic pessimiste concluant à l’indépassable loi d’airain des salaires. En formulant au début du 19e siècle leurs principales lois, rente et population, les Classiques anglais qui lui succèdent ne font que renforcer une attitude soumise aux directives sévères des lois naturelles de l’économie de marché : « avec Ricardo et Malthus, la notion de privation générale et de grande inégalité devint une donnée fondamentale » [EO, 32]. Plus optimiste en apparence, la révolution marginaliste à la fin du siècle que Galbraith interprète à partir des oeuvres d’A. Marshall et de FW. Taussig n’allait pas fondamentalement remettre en question ces convictions, les accentuant même par la fonction cardinale qu’elle allouait au marché concurrentiel. Cette institution était garante d’efficacité dans la mesure même où « elle condamnait l’homme à une très grande instabilité ». Galbraith souligne ici que « le système économique selon l’école traditionnelle était une chose périlleuse pour ceux qui y participaient, de même que toute la vie économique. Le facteur danger était une qualité, et le système était d’autant plus efficace que le danger était grand » [EO, 45]. Toutefois, déjà, certains traits saillants de la nouvelle réalité économique heurtaient cette description : dans un environnement sacrifiant à l’efficacité et à la productivité on ne pouvait pas entièrement passer sous silence le sort de plus en plus pénible des exclus de cette compétition, des plus démunis et des plus faibles ; il était en outre troublant de constater que la préoccupation la plus urgente des gagnants était justement de se soustraire à cette instabilité ; de même qu’il était difficile de ne pas observer les premiers développements notables du système de la grande entreprise écartant les contraintes spécifiques du marché ; enfin, le diagnostic d’efficacité et de dynamisme de l’économie concurrentielle avait bien du mal à expliquer et justifier la récurrence de crises économiques qui passaient de moins en moins facilement pour des purges salutaires. En résumé, au sein du marginalisme, « derrière la façade d’espoir et d’optimisme, demeurait la crainte obsédante de la misère, de l’inégalité et de l’insécurité »[EO, 51].
[1] Le premier titre envisagé pour son ouvrage avait d’ailleurs été Why People Are Poor ?
[2] Au tout début de la présidence de Lyndon Johnson, nommé à la direction du conseil de surveillance de l’ Office of Economic Opportunity, Galbraith fera passer dans les faits certaines réformes concernant la pauvreté annoncées quelques années auparavant dans The Affluent Society. Voir [VS, chapitre 28, 426-429].
L’abondance, nouvel opium?
Galbraith admet sans discussion les avantages évidents d’une société opulente. Ce qu’il ne peut accepter, en revanche, c’est l’idée qu’une telle situation puisse mettre fin à tout conflit, à toute discussion sur les valeurs et les fins, à toute réflexion sur le bien commun. Or, ce qu’il soupçonne dans le discours ambiant sur opulence et consensus c’est la remontée subreptice d’une entreprise élitiste visant à anesthésier le sens critique commun, détourner la participation active et paralyser le jugement qu’individus et groupes doivent constamment porter sur leur sort commun.
Désormais croissance et production paraissent s’imposer comme des valeurs objectives à propos desquelles il serait totalement inopportun de simplement s’interroger : « c’est un indice de prestige de la production, souligne Galbraith, qu’on identifie celle-ci dans notre comportement national au rationnel et au pratique » [EO, 119]. Or c’est cette confiscation de la notion de rationnel dans une ambiance clairement euphorique qui selon lui est particulièrement suspecte. En effet, cette consécration de la production constitue plus vraisemblablement l’indice d’une servitude passée que celui d’une libération présente ; elle invite à la vigilance et non à un agréable abandon. Il le souligne d’ailleurs fortement : « Nos préoccupations au sujet de la production sont en fait l’ultime aboutissement de puissantes forces historiques et psychologiques, forces auxquelles nous ne pouvons espérer échapper qu’au moyen d’un acte de volonté » [EO, 121]. Il convient donc d’interroger ce dogme, d’en repérer les faiblesses et les incohérences et, de là remonter aux habitudes, aux routines, mais aussi aux intérêts et aux calculs qui en assurent le maintien.
Une première constatation s’impose. La quête productiviste se déroule plus dans l’ordre du discours que dans celui des faits. Désormais de multiples possibilités s’offrent pour optimiser la production globale. Or, ce que l’on observe plutôt c’est combien les préoccupations actuelles « au sujet de l’accroissement de la production sont partiales, et vont quelquefois à côté de la question » [EO, 126]. Alors que l’exigence de production devrait se trouver largement satisfaite par des efforts en matière d’organisation ou d’investissement technologique elle se manifeste plutôt par la répétition d’arguments anciens relatifs à l’indispensable esprit d’épargne et de travail dont doivent faire montre les différents agents. Si une telle latitude est possible aujourd’hui, n’est ce pas simplement note alors Galbraith, parce que la production per se a perdu dans la nouvelle situation d’abondance son statut de priorité indiscutable et qu’alors, la question des priorités en matière de finalités mérite d’être reposée et étudiée à nouveau par tous ?
Mais plusieurs factions puissantes de la société américaine n’ont aucun intérêt à reconnaître un changement qui risque d’atteindre leurs intérêts et d’entamer leur crédit. Galbraith se focalise ici sur une triade composée de l’économiste, de l’industriel et du militaire.
« Les sciences économiques, note-t-il, ne manquent pas d’instinct de conservation » [EO, 136] et la défense de la production a constitué l’une de leurs priorités. Le coeur stratégique de cette ligne de défense est occupé par la théorie du consommateur, « théorie redoutable ». L’innovation qu’a constitué la théorie de l’utilité marginale aurait dû affaiblir la thèse de la production pour la production, puisqu’elle suggérait une décroissance de l’utilité avec la quantité consommée. Mais Galbraith estime que le danger fût évité par les économiste en décrétant simplement l’impossibilité de comparer les utilités entre elles et l’impossibilité de comparer les utilités dans le temps ce qui excluait toute discussion ouverte sur les valeurs. Comment s’attaquer alors à cette théorie ? Galbraith remarque que tout l’édifice repose en fait sur une assertion relative aux besoins de l’individu ; « si vraiment les besoins de l’individu sont pressants, ils lui sont inhérents. Ils ne sauraient être urgents s’ils étaient inventés pour lui par quelqu’un d’autre. Et il ne faut surtout pas qu’ils soient inventés par la production destinée à les satisfaire » [EO, 147]. Or selon lui ce cauchemar de la théorie économique est manifestement devenu réalité. Formulant une thèse qu’il développera amplement dans ses ouvrages suivants, Galbraith juge que désormais le consommateur subis un « effet de dépendance » qu’accentue encore le développement exponentiel de la publicité. La réalité est alors bien différente de celle paisiblement décrite par la théorie économique conventionnelle : « Dans ce cas, la production de bien satisfait le besoins que la consommation de ces mêmes produits crée et que les producteurs de ceux-ci fabriquent artificiellement. La production incite à avoir des besoins et une nécessité de production accrus » [EO, 152-153].
Une autre ligne de défense du dogme de la production passe par une alliance entre l’industriel et le militaire. Elle a permis de renforcer « le mythe soutenant que la puissance militaire est fonction de la production économique » [EO, 169]. Or l’association est particulièrement douteuse au vu des faits. S’appuyant sur des exemples récents – la situation américaine après décembre 1941[1], la période de la guerre de Corée – Galbraith observe qu’un haut niveau de production et de consommation privées a constitué un handicap indéniable lorsqu’il s’est agit, dans l’urgence, de réorienter la nation vers l’effort de guerre. Les comportements saturés, même en période critique, opposent une forte inertie à ce qui peut entamer un niveau de vie résultant d’un conditionnement antérieur[2]. Mais plus généralement, et pour abandonner le cas particulier des dépenses militaires, « le processus qui étend l’économie donne également de l’expansion à la demande privée et réduit ce qui semble être consacré à l’usage public » [E0, 169].
Le dogme de la production est donc activement défendu par plusieurs factions solidaires. Leur entreprise de propagande et de persuasion est puissante et en vient ainsi à convertir de larges pans de l’opinion. Galbraith estime particulièrement révélateur le fait qu’un tel dogme ait pu aussi s’imposer jusque dans les rangs de la Gauche américaine, dans le rang des Libéraux. Au sein de cette opinion démocrate il a suffit de travestir graduellement l’enseignement keynésien et de croire que la célébration de la production était la garantie du succès politique[3]. Le constat global que dresse Galbraith sur cette nouvelle orthodoxie mérite d’être noté :
« La production ne tourne plus en vue d’obéir au besoin pressant de fournir des produits. L’importance des augmentations (ou des diminutions) marginales dans la production des biens est insignifiante. Nous conservons le sentiment de son urgence à cause d’opinions qui ne relèvent pas du monde d’aujourd’hui, mais qui remontent à celui où naquit l’économie. Elles sont renforcées par une théorie insoutenable de la consommation, une identification désuète, erronée et même tant soit peu dangereuse de la production avec la puissance militaire, et par un système où l’intérêt commun aux libéraux et aux conservateurs est engagé à revendiquer l’importance de la production » [EO, 186]. Si ce mythe doit être dénoncé, ce n’est pas simplement pour défendre liberté et autonomie du jugement. C’est aussi et surtout parce qu’une société entièrement dévouée à la production crée et simultanément dissimule de nouveaux maux économiques, sociaux, politiques, culturels. Le danger que Galbraith voit poindre derrière cette célébration de la production c’est alors la réhabilitation des valeurs conservatrices d’insécurité et d’instabilité. Dans cette perspective trois phénomènes participent à cette renaissance : premièrement, le conditionnement de l’individu, deuxièmement, le développement d’une inflation endémique, troisièmement, le déséquilibre entre le développement du secteur privé et celui du secteur public.
Un premier phénomène significatif est l’accroissement de l’endettement des ménages américains[4]. Galbraith mentionne ici plusieurs indicateurs significatifs montrant un quasi doublement des taux d’endettement sur la dernière décennie. Ce phénomène témoigne magistralement du rapport direct « entre l’émulation et l’endettement » [EO, 188] et il réintroduit instabilité et incertitude dans la vie économique.
[1]Dans son autobiographie Galbraith raconte comment en 1941-1942, en charge alors du contrôle des prix et du rationnement, il a dû longuement et durement batailler contre les cartels de l’automobile pour obtenir un rationnement du caoutchouc, vital alors à l’effort de guerre américain. Voir [VS, chapitre 10]
[2] « Si un niveau de vie élevé est essentiel au mode de vie américain, relève Galbraith, on prétendra même qu’il est paradoxal de vouloir l’abandonner au cours d’une guerre sous prétexte de préserver ce mode de vie américain » [EP, 164].
[3] Il note, « la politique économique des Libéraux continue à beaucoup s’occuper de la production. Comme le souvenir de la sous-production des années de dépression s’est quelque peu effacé, les revendications ne portent plus sur le plein-emploi, mais insistent maintenant sur l’expansion de l’économie » [EO, 180].
[4] « Le danger immédiat du processus de la création des besoins, écrit Galbraith, réside dans le processus conjoint de l’endettement. La demande en vient ainsi à être de plus en plus assujettie à la possibilité et à la bonne volonté que montrent les consommateurs à contracter des dettes », [EO, 188].