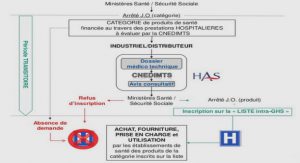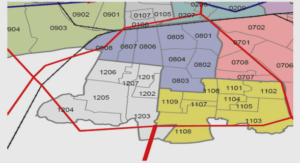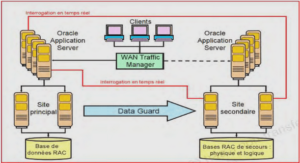Les connaissances constituent un avantage stratégique pour toute organisation (Bartlett & Ghoshal, 1999). D’ailleurs pour un grand nombre d’auteurs, une organisation se définit avant tout comme un corpus de connaissances (Penrose, 1959; Nelson & Winter, 1982; Huber, 1991; Kogut & Zander, 1993). Cependant, la grandeur, la taille et la complexité des organisations sont telles qu’il est aujourd’hui difficile d’identifier les experts et les réels détenteurs du savoir. Comme le soulignent Hatchuel, Lemasson et Weil (2002, p.34), les entreprises, en s’intéressant activement à la gestion des connaissances, se rendent compte « … qu’elles ne comprennent plus très bien comment elles se forment, qui les détient et lesquelles on doit sauvegarder. » Ces mêmes auteurs s’interrogent sur les formes d’action collective que la gestion des connaissances prétend rationaliser. Ces actions prennent forme et se manifestent dans différents domaines de la gestion des connaissances : la création de connaissances (Nonaka, 1995), leur transfert (Argote & Ingram, 2000) et même leur rationalisation et leur capitalisation. C’est donc au moment même où l’on se rend compte de l’importance d’une gestion efficace des connaissances que nous sommes confrontés aux difficultés qui accompagnent leur diffusion et leur transmission.
La capitalisation des connaissances
Chaque organisation doit gérer ses activités et ses processus de façon à faciliter la réutilisation des connaissances et ainsi développer son capital intellectuel. La finalité de la capitalisation des connaissances étant de combiner les savoirs et les savoir faire pour créer de la valeur, cette étape apparaît comme une des phases cruciales de la gestion des connaissances. Pour Grundstein (1995), la capitalisation des connaissances de l’entreprise représente les connaissances utilisées et produites par cette dernière. Elle doit être envisagée comme un ensemble de richesses constituant un véritable capital. La capitalisation des connaissances consiste donc à repérer les connaissances cruciales, à les préserver et les pérenniser tout assurant qu’il soit possible de les partager et de les réutiliser ultérieurement. Cela inclut un possible transfert de connaissances entre des sites ne possédant pas nécessairement les mêmes expériences, et du même coup, une expertise comparable. Gardoni (1999) ajoute à ce propos que la capitalisation du savoir et du savoir-faire est essentielle et stratégique pour l’entreprise qui veut faire face à une concurrence internationale de plus en plus forte.
Trois courants d’influence sont, comme le précisent Pachulski et al. (2000), à l’origine de la capitalisation des connaissances: le paradigme économique et managérial, celui de l’ingénierie des connaissances et finalement, le paradigme de l’ingénierie des systèmes d’information.
Le premier de ces paradigmes se fonde sur une approche entrepreneuriale de la gestion des connaissances. Les auteurs associés à cette approche (Nelson & Winter, 1982; Prahalad & Hamel, 1995 ; Nonaka & Takeuchi, 1995) définissent la notion de compétence comme la capacité de coordonner une séquence de comportements en vue d’atteindre des objectifs dans un contexte donné. La notion de routine organisationnelle est envisagée comme un schéma comportemental prédictible et régulier. Il constitue le répertoire de connaissances de l’organisation. Les changements organisationnels sont au cœur de la capitalisation des connaissances et ils passent par la coopération tant individuelle qu’organisationnelle.
Ensuite, l’arrivée des courants de l’intelligence artificielle et de l’ingénierie des connaissances par l’intermédiaire de l’univers informatique a modifié la question du traitement des données en y introduisant les connaissances comme matière première de l’informatique: […] on est passé d’une programmation procédurale classique à la construction d’une base de connaissances, c’est-à-dire d’une succession d’instructions, exécutables selon un ordre rigoureusement établi, à une simple description structurelle des objets de l’univers et de leurs propriétés. (Ganascia, 1990) .
L’ingénierie des connaissances se retrouve donc au cœur des processus d’identification, de création et de stockage des connaissances; elle en facilite le partage et l’utilisation, en plus de permettre de les modéliser sous une forme définie en fonction du nouveau contexte. Newell & Simon (1972) ont quant à eux fourni à l’intelligence artificielle un cadre d’étude précis permettant de mieux gérer l’hétérogénéité des données en étudiant la capacité de résolution de problèmes.
L’ingénierie des connaissances permet de donner une forme à une connaissance, le plus souvent sur un support écrit qui en permet la manipulation, le stockage et son partage. La capitalisation des connaissances organisationnelles rend accessibles, explicites et traçables ces connaissances. Néanmoins, il existe deux réseaux d’informations complémentaires et parallèles. Dans le premier, davantage formel, circulent des données et des informations; des connaissances que l’on suppose plus explicites. Dans le second, les connaissances enracinées dans l’action et dans les routines — donc dans un contexte spécifique — transitent, s’échangent et se partagent de manière informelle.
D’ailleurs, la capitalisation des connaissances n’est pas une fin en soi, mais plutôt une manière de réutiliser adéquatement la connaissance organisationnelle. En dépit de cette masse de savoir disponible, les grandes entreprises souffrent d’une inertie en raison d’un énorme écart entre un vaste réseau de connaissances et sa sous-exploitation, un phénomène que des auteurs comme Pfeffer & Sutton (1999) ont identifié comme un décalage entre savoir et faire.
La contextualisation des connaissances
Malgré le développement et l’utilisation de modèles de formalisation et de réseaux de stockage, il demeure difficile de reproduire le contexte et la mémoire des gestes qui supportent et donnent leur sens aux connaissances. En dissociant une connaissance de l’ouvrier qui l’a fait naitre, de l’artefact qui l’a supporté, il devient difficile de ressusciter des savoirs sans dénaturer leur raison d’être et leur moyen d’agir.
Bien que de nombreux processus cognitifs singuliers soient à la base des structures mentales universelles qui déterminent la perception du monde externe, la manière d’agir des individus n’existe pas de façon autonome (Dewey, 2006). Pour Weick (1979) comme pour bon nombre de chercheurs, la connaissance organisationnelle est construite et située. Les connaissances communes à deux personnes doivent correspondre minimalement et impliquent une compréhension partagée de l’infrastructure socio-matérielle de l’objet sur laquelle s’applique et repose la connaissance. Depuis Piaget (1974), on sait qu’un savoir qui n’est pas intégré dans des schèmes opératoires demeure inerte et inopérant.
La contextualité des connaissances prend racine dans les endroits de rétention de connaissances évoqués par Walsh et Ungson (1991), c’est-à-dire les structures organisationnelles, les pratiques et procédures standards de l’organisation, sa culture, la structure physique du lieu de travail, les outils et les artefacts qui y sont employés et bien évidemment, les individus. On voit que le rôle du contexte ne se limite pas à l’ensemble des objets pouvant soutenir et activer la mémoire organisationnelle.
D’ailleurs, Blackler (1995) identifie cinq types de savoirs dans les organisations: le savoir intellectuel, le savoir contextualisé, le savoir culturel, le savoir ancré dans les structures et finalement le savoir codifié. Chacun est affecté à différents niveaux par le contexte (Lauzon et al., 2013) et a la chance d’être activé à différentes étapes du processus de transfert de connaissances.
L’apprentissage organisationnel
Selon Ingham (1994) l’apprentissage organisationnel est un processus social d’interactions individuelles qui a pour but l’acquisition ou la production de nouvelles connaissances organisationnelles. (Ingham, 1994).
Argyris & Schön (1978) affirme que dans un contexte de transfert de connaissances, ce type d’apprentissage peut être considéré comme une voie d’accès complémentaire vers l’acquisition de savoirs nouveaux et même comme une obligation lorsque les dirigeants constatent un décalage entre le savoir préexistant et une situation nouvelle,
L’apprentissage organisationnel englobe donc des réalités et des phénomènes très variés. Il peut également être individuel et collectif. On parle d’apprentissage individuel en référence aux analyses traditionnelles de l’apprentissage par la pratique. L’individu est alors au cœur d’un processus où l’acquisition de savoir par l’expérience favorise ultimement le développement de techniques. Or, bien que l’apprentissage puisse être envisagé de manière individuelle, c’est seulement avec la circulation de l’information et des connaissances entre les membres de l’organisation que peut s’élaborer un savoir organisationnel.
Il existe quatre principales approches de l’apprentissage: behavioriste et comportementale (Cyert & March, 1963 ; March & Olsen, 1976); cognitive (Argyris & Schön, 1978, 1996); le constructivisme (Bruner, 1986) et le socioconstructivisme (Vygotski, 1978 ; Bandura, 1986 ; Doise & Mugny, 1997). Ainsi, l’apprentissage organisationnel tout comme le transfert de connaissances peuvent être étudiés selon des approches et à travers des thématiques aussi variées que la mémoire, les attitudes, la motivation, les compétences, les savoirs, les systèmes d’information, etc.
INTRODUCTION |