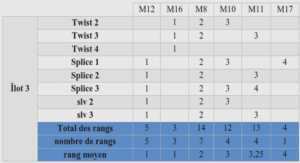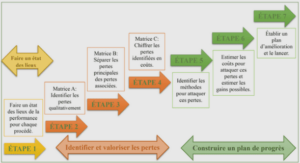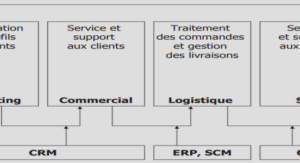LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES
Depuis 1996 le Sénégal a initié une réforme portant sur l’approfondissement de la décentralisation par le transfert des compétences aux collectivités locales. En fait cette réforme portant sur la décentralisation au Sénégal comprend trois phases : la première phase qui va de l’indépendance à 1990 était consacrée au montage institutionnel de la politique de décentralisation avec la création des communes et l’introduction de la décentralisation dans les zones par la création en 1972 des communautés rurales ; la deuxième phase traduite par la loi N° 90-34 et N° 90-37 du 8 octobre 1990 ainsi que la loi 91- 16 du 16 février 1991 consacre la responsabilité des autorités décentralisées dans la gestion des affaires administratives et financières de leurs collectivités ; la troisième phase enclenchée par le vote de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales qui consacre la région comme troisième entité de collectivité locale et l’adoption de la loi N° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales. Cette loi en fait inverse les pratiques antérieures. Avant 1996 seul l’Etat était responsable de la politique de l’environnement. Depuis cette date, il existe un principe de coresponsabilité entre l’Etat et les collectivités locales, l’article 1er de la loi du 96-07 déclarant que « …la région, les communes, et la communauté rurale règlent par délibération , les affaires de leur compétences…Elles concourent avec l’Etat à l’administration et l’aménagement du territoire, au développement économique, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu’à la protection et à la mise en valeur de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie… ». Et l’article 16 de la loi proclame que le « … le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la nation… ». Sous ce rapport deux séries de questions peuvent être soulevées : quelles tensions contradictoires peuvent se manifester entre les tenants d’une décentralisation du pouvoir en matière d’environnement et ceux qui considèrent que l’environnement sera moins bien géré s’il est laissé entre les mains des élus locaux et des pressions locales ? Est ce seule l’administration consultative avec la participation des associations de défense de l’environnement qu’il faut privilégier ou faut il impliquer étroitement les populations à la base ? L’objectif de toute politique de décentralisation vise entre autre l’autonomisation et la responsabilisation des populations à la base ainsi que leurs élus en vue d’une participation effective à tout processus cherchant à améliorer leurs conditions de vie. Cette participation ne concerne pas seulement les actions concrètes mais intègre tout le travail d’identification des problèmes et les processus, prise de décision, sans parler de la gestion des relations avec d’autres acteurs sous forme de concertation de collaboration ou de négociation. C’est dire l’importance qui doit être accordée à la gestion des nouvelles institutions mais également les nouvelles relations créées par la politique de décentralisation entre différents acteurs publics, privés (commercial ou associatif) au sein de la société, de l’Etat aux niveaux local, national voire international (comme par exemple dans le cadre de la coopération au développement).
LE CONTEXTE ET L’EVOLUTION DES POLITIQUES DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE AU SENEGAL
LA GESTION DECENTRALISEE DES RESSOURCES NATURELLES E
n tant que tel, le processus de décentralisation induit un ensemble d’interactions, à gérer entre différents acteurs à plusieurs niveaux dont les populations locales et leurs élus constituent des acteurs de premier ordre. En outre les collectivités locales présentent l’avantage d’être assez proches des conflits locaux pour pouvoir jouer un rôle d’arbitre et éventuellement imposer un projet avec la même crédibilité et la même force que s’il s’agissait de l’Etat. En ce sens, la décentralisation devrait constituer une formidable occasion de définir une politique résolument incisive dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles avec une prise en compte des savoirs locaux. Pourtant l’analyse des faits ne permet pas de conclure à une telle évolution, malgré la mise en place du transfert de compétences depuis une dizaine d’années. Au contraire l’insuffisance des moyens des collectivités décentralisées au Sénégal dont les budgets bien en deçà de leurs charges ne leurs permettent pas de recruter un personnel suffisant et qualifié ni de couvrir les charges de fonctionnement. Il s’y ajoute hormis la création de bois, forêts et zones protégées, qu’organise le bloc de compétences de l’article 28 du chapitre II de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, la compétence en matière de création d’espaces naturelles protégées réglementairement relève uniquement de l’Etat. Il en est de même des réserves intégrales prévues par l’article R 16 du décret n° 95-357. En ce qui concerne l’instruction des dossiers de création aucune procédure ne fait état de la participation, ne serait-ce que sous simple forme consultative, des organes délibérant des collectivités décentralisées. La décentralisation au Sénégal loin de remplir les missions qu’on attendait d’elle, à savoir la définition d’une politique locale fondée sur les connaissances et pratiques locales notamment dans la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité constitue une institution qui procède à la reproduction de modèles centralisés de gestion de l’environnement à travers le Plan Local de Développement (PLD). Le PLD de la communauté rurale de Toubacouta élaboré en 2002, élude complètement les savoirs locaux comme options pour la résolution de la crise écologique qui assaille la localité.
LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
La dégradation généralisée des ressources naturelles fait suite à une paupérisation généralisée des populations locales. Les vagues de sécheresses des années 70/80 ont considérablement affecté le monde rural au Sénégal. Elles ont eu des conséquences relativement prononcées surtout dans le monde rural, où la population tient directement l’essentiel de leurs moyens de subsistance des ressources naturelles. Dans la région du Sine Saloum, ces conséquences se sont surimposées à une situation déjà alarmante liée d’une part à la salinisation plus ou moins généralisée des terres et d’autre part aux pratiques culturales relativement aux différentes politiques agricoles remontant à la période coloniale et fondées sur la monoculture arachidière. Les conséquences environnementales désastreuses de la culture arachidière sont catastrophiques. Elles ont pour nom : 37 • l’accentuation de la dégradation des ressources naturelles, notamment végétales et par la même la dégradation des écosystèmes, avec comme corollaire la perte de la diversité biologique et la perturbation du réseau trophique ; • la détérioration des conditions climatiques par l’accentuation de la baisse de la pluviométrie ; • la dégradation des sols liée à la fois au défaut de restauration par absence d’humification due à un manque de litière et surtout à l’érosion éolienne et hydrique. Tout cela a contribué à plonger les populations de la RBDS en particulier dans une précarité et une situation de pauvreté de plus en plus affirmée. C’est pourquoi, dés le début des indépendances de nombreux projets de développement ont vu le jour pour venir au secours des populations rurales. Malheureusement ceux-ci péchèrent surtout par leur approche méthodologique plutôt sectorielle et directive. Toute chose que les nouvelles stratégies de développement, basées sur la méthode participative et une plus grande responsabilisation et une implication des populations locales, tentent de corriger. Par ailleurs la volonté de réaliser un développement durable a apporté entre autres changements, l’insertion de l’économie rurale au marché. Ce qui n’a pas eu que des effets positifs, loin s’en faut. En atteste l’érosion de la base productive, une plus forte pression sur le restant des ressources, la perte de main d’œuvre par l’exode rurale, une baisse de la productivité etc. A cela est venu s’ajouter la modification des droits d’accès aux ressources naturelles dans l’optique de la conservation de la biodiversité notamment par l’érection des aires protégées. Ces mesures de conservation qui avaient pris rarement en compte les besoins et préoccupations des populations locales qui pourtant sont largement dépendantes de ces ressources, vont se heurter aux stratégies de contournement de ces dernières (Maëlle, 2000). Ainsi pour pallier ces causes d’échecs des politiques de conservation de la biodiversité, il est prévu des mesures d’accompagnement qui visent à réduire la pauvreté et la dépendance des populations locales vis à vis des ressources naturelles. Ces mesures concernent des activités comme le micro crédit, le maraîchage, l’apiculture, la pisciculture. Cependant le succès relatif de cette politique fait que les mesures de conservations stricto sensu développées par certaines institutions sont peu suivies par les populations locales. C’est le cas à Sanghako lorsque les populations ont arrêté de suivre une formation en apiculture de l’ANCAR une agence gouvernementale avec l’arrivée de l’UICN dans la localité. Interrogées les populations ont répondu que « l’ANCAR n’a pas d’argent contrairement à l’UICN ». En fait les populations préfèrent des programmes de conservation accompagnés de mesures d’accompagnement. L’avis de N Ndao présidente du GIE Mbogga yiff de Soukouta est on ne peut plus révélateur « si on vous interdit d’exploiter on doit prévoir pour vous une autre activité compensatrice du manque à gagner provoqué par les dispositifs de conservation ; c’est le seul gage de réussite du projet ». C’est donc cette rationalité qui informe le comportement des acteurs et explique pourquoi ils préfèrent telle institution au détriment de telle autre. Les ONG ayant plus de moyens que certaines structures étatiques, les populations adhérent beaucoup plus à leurs activités.