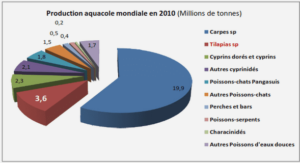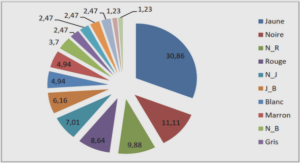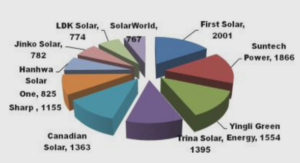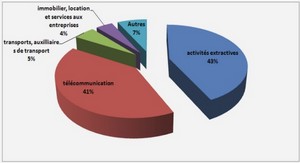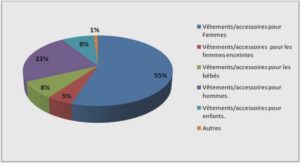Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Les interactions quotidiennes après des violences de masse : problématique de la recherche et approche théorique
Contre la normativité des pratiques de pacification « par le bas »
Cette thèse s’inscrit dans la continuité des travaux qui ont souligné le caractère pour le moins naïf114 des conceptions « relationnistes » et communicationnelles des violences de masse et de la paix « durable », qui sont à l’œuvre dans les programmes de pacification « par le bas ». Elle partage, en effet, avec ces travaux le constat de la vanité de ces programmes, dans le sens où ils sont à la fois démesurément ambitieux – puisqu’il s’agit, rappelons-le, de (re)construire de manière volontariste des liens sociaux « harmonieux » supposés faciliter la diffusion, à l’échelle de toute une société, d’une « culture de la paix » – et mal pensés – au point que même s’ils faisaient effectivement ce que les théoriciens et praticiens de la pacification « par le bas » prétendent qu’ils font, ils ne réaliseraient toujours pas leur ambition.
Les écrits des « praticiens-chercheurs » 115 sur la pacification « par le bas » sont intrinsèquement normatifs et prescriptifs. On y trouve une série d’injonctions morales « peu fondées scientifiquement et jamais mises à l’épreuve empiriquement » 116 . Les personnes vivant dans des sociétés, qui ont connu des violences de masse, sont enjointes à se réconcilier avec tous les membres de l’autre groupe (religieux, ethnique ou ethno-régional) avec lequel leur propre groupe d’appartenance était en conflit ; elles sont également enjointes à dialoguer, et ce faisant, à manifester de l’empathie, voire à échanger repentance et pardon117.
On peut ici se demander en quoi les « praticiens-chercheurs » de la pacification « par le bas », qui sont majoritairement des Occidentaux appartenant aux classes supérieures, très diplômés118 et n’ayant aucune expérience personnelle des violences de masse, sont légitimes pour dire à ceux qui les ont vécues qu’ils doivent se réconcilier et comment ils doivent le faire.
La démarche à l’origine de cette thèse est exactement inverse à celle des tenants de la pacification « par le bas ». Il ne s’agit pas de dire à des personnes ayant vécu des violences de masse quel type de relations elles devraient mener avec les membres de l’autre groupe, mais d’observer et analyser leurs interactions en face-à-face – sans préjuger de ce qu’elles sont ou devraient être – et d’identifier et comprendre les représentations collectives qui leur sont associées. La thèse fait l’hypothèse que depuis les violences de masse perpétrées contre les Kasaïens non originaires, les interactions quotidiennes entre Katangais et Kasaïens se caractérisent par les non-dits et l’évitement et que ces non-dits et cet évitement ne sont ni plus ni moins favorables ou préjudiciables à la paix que ne l’est le dialogue en face-à-face prôné par les tenants de la pacification « par le bas ».
La thèse étudie plus précisément ces relations sociales ordinaires (de travail, de voisinage…) Likasi et Kolwezi, deux villes du Sud-Katanga119 qui furent particulièrement touchées par les violences. La particularité de ce terrain est que les violences n’ont pas été suivies par un déploiement d’ONG spécialisées dans la pacification « par le bas »120. Par conséquent, les relations sociales ordinaires entre Katangais et Kasaïens se produisent dans ce « laisser-faire » (le temps et les interactions ordinaires) dont se méfient tant les tenants de la pacification « par le bas ».
A partir de l’observation et l’analyse des interactions entre Katangais et Kasaïens et en s’appuyant sur la littérature abordant le quotidien et/ou les relations sociales ordinaires dans les contextes de sortie de conflit, la thèse interroge également les injonctions morales qui sont portées par les tenants de la pacification ou de la réconciliation « par le bas » : comment des techniques de résolution des conflits, qui ont été conçues pour résoudre des conflits interpersonnels (familiaux, au travail, entre voisins ou entre bailleurs et locataires), pourraient-elles mettre fin à des conflits politiques ayant des causes structurelles ? Pourquoi des relations sociales pacifiques après des violences de masse devraient-elles être nécessairement pensées en termes de réconciliation ? Une réconciliation « par le bas », diffusant de proche en proche une « culture de la paix » qui finirait par imprégner toute une société, est-elle seulement concevable dans un contexte de post-violences de masse ? Pourquoi des relations sociales pacifiques « durables » devraient-elles être conditionnées par un dialogue, de surcroît organisé de manière volontariste, entre les membres des groupes en conflit visant à une compréhension mutuelle de leur point de vue respectif, et en particulier leur version du conflit et de ses origines ? En quoi le silence sur ces mêmes thèmes serait-il incompatible avec un état de paix ? En quoi les stéréotypes – les représentations mutuellement stigmatisantes des tenants de la pacification « par le bas » – et leur dépassement pourraient-ils avoir une quelconque influence sur un état de violences ou un état de paix ? L’approche méthodologique choisie – car la plus à même de saisir cet objet de recherche – est une approche inductive et émique121 ou une démarche compréhensive dénuée de toute revendication d’empathie à l’égard des enquêtés. Il s’agit bien ici de comprendre les interactions entre Katangais et Kasaïens dans un quotidien qui a été transformé par les effets des violences du début des années 1990, du point de vue des enquêtés, et de ce fait de prendre au sérieux ce qu’ils en disent, mais sans prétendre s’identifier à eux ou se mettre à leur place. En effet, comme l’a souligné Howard Becker, « nous ne sommes pas ces gens et nous ne vivons pas dans les mêmes conditions qu’eux » 122 . Cette impossibilité à comprendre totalement l’expérience vécue par les enquêtés est particulièrement présente dans les études portant sur des phénomènes de violences extrêmes ou – comme c’est le cas de cette thèse – ayant comme terrains des contextes d’après-violence. Dans la citation suivante, Harry G. West, qui a mené des entretiens avec d’anciens prisonniers politiques qui avaient été torturés par la police secrète portugaise lors de la guerre d’indépendance au Mozambique, rend compte de cette impossibilité : Dibwe dia Mwembu estime ainsi que seule une « réconciliation par en bas » permettra de réharmoniser » les relations entre Katangais et Kasaïens. La méthode, qu’il préconise pour parvenir à cette « réconciliation par en bas », est l’organisation d’« espaces de négociations et de médiation »127 d’abord entre les représentants des deux communautés – parmi lesquels les chefs coutumiers, les autorités politiques locales, les responsables religieux et les leaders des associations socio-culturelles – puis entre ces représentants et leur base respective. L’objectif de la mise en œuvre de ces « espaces de négociations et de médiation » est, selon lui : « d’éclairer l’opinion sur l’évolution de la situation et l’amener à demander pardon, à pardonner à son tour, à oublier le passé, à définir concrètement les concepts d’« intégration » et de participation des originaires du Kasaï à la gestion de la res publica katangaise et à construire une nouvelle société régie par des rapports d’équité, de justice et de respect mutuel »128.
Dibwe dia Mwembu donne deux exemples de ce qu’il appelle « espaces de négociations et de médiation », dans lesquels il voit les prémices d’un « processus de pardon et de réconciliation »129.
Il évoque d’abord deux rencontres organisées, en décembre 2005, par le gouverneur du Katanga, Urbain Kisula Ngoy, entre les responsables de deux associations socioculturelles130
– la Balubakat représentant les Baluba du Nord-Katanga et une association socio-culturelle représentant les Baluba du Kasaï – et au cours desquelles ces responsables « ont, ensemble, procédé à la relecture commune et partagée des situations passées qui avaient ravivé les conflits et creusé le fossé entre les communautés » 131 . Ces rencontres furent suivies de discussions au sein de chacune des associations socio-culturelles. D’après ce qu’en écrit Dibwe dia Mwembu et le compte-rendu d’une réunion au sein de la Balubakat qu’il cite132, il semble que ces rencontres – entre les responsables des deux associations puis au sein de chacune d’elles – aient plus été des espaces où les participants ont pu exposer la version des violences et de leurs origines, qui est dominante dans leur propre communauté d’appartenance, que des « espaces de négociations et de médiation » tels qu’ils sont définis dans ses travaux.
Le deuxième exemple mentionné par Dibwe dia Mwembu est la médiation menée en 2002 à Likasi par l’Association des Faiseurs de Paix, à la demande du maire de la ville, Petwe Kapande, entre les commerçants katangais et les commerçants kasaïens en vue de la réintégration de ces derniers dans le marché de Kikula – le plus grand marché de la ville – qu’ils avaient fui au moment des violences133.
Ce qui distingue la thèse des travaux de Dibwe dia Mwembu, c’est qu’il intègre dans son analyse deux des travers des théories de la pacification « par le bas ». Il adhère au postulat selon lequel l’organisation d’un dialogue en face-à-face, associé à des injonctions – en l’occurrence, au pardon, à l’oubli et à la réconciliation – conduit nécessairement à la (re)construction de relations sociales harmonieuses fondées sur l’équité et un respect mutuel. En adoptant ce postulat, ses écrits sur les relations entre les Katangais et les Kasaïens après les violences deviennent à leur tour normatifs. Un cadre d’analyse goffmanien : interactions en face-à-face et « système d’accords de non-empiètement »
Comme cela a déjà été évoqué, je ne préjuge pas de l’état des relations sociales ordinaires entre Katangais et Kasaïens après les violences de masse du début des années 1990. L’unité d’analyse est leurs interactions en face-à-face, telle que les définit Erving Goffman, c’est-à-dire comme des situations de co-présence physique134. Il s’agit donc d’étudier les interactions entre Katangais et Kasaïens non pas « pour elles-mêmes mais pour ce qu’elles révèlent quant aux modes de fonctionnement du type d’ordre social qu’est l’interaction » 135 et plus précisément – s’agissant de cette thèse – qu’est l’interaction dans un contexte post-violences de masse.
Goffman conçoit l’ « ordre de l’interaction » 136 « comme un domaine autonome de plein droit »137, et qui doit être analysé en tant que tel, mais sans exclure pour autant « les liens directs qui existent entre les structures sociales et l’ordre de l’interaction »138. Certes, les dimensions macrosociologiques sont très peu présentes dans l’œuvre de Goffman. Mais elles n’en sont pas totalement absentes, dans le sens où il fait l’hypothèse d’ « un lien non exclusif, un « couplage flou » entre des pratiques interactionnelles et les structures sociales »139. Cette hypothèse signifie, comme l’ont souligné Jean Nizet et Natalie Rigaux, que pour Goffman :
il n’y a pas de déterminisme simple allant du macrosociologique vers le microsociologique, ni inversement. En fait, différents cas de figure peuvent être observés. Tantôt le niveau microsociologique influence le niveau macrosociologique ; tantôt c’est à l’inverse le niveau macro qui influence le niveau micro ; tantôt on observe une autonomie du niveau micro : ce qui se passe dans l’interaction peut alors être expliqué par l’ordre de l’interaction, sans qu’il y ait lieu de faire intervenir une quelconque explication macrosociologique. »140
L’analyse des pratiques interactionnelles mises en œuvre par les Katangais et les Kasaïens dans leurs relations sociales ordinaires, que propose la thèse, prend en compte les dimensions macrosociologiques. Elle met ainsi en évidence l’incidence de certains contextes macros – politiques ou socio-économiques – sur ces pratiques (cf. infra). En outre, les pratiques étudiées dans la thèse sont précisément mises en œuvre parce que les enquêtés se définissent en tant que Kasaïen ou Katangais. Si l’appartenance ethno-régionale a bien une influence sur le déroulement des situations d’interaction, l’enquête de terrain n’a, en revanche, pas apporté d’indices laissant supposer que d’autres propriétés sociales, tels le statut socio-économique, l’âge ou le genre, ont un effet sur les pratiques mobilisées dans les interactions quotidiennes.
Les travaux de Goffman montrent que l’ordre de l’interaction est un ordre social normatif : Contrairement à la vision commune qui considère que les individus agissent comme selon leur « nature », leur « personnalité » ou encore selon leur « humeur », Goffman appréhende l’interaction comme un ordre social. Celui-ci comprend des règles que les individus doivent suivre s’ils veulent apparaître comme des gens normaux. Lorsqu’il s’intéresse aux comportements les plus infimes, les plus ordinaires des individus, ce qui préoccupe Goffman, c’est de mettre en évidence les règles sous-jacentes qui structurent les interactions sociales. »141
Cet ordre social se caractérise par une vulnérabilité intrinsèque. Ce qui est vulnérable dans la situation d’interaction, c’est la « face » de chacun des participants – entendue « comme étant la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier »142 – et par là même la situation d’interaction elle-même. Pour éviter qu’elle ne s’achève abruptement, dans la gêne ou l’embarras, les personnes engagées dans une situation d’interaction mettent en œuvre des « techniques de gestion sociale » qui permettent d’anticiper son déroulement et de « se comporter conformément aux attentes des [autres participants], qui sont des attentes normatives sociales, exprimant ce que c’est que se comporter normalement dans telle ou telle situation »143 : en présence d’autrui, nous devenons vulnérables à ses paroles et gesticulations, qui peuvent pénétrer nos réserves psychiques, et aux ruptures de l’ordre d’expression que nous nous attendons à voir maintenir en notre présence. (…) Il y a donc des possibilités et des risques inhérents à la co-présence corporelle. Comme ces éventualités sont très réelles, elles ont toute chance de donner partout naissance à des techniques de gestion sociale »144.
Les « rites d’évitement », que Goffman définit comme des « proscriptions, interdictions et tabous qui obligent une personne à s’abstenir de certains actes de peur de violer le droit des autres à garder leurs distances »145, occupent une place primordiale parmi ces techniques de gestion sociale, au point que Goffman fait l’hypothèse qu’on « pourrait, avec profit, étudier n’importe quelle société en tant que système d’accords de non-empiètement »146.
Cette hypothèse s’est révélée particulièrement pertinente pour appréhender les interactions qui ont lieu entre Katangais et Kasaïens depuis les violences du début des années 1990. Certes, la société étudiée par Goffman – à savoir la société urbaine américaine qui lui était contemporaine – est très différente de celle qui est étudiée dans cette thèse, ne serait-ce que parce que les relations entre Katangais et Kasaïens se produisent dans un quotidien qui a été transformé par les effets des violences de masse. Cependant, on peut faire l’hypothèse que dans un tel contexte, la vulnérabilité de la situation d’interaction est ressentie avec plus d’acuité ; et que cette perception rend plus nécessaire encore la mise en œuvre de techniques de gestion sociale permettant d’anticiper le déroulement des situations d’interaction et d’apporter une certaine stabilité dans ces interactions. En outre, comme l’a souligné Yves Winkin147, la postérité de la sociologie goffmanienne et son usage dans des travaux relevant de disciplines scientifiques diverses148 et portant sur des sociétés appartenant à différentes aires culturelles s’expliquent notamment par le fait que cette sociologie est construite à partir de généralisations théoriques et de « toutes petites notions » 149 , dissociables les unes des autres et flexibles, qui, de ce fait, peuvent être facilement utilisées pour étudier d’autres sociétés que celle à partir de l’étude de laquelle elle a été forgée.
Des pratiques de coexistence fondées sur l’évitement, le silence et les non-dits
L’hypothèse de départ de la thèse était la suivante : parce qu’ils sont contraints de vivre côte à côte sur un même territoire, les Katangais et les Kasaïens mettent en œuvre, dans le cadre de leurs interactions quotidiennes, des pratiques de coexistence fondées sur l’évitement, le silence et les non-dits. Cette hypothèse était inspirée à la fois par les travaux de Goffman, et en particulier son hypothèse d’étudier toute société comme un « système d’accords de non-empiètement », et par ceux de Deepak Mehta et Roma Chatterji et de Karine Vanthuyne.
Dans leur étude sur la vie quotidienne à Dharavi, un bidonville de l’ancienne Bombay, après les émeutes de décembre 1992 et janvier 1993150, Deepak Mehta et Roma Chatterji analysent la manière dont les relations interpersonnelles entre hindous et musulmans sont négociées dans un quotidien qui a été transformé par les effets du danga, nom par lequel les habitants de Dharavi désignent les émeutes. Dans les années qui ont suivi les émeutes – période au cours de laquelle Mehta et Chatterji ont mené leur enquête de terrain – les hindous et les musulmans avaient une perception stéréotypée des membres de l’autre communauté confessionnelle ; et ils les considéraient comme dangereux. Du fait des émeutes, la violence était devenue le principal marqueur identitaire : être un musulman, c’était être en conflit avec les hindous (et inversement)151. L’étude de Mehta et Chatterji montre que dans ce quotidien transformé par les émeutes, hindous et musulmans mettent en œuvre des stratégies de survie et de coexistence (« strategies of survival and coexistence »152). L’une des principales stratégies mises en œuvre par les habitants de Dharavi consiste en une mise à distance des violences passées et de leurs souvenirs, dans les situations d’interaction avec les membres de l’autre communauté :
Le quotidien est non seulement marqué par un nouveau savoir, et une nouvelle mémoire, de la perte. Il est aussi marqué par une sagesse pragmatique sur la manière de gérer cette perte. Cette sagesse stipule que la réparation ne peut prendre la forme de la justice et que la co-existence n’est possible que si le passé est délibérément mis de côté. »153
Les conclusions de Mehta et Chatterji sont proches de celles faites par Karine Vanthuyne, dans ses travaux sur, d’une part, la réappropriation du registre de la victimisation, porté par des ONG spécialisées dans la justice de transition, par des paysans d’origine maya ayant survécu aux massacres commis par l’armée guatémaltèque, et, d’autre part, leurs relations avec les habitants des villages où ils se sont réfugiés et où ils cohabitent avec les personnes qui les avaient dénoncés à l’armée. Vanthuyne constate que les survivants des massacres sont contraints à adopter « une sorte de « parole clivée » et de double présentation d’eux-mêmes. Leurs propos signalent les formes de censure s’exerçant sur eux selon ce qu’il est permis de dire en public [c’est-à-dire à des représentants des ONG] ou dans l’entre-soi du privé [c’est-à-dire hors de la présence des représentants des ONG] »154. Plus précisément, ce qu’observe Vanthuyne c’est, d’une part, une réappropriation et un détournement du registre de la victimisation par les survivants des massacres dans leurs relations avec les ONG, et au-delà avec l’Etat guatémaltèque, qui visent à la fois la reconnaissance d’un statut de victimes pour les violences passées mais aussi pour des violations qui perdurent 155 (à savoir l’extrême pauvreté des paysans d’origine maya) et, d’autre part, la mise en œuvre de pratiques fondées sur l’évitement et l’autocensure dans leurs interactions avec les habitants des villages où ils se sont réfugiés : la victimisation (…) est (…) une stratégie de reconnaissance publique, ainsi qu’une nouvelle forme de gagne-pain, mises en avant principalement sur les scènes nationales et internationales grâce auxquelles les survivants peuvent faire entendre les injustices subies et leurs revendications nouvelles. Mais au sein des espaces locaux où ils cohabitent au jour le jour avec leurs anciens délateurs, évitement, autocensure et/ou discrétion sont plus généralement pratiqués. (…) Si les survivants de Tut se souviennent du massacre des leurs comme d’une violation de leurs droits, ils se souviennent également des accusations de leurs voisins qui provoquèrent la mort brutale des leurs, de la guérilla qui n’était pas là pour les protéger quand l’armée vint à Tut les assassiner, et des gens de Wa’il qui peu à peu leur permirent de vivre à leurs côtés et avec lesquels ils cohabitent depuis au quotidien. De cette expérience résulte l’alliance contradictoire chez ces personnes de représentations d’eux-mêmes ambivalentes, ainsi que la coexistence de stratégies de luttes contre l’impunité au niveau national et international avec un accommodement local avec celle-ci allant jusqu’au silence sur les malheurs vécus. »156
En s’inspirant des travaux de Michael Pollak, Vanthuyne estime que le silence sur les violences passées peut être analysé comme « un mode de gestion de la mémoire » résultant des « conditions sociopolitiques qui (…) contraignent la prise de parole »157. En d’autres termes, les silences des survivants des massacres rendent compte de l’impossibilité d’énoncer une mémoire individuelle qui intègre la complexité du conflit armé guatémaltèque, en particulier leurs relations ambiguës avec la guérilla, étant donné le « contexte discursif dominant »158 qui ne leur reconnaît qu’un rôle passif, celui de « victimes innocentes » d’un conflit entre l’armée et la guérilla.
Dans la thèse159 , on verra que dans leurs interactions quotidiennes, les Katangais et les Kasaïens tendent eux aussi à éviter les sujets rappelant les violences passées. En s’appuyant sur les travaux de Pollak et Vanthuyne, la thèse montrera que le silence sur ces violences au niveau micro fait écho au silence des autorités politiques et administratives nationales et locales, qui ont adopté une rhétorique de l’unité et de la réconciliation nationales, qui contribue à faire des violences un sujet tabou entre Katangais et Kasaïens.
Situations de crise et déplacement de l’évitement
Le premier terrain, mené du 10 février au 11 mars 2009, a permis de confirmer l’hypothèse de départ de la thèse. Les données recueillies au cours de ce terrain montraient en effet que depuis les violences du début des années 1990, les Katangais et les Kasaïens mettent en œuvre, dans leurs interactions quotidiennes, des pratiques de coexistence fondées sur l’évitement, le silence et les non-dits. C’était particulièrement évident à Likasi, où s’était déroulé l’essentiel du terrain160 et où le conflit entre Katangais et Kasaïens était alors endormi. Le deuxième terrain, réalisé du 16 novembre 2011 au 14 janvier 2012, dans le contexte des élections présidentielle et législatives de novembre 2011, m’a obligée à questionner cette hypothèse, qui me semblait pourtant bien établie. Dans ce contexte électoral, les références explicites aux violences passées étaient en effet très fréquentes dans les situations d’interaction. Si ce type de références n’étaient pas absentes lors du premier terrain, elles étaient beaucoup moins fréquentes161 et toujours interprétées par ceux qui me les rapportaient comme le fait de personnes dont le comportement était présenté comme anormal, car supposément « ivres » ou « droguées », et/ou expliqué par leur statut social (les gens des « milieux reculés »).
Autre différence entre les deux terrains : durant les trois premières semaines du deuxième terrain – soit avant l’annonce des résultats provisoires de l’élection présidentielle, le 9 décembre 2011 – j’ai eu l’impression que le terrain et les enquêtés me résistaient. Il me fallut ainsi attendre huit jours pour obtenir un premier entretien. Durant cette période, à trois reprises, un Kasaïen, que j’avais interviewé lors du premier terrain, soit ne vint pas au rendez-vous, soit l’annula au dernier moment. Un autre Kasaïen, que j’avais également interviewé au cours du premier terrain et qui, le 3 décembre 2011, avait accepté de me rencontrer à nouveau, repoussa à plusieurs reprises la fixation d’une date, jusqu’à ce que j’aille le chercher sur son lieu de travail, le 9 janvier 2012. Les résistances des enquêtés se poursuivirent en effet au-delà des jours qui suivirent la proclamation des résultats de la présidentielle, mais dans une moindre mesure. Surtout, j’avais alors compris que ces résistances faisaient partie du terrain, dans le sens où elles reflétaient les tensions entre Katangais et Kasaïens qui existaient alors, et la peur qui caractérisait leurs interactions. Dans mes relations avec les enquêtés, les tensions et la peur se manifestaient, par exemple, de la manière suivante : un membre de la Commission Justice et Paix à Kolwezi m’appela un matin à 6 h 30 pour annuler un entretien qui avait été fixé par téléphone trois jours plus tôt ; il expliqua son revirement en disant qu’il avait « parlé avec d’autres personnes » de ma prochaine visite et que « sur leur conseil », il préférait annuler le rendez-vous, car c’était un sujet « très délicat »162. Un Katangais utilisa le même adjectif (« C’est délicat ») pour refuser l’enregistrement de l’entretien. C’est le seul cas au cours des deux terrains où un enquêté s’opposa à l’enregistrement. Ce fut d’autant plus surprenant que j’avais interviewé ce Katangais au cours du premier terrain et qu’il avait accepté que j’enregistre l’entretien, sans la moindre discussion, et alors même que nous nous étions rencontrés seulement une vingtaine de minutes auparavant.
Table des matières
Introduction
1. Autochtonie, ethno-régionalisme et mobilisations identitaires au Katanga : le cadre d’analyse
2. Une fabrique normative et volontariste de la réconciliation « par le bas »
3. Ecrire sur la pacification « par le bas »
4. Les interactions quotidiennes après des violences de masse : problématique de la recherche et approche théorique
5. Situations de crise et déplacement de l’évitement
6. Méthodologie et rapport au terrain
Plan de la thèse
Chapitre 1 – La formation des consciences ethno-régionales katangaise et kasaïenne dans le Katanga colonial
1. Mise en valeur coloniale et hiérarchisation des groupes ethno-régionaux
2. Les associations socio-culturelles et la cristallisation des identités katangaise et kasaïenne comme identités antagonistes
Chapitre 2 – Dire et écrire les violences contre les Kasaïens
1. De la difficulté à établir un bilan des violences
2. De la surinterprétation et de la sous-interprétation des « provocations » des Kasaïens
3. Brutalisation du champ politique katangais et exclusion des Kasaïens
Chapitre 3 – Coexister après les violences : pratiques de l’évitement et du non-dit
1. Un quotidien transformé par les violences contre les Kasaïens
2. La peur de se dire kasaïen
3. Les non-dits comme norme interactionnelle de coexistence pacifique
4. Dire autrement les violences
Chapitre 4 – L’Association des Faiseurs de Paix et la diffusion d’une « culture de la paix » à Likasi
1. L’Association des Faiseurs de paix et la pacification « par le bas »
2. Les autorités politico-administratives et l’efficacité des actions de pacification de l’Association des Faiseurs de paix
Chapitre 5 – Situations de crise et polarisation des identités katangaise et kasaïenne
1. Retours massifs des Kasaïens et situations de crise
2. Compétition électorale entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi et situation de crise
3. Simplification et polarisation des identités collectives en situation de crise
Conclusion générale
1. La réconciliation : un processus « par le haut »
2. Les relations interpersonnelles dans les contextes post-violences de masse : évitement, silence et non-dits
3. Représentations collectives et logiques de distinction
4. Le Katanga au coeur du contexte électoral de 2016
Bibliographie
Annexes