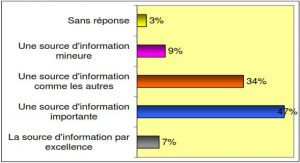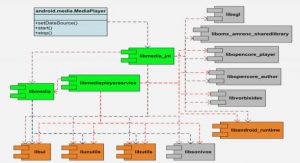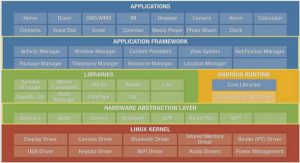La théorie du « seed » and « soil » :
Alors que la théorie dominante à cette époque est celle développée par Virshow selon laquelle les métastases s’expliquent par l’embole des cellules tumorales au niveau des arbres vasculaires capillaires [29], Stephen Paget, chirurgien anglais formule sa théorie du « seed » and « soil ». En 1889, il publie une étude dans le Lancet, basée sur l’autopsie de 735 patientes atteintes de cancer du sein et montre une absence de corrélation entre le degré de perfusion des organes et leur susceptibilité aux métastases. Il constate une haute incidence des métastases au niveau du foie, des ovaires, des os, et au contraire peu, voire pas, de métastases au niveau de la rate [30]. Il constate donc la nécessité pour le développement tumoral (la graine) d’un environnement permissif (le sol) qui est la base de sa théorie de la graine et du sol. Cette théorie, un temps contestée, a finalement été validée à partir des années 70 par les travaux de Fidler et al. [31], ainsi que de Hart et al. [32], En effet, si les cellules tumorales circulent au travers de l’ensemble du réseau vasculaire, le développement métastatique reste contraint à certains organes spécifiques [31, 32].
Application à la métastase ovarienne :
Près d’un siècle après les travaux de Paget, l’étude de Tarin de 1984 est une parfaite illustration de la théorie du « seed and soil » dans le cancer de l’ovaire. A cette époque, l’introduction du shunt péritonéo-veineux pour les patients atteints de cancer pelvien avec ascite réfractaire a permis une observation chez l’homme du processus métastatique. Les shunts mis en place étaient nécessairement unidirectionnels avec une valve à sens unique et sans aucun filtre qui serait à l’origine d’une obstruction rapide de l’anastomose (Figure 7) [33]. Parmi les 27 patients de sa série, 15 ont été autopsié après leur décès, dont 9 patientes atteintes de cancer de l’ovaire. Tarin n’observe alors pas plus de métastases chez ces patients et ceux malgré les millions de cellules tumorales déversées dans leur circulation générale [33]. Il observe même plus de la moitié de ces patients sans métastase malgré parfois une survie longue jusqu’à 27 mois avec shunt en place (dont 6 patientes avec cancer de l’ovaire). Chez certains patients, il observe quelques cellules tumorales dans les tissus sans métastase développée. Chez d’autres, les métastases se sont développées dans d’autres organes que ceux contenant les premiers capillaires traversés par les cellules tumorales. Tarin a même quantifié le contenu de chaque ascite en cellules tumorales et vérifié la viabilité de ces cellules : il retrouve entre 1 et 60 millions de cellules tumorales viables pour 100mL d’ascite. Enfin, il a testé la capacité de formation de colonies dans de l’agarose et retrouve une clonogénicité de 1/1000 à 1/10000 [33]. Cette étude est donc majeure dans la compréhension des mécanismes de formation de la métastase chez l’homme et confirme bien que ce processus n’est pas lié au hasard mais est le résultat d’un mécanisme impliquant à la fois les cellules tumorales et son hôte.
Théories actuelles des mécanismes de la dissémination métastatique :
Il est actuellement communément admis que la métastase n’est pas liée au hasard mais bien déterminée par les caractéristiques de la tumeur et de son hôte au cours d’une cascade « invasion-métastase » [34]. Ce sont les transformations génétiques et épigénétiques de la tumeur et des cellules stromales environnantes non tumorales qui sont à l’origine de la progression tumorale. Valastian et Weinberg décrivent les étapes de cette cascade (Figure 9) dont je vais détailler les quelques étapes clés permettant d’introduire la problématique de la dissémination tu morale dans le cancer de l’ovaire [34].