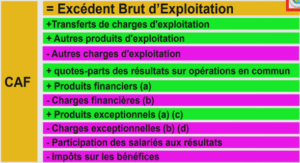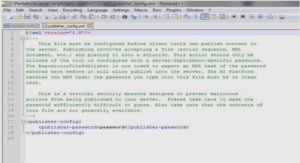La procédure de faillite est omniprésente dans nos sociétés néolibérales et totalement acquises à l’économie de marché. Comme le soulignait Frank BORMAN: “Capitalism without bankruptcy is like Christianity without hell” .
Apparue durant l’Antiquité romaine, la faillite a plus au moins disparue des systèmes juridiques aux premiers temps du Moyen-Âge pour réapparaitre à la fin de celui-ci avec l’âge d’or des marchands vénitiens. Cependant, avec la mise en place progressive des Etats-nations au XIXème siècle, les systèmes juridiques vont prendre des chemins différents et voir apparaître des spécificités nationales. La Belgique fraîchement indépendante va se doter de sa première législation en matière de faillite le 18 avril 1851 . La Suisse – les cantons urbains et protestants ayant pu asseoir l’autorité d’un véritable Etat fédéral à la suite de la guerre du Sonderbund – va se doter d’une législation fédérale concernant (entre autres) la faillite le 11 avril 1889.
La sélection d’une comparaison entre le droit belge et le droit suisse – outre les motifs d’ordre personnel – tient surtout à la différence entre le choix de désigner un titulaire d’une profession libérale (un avocat) afin d’administrer la faillite en Belgique et celui de fonctionnariser ce rôle en Suisse.
Ainsi, le présente travail de fin d’études ne portera pas sur un travail de droit comparé à propos de l’ensemble des différences entre les procédures de faillite belge et helvétique – bien que probablement très intéressante et instructive, une telle comparaison dépasserait largement le cadre d’un TFE. En effet, le présent travail se bornera à comparer le principal acteur desdites procédures nationales, à savoir le curateur en Belgique et l’office des faillite en Suisse.
En effet, comment le droit belge ainsi que le droit suisse répondent-ils à la nécessité d’instituer des acteurs compétents afin d’administrer la faillite ?
En Belgique, le législateur a choisi de confier l’administration de la faillite à un titulaire d’une profession libérale (à savoir un avocat ou une profession libérale lorsqu’il s’agit d’un cocurateur). Par conséquent, le curateur n’est pas un fonctionnaire. A l’inverse, le législateur suisse a choisi de confier l’administration de la faillite à un office composé de fonctionnaires. Cependant, la législation suisse permet aux créanciers de confier la faillite une administration privée de leur choix. Ainsi, l’office n’est qu’un choix par défaut en Suisse. Par ailleurs, les deux ordres juridiques instituent des organes ayant pour mission de surveiller l’administration de la faillite .
La comparaison de l’administration de la faillite entre les droits belge et suisse révèlent de nombreuses similitudes mais aussi des différences dont la plus notables est l’implication accrue des créanciers dans la procédure en Suisse .
Par ailleurs, la distinction susmentionnée entre titulaire d’une profession libérale et fonctionnaire crée une différence dans le régime de la responsabilité des acteurs. En effet, le curateur est personnellement responsable, tandis que les membres de l’office des faillites peuvent entraîner la responsabilité de l’Etat, c’est-à-dire la responsabilité du canton pour lequel ils travaillent .
Droit belge
Le curateur
Notion
Le curateur (de Curator, der Kurator) est l’agent central de la faillite en Belgique. Il est « chargé de réaliser les biens et d’en répartir le produit de réalisation entre les créanciers du failli » . Il gère la faillite en bon père de famille . Le curateur entre en fonction à la suite du jugement déclaratif de faillite et lorsqu’il a accepté sa mission via REGSOL (le Registre Central de la Solvabilité) . Sa mission se termine par le décès du curateur, sa démission ou son remplacement , ou par la clôture de faillite .
Il doit s’agir d’un avocat inscrit au tableau d’un ordre des avocats. Cependant, depuis la loi du 11 août 2017, il lui est adjoint un co-curateur lorsque le failli est titulaire d’une profession libérale. Le co-curateur doit être titulaire de la même profession libérale que le failli .
Origine historique
La notion de curateur remonte au droit romain. En effet, le droit romain voit l’apparition de la première procédure collective de liquidation : la venditio bonorum. Il s’agit du « prototype de la poursuite en cas de faillite, [la procédure] consiste dans la vente aux enchères des biens d’un débiteur insolvable à un acheteur (bonorum emptor) qui acquiert l’actif de ce débiteur, en même temps qu’il est tenu de payer aux créanciers de celui-ci un certain pourcentage de leurs créances. La procédure à un caractère infâmant pour le débiteur » . Les biens sont administrés par un syndic mais vendu par un curator (distractio bonorum) .
Au Moyen-Age, les communes italiennes – grandes pourvoyeuses de commerçants – modernisent le droit romain mais laisse toujours l’initiative et l’exécution de la faillite aux créanciers. Le droit italien va s’impose aussi en France. Il sera codifié par l’Ordonne de Colbert du 16 mars 1673 . Cependant, dans la partie germanique de l’Europe apparaît une autre conception du droit de la faillite. La faillite n’est pas confiée aux créanciers comme sous le droit romain, elle est réglée par l’autorité publique .
Le Code de commerce français de 1807 codifie le droit de la faillite dans son entièreté. Cependant, elle abandonne la notion de curateur et préfère la notion de syndic. En effet, il est reproché à l’institution du curateur d’être une profession de « purs mercenaires » qui profiteront de la faillite d’un débiteur pour s’enrichir, tandis que le syndic est un créancier qui aura tout intérêt à administrer et liquider de façon convenable la faillite .
Le droit belge se dote d’une législation propre en matière de faillite le 18 avril 1851 . Cette loi abandonne la notion de syndic et instaure (à nouveau) l’institution du curateur qui est nommé par les tribunaux . Ainsi, la faillite n’est plus confiée par les créanciers à un syndic nommé par eux. Désormais, la faillite sera attribuée à une personne qui offre « le plus de garanties pour l’intelligence et la fidélité de leur gestion » par l’autorité publique (les tribunaux).
La loi du 8 août 1997 sur la faillite conserve l’institution du curateur en son article 11.
La réforme du droit de l’insolvabilité en 2017 , conserve également la notion de curateur. Cependant, cette réforme va apporter certaines modifications. Le curateur fait désormais partie de la catégorie des « praticiens de l’insolvabilité », définie de la manière suivante, par l’article I.22 du Code de droit économique :
« toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titres intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes :
i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ;
ii) représenter l’intérêt collectif des créanciers ;
iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi ;
iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers ; ou
v) surveiller la gestion des affaires du débiteur ».
Par ailleurs, la réforme de 2017 introduit aussi l’institution du co-curateur.
Introduction |