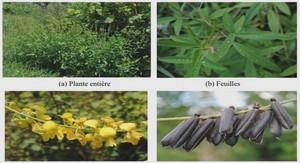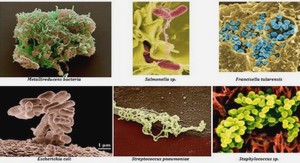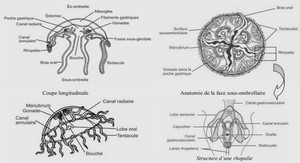La Filière laitière périurbaine d’Abéché
Typologie des systèmes de production animale
Au Tchad, trois systèmes d’élevage sont décrits à savoir le système pastoral transhumant et nomade, le système agropastoral et le système périurbain.
Système extensif pastoral transhumant et nomade
Le nomadisme est un système de production animale qui existe surtout chez les chameliers dans les zones désertiques et subdésertiques chaudes. Les pasteurs se déplacent sans point d’attache fixe (Yosko, 1994). L’élevage extensif, en raison de l’irrégularité des précipitations et la variabilité des ressources, est pratiqué dans des régions où la terre est peu fertile et il n’y a, pratiquement, pas d’autre utilisation possible de la main d’œuvre. Le système pastoral a des possibilités limitées d’amélioration car il n e laisse pas de place à une intensification fourragère (Pagot, 1985). Le système extensif saisonnier reste dominant et dans la sélection des animaux mâles ou femelles, le critère de production laitière est toujours prépondérant. Le maximum de naissances a lieu en saison froide, en janvier (14,5%) et en saison des pluies, en juillet (11%) (Coulomb et al, 1981). Les petits transhumants sahéliens à faible déplacement de 25 à 60 km, restent dans les environs des terroirs et les grands transhumants se déplacent entre 200 et 500 km. Sur le long terme, les systèmes pastoraux actuels et le développement économique de ces éleveurs paraissent fortement menacés et il n’est pas évident que le développement de la performance technique de l’élevage pastoral 7 constitue un outil durable de lutte contre la pauvreté. Quatre facteurs en effet remettent en cause l’équilibre fragile : la croissance démographique et l’emprise agricole des parcours, le réchauffement climatique global et les perturbations des précipitations, la faible productivité financière de ces systèmes d’élevage et les besoins élevés en capital cheptel pour ces spéculations (Renard, 2002).
Système agropastoral sédentaire
L’élevage sédentaire peut représenter le vingtième de l’effectif d’animaux au Tchad. L’élevage est associé à l’agriculture et fournit du fumier, de la traction, ainsi qu’une réserve de ca pital (Coulomb et al, 1981). Les dynamiques d’intégration de l’agriculture et de l’élevage sont très variables d’une région à une autre. Ce système se pratique dans les villages sédentaires à vocation agricole. Les animaux reçoivent une complémentation à ba se d’intrants alimentaires issus des résidus de récolte et des sous-produits agro-transformés. Le nombre des vaches dans les troupeaux des agriculteurs tchadiens est voisin de 38% alors qu’il est de 79% chez les sédentaires du Niger (Pagot, 1985).
Système semi-intensif périurbain
La filière laitière a connu depuis 10 ans de profondes transformations liées à la privatisation de la laiterie d’État. La disponibilité en sous-produits agroindustriels dans le Sud du pays est susceptible de favoriser le développement de ces systèmes de production (MET, 2007). Le système semi-intensif a pour finalité la réalisation d’un profit monétaire. L’animal est un m oyen de transformation des ressources fourragères et des concentrés. Les systèmes de collecte généralement organisés avec des camions se sont dans beaucoup de cas heurtés aux problèmes de la dispersion et de la faible production des exploitations. Dans les années 1970, la collecte de lait a été assurée à N’Djamena au Tchad par la laiterie du Centre de modernisation des productions animales (CMPA), devenu Société Nationale des Productions Animales (SONAPA) en 1984 et ensuite Société Moderne Avicole et de Farine Animale (SOMAFA) en 1996. À partir de 1990, le relais est pris par des collecteurs motocyclistes évoluant sur un rayon de 60 km autour de la capitale N’Djamena pour l’approvisionnement des bars laitiers et arrive à couvrir environ 60% de la consommation (Duteurtre et al, 2000). Les points de collecte constituent des segments indispensables à intégrer dans la structuration de la filière lait. Le marché du lait à N djamena est organisé et constitue un puissant moyen de développement du revenu des éleveurs. L’élevage en dépit de son rôle prépondérant dans l’économie nationale est confronté à des contraintes pour son développement. Des stratégies sont élaborées par les différents systèmes de production pour réduire ces contraintes. 8 Chapitre 3. Stratégies dans les systèmes de production Les stratégies de conduite du troupeau varient d’un système d’élevage à l’autre.
Stratégies dans les systèmes transhumants et nomades
Les systèmes extensifs représentent 80% du cheptel. Pour s’adapter aux conditions climatiques, les éleveurs ont adopté la transhumance, comme stratégie adaptée à la grande variabilité des ressources pastorales. La mobilité constitue une stratégie de production et de gestion de risques. Les éleveurs préfèrent, souvent, des zébus à robe blanche, rustiques, aptes à de longues marches et supportant la soif, la chaleur et une alimentation déficitaire. Les températures ambiantes élevées réduisent la fertilité des animaux et augmentent l’intervalle entre lactations (Pagot, 1985). Pour des décisions liées à la gestion du troupeau, le chef de famille évalue les avantages et les contraintes en fonction de sa propre stratégie pour assurer sa survie dans des conditions aléatoires (Yosko, 1994). Dans le cadre de leur déplacement et de l’accès à l’exploitation des ressources pastorales, les éleveurs ayant des objectifs communs de production s’organisent sur la base de relations de parenté ou d’alliance. La mobilité permet de protéger les animaux de la première poussée d’herbe, de rompre des cycles parasitaires et d’utiliser des cures salées. Dans les troupeaux d’éleveurs, on t rouve toujours un n oyau laitier de 2 à 4 vaches laitières sélectionnées pour l eurs critères laitiers. Les zébus arabes souvent à robe blanche, donnent des petits tous les ans et ne produisent du lait que durant 2 à 3 mois en saison des pluies. Les femelles sont ensuite sevrées précocement par la technique du tarissement volontaire, par réduction de nombre de traite et des tétées du veau, pour éviter aux vaches des mises-bas de saison sèche et leur permettre de revenir rapidement en chaleur puis en gestation et mettre bas la saison des pluies suivante (Bada et al, 1995).
Stratégies dans les systèmes de production agropastoral
L’épargne avec des animaux est surtout le fait des agriculteurs sédentaires qui investissent leurs économies dans les troupeaux. L’agriculture intervient en complément de l’élevage et permet en bonne saison de récolte de pallier le prélèvement sur le troupeau pour l’achat de céréales. Le confiage d’animaux par les sédentaires à des transhumants apparaît sous deux formes. Les animaux sont confiés de manière transitoire pendant la saison des pluies pour permettre de les éloigner des champs et des zones humides ou en permanence pendant plusieurs années, le temps nécessaire pour ces agriculteurs d’acquérir des techniques d’élevage. Les agriculteurs vont reprendre leurs animaux et élèvent leurs troupeaux eux-mêmes pour bénéficier de la fumure organique et la traction (Barraud et al, 2001). Le bétail est utilisé pour l’exhaure de l’eau et de plus en 9 plus fréquemment pour la culture attelée. La culture attelée permet de réduire la fatigue du t ravail de la terre, d’accroître les surfaces cultivées par actif et de mieux rentabiliser la main-d’œuvre (Coulomb et al, 1981). Les échanges commerciaux entre nomades et sédentaires sont fréquents et directs et plus importants que les échanges passant par l’intermédiaire des marchés (Barraud et al, 2001).
DEDICACES |