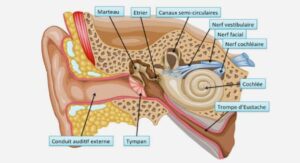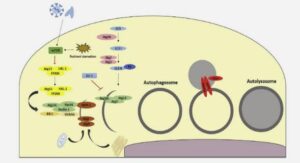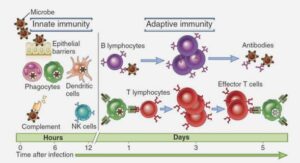La fibromyalgie
La fibromyalgie a été reconnue en 1992 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant une maladie rhumatismale (Belgrand & So, 2011). Elle est ainsi définit par Cohen (2012) : « Etat douloureux chronique altérant la qualité de vie. […] La douleur diffuse, persistante, musculaire et en apparence inexpliquée, est le symptôme majeur et constant. […] L’origine probablement centrale est complexe et à l’évidence multifactorielle. » (p. 11-12). La fibromyalgie se manifeste principalement par des douleurs chroniques, diurnes et nocturnes, dans plusieurs parties du corps. Ces douleurs sont d’autant plus particulières qu’elles sont présentes au repos et exacerbées par certains facteurs comme « l’effort, la fatigue, le stress, le changement de temps et le froid » (Volken, 2013). La fibromyalgie est souvent associée à une asthénie chronique, des troubles du sommeil, une raideur matinale, des migraines et céphalées de tension ainsi que des troubles digestifs fonctionnels. L’état dépressif peut être ajouté à ce tableau en tant que réaction secondaire aux maux cités précédemment. Ces symptômes sont présents chez la plupart des patients bien qu’il soit peu aisé de définir une symptomatologie commune à toutes les personnes atteintes de fibromyalgie (Belgrand et al., 2011 ; Cohen, 2012 ; Wierwille, 2012).
A cela s’ajoute le fait que cette affection chronique a le désavantage d’avoir une évolution souvent instable, alternant des phases d’exacerbation et d’affaiblissement des symptômes, ce qui peut se révéler très déstabilisant et angoissant pour la personne (Blotman, Boulenger, Capdevielle & Thomas, 2003). La fibromyalgie n’est actuellement pas bien connue du monde biomédical et scientifique et son étiologie reste une question ouverte à laquelle aucun consensus n’a abouti (Wierwille, 2012). Néanmoins, une majorité d’auteurs s’accordent pour dire que l’origine de la FM est certainement multifactorielle. Par conséquent, les différents facteurs favorisants peuvent tous être classés selon deux catégories : les stresseurs physiologiques et les stresseurs psychologiques (Wierwille, 2012). De part cette étiologie peu claire et indéterminée, il n’est pas chose aisée que de poser le diagnostic de fibromyalgie. Il est principalement basé sur un diagnostic différentiel, c’est-à-dire qu’un certain nombre de pathologies, présentant une symptomatologie proche, doivent être écartés avant de pouvoir dire qu’il s’agit bel et bien d’une fibromyalgie (Wierwille, 2012). Volken (2013) parle d’ailleurs d’approximativement 4 ans « d’attente » après l’apparition des premiers symptômes avant que celui-ci ne soit posé.
Afin d’affiner le diagnostic de la fibromyalgie, l’American College of Rheumatology (ACR) a établi deux points de référence qui sont : (1) que la douleur doit être présente sur une durée d’au moins 3 mois et localisée dans les 4 quadrants corporels (bilatéralement, supérieur et inférieur) et (2) la personne répond de manière positive à la douleur à au moins 11 tender-points sur les 18 (Volken, 2013 ; Wierwille, 2012). A savoir que les tender-points sont définis par Volken (2013) comme étant des « points douloureux à la pression se situant au niveau de la nuque, de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne ainsi qu’aux coudes et aux genoux (insertions musculaires) » et qu’ils sont testés en appliquant une pression avec le pouce d’environ 4 kg. A ce jour, il n’existe aucuns examens confirmant le diagnostic de fibromyalgie bien que certaines études se penchent actuellement sur les IRM fonctionnelles du cerveau. Cependant, il est encore trop tôt pour dire si cela constitue un moyen sûr pour le diagnostic. C’est pour cette raison, entre autres, que la fibromyalgie reste une pathologie mal comprise et parfois reniée par certaines personnes du corps médical. En effet, ce diagnostic ne fait pas l’unanimité et reste controversé car il repose sur le caractère subjectif de la douleur de chaque patient (Wierwille, 2012). Ceci représente un réel problème de santé publique car le corps soignant doit faire face à des personnes qui présentent, comme le mentionne Belgrand et al. (2011) « un état douloureux chronique diffus sans cause nociceptive périphérique démontrable » (p. 604), c’est-à-dire sans signes cliniquement objectivables, mais qui souffrent tout de même. De plus, de par son fonctionnement physiopathologique non élucidé, les traitements actuels proposés sont peu efficaces, car ils sont non curatifs mais centrés sur une amélioration de la gêne fonctionnelle (Aïni, Curelli-Chéreau & Antoine, 2010).
En plus d’être une pathologie difficile à cerner et à soigner, la fibromyalgie est une affection de plus en plus courante dans les pays industrialisés. En Suisse, la prévalence est de plus de 2%, soit environ 150 000 personnes, et son incidence tend à augmenter avec l’âge. Elle touche principalement des femmes, à raison de 70 à 90% des cas, de type caucasien et ayant une moyenne d’âge située aux alentours de 40 ans (Association Suisse des Fibromyalgiques (ASFM), 2013 ; Volken, 2013). Selon Belgrand et al. (2011), la fréquence dans les consultations de médecine générale est de 2 à 6% et d’environ 14 à 20% dans les consultations rhumatologiques. Selon l’Association Suisse des Fibromyalgiques (2013) « la fibromyalgie reste non reconnue en Suisse et donc mal soutenue par l’Assurance Invalidité (AI), entre autres ». Hallberg et Carlsson (1998) résument très bien ce qui a été décrit dans cette première partie :
Le proche aidant
Comme vu précédemment, la fibromyalgie est une maladie chronique altérant fortement et durablement la qualité de vie des personnes atteintes, et ce dans de nombreux domaines. Pourtant, cette notion de chronicité n’implique pas seulement une persistance dans le temps, mais également une idée de soins à domicile et d’implication des proches (Hunt, 2003). Ce nouvel élément conduit aux deux autres concepts de la question de recherche, à savoir les proches aidants et le prendre soin. Tout d’abord, Hileman, Lackey et Hassanein (1992) définissent le proche aidant comme étant « une personne non rémunérée qui aide une personne pour ses soins physiques ou à faire face à une maladie » (Hunt, 2003, p. 28). Outre le terme de proche aidant, ces personnes sont régulièrement nommées aidant-naturel, expression aujourd’hui fortement critiquée en raison de son caractère banalisant. Ducharme (1997) écrit à ce propos : Même si l’expérience de soignant peut être positive et apporter de nombreuses sources de satisfaction, est-il vraiment « naturel » d’offrir des soins parfois complexes à un membre de la famille, avec peu ou pas de préparation ? Pourtant, on considère ce rôle occulté comme « normal » et « naturel », même si ces soignants présentent souvent des signes de fatigue et souffrent de détresse psychologique ainsi que d’épuisement (p. 41).
Ce genre de débat montre que la situation des proches aidants est aujourd’hui soulevée et discutée. De nombreuses études se sont d’ailleurs penchées sur ces personnes prodiguant des soins quotidiens à leurs proches, notamment car ce phénomène existe depuis toujours et dans toutes les sociétés, mais également car leur présence et leur fonction sont aujourd’hui devenues indispensables dans un système de soin où le maintien à domicile est prôné et où les restrictions budgétaires dans le domaine sanitaire sont légion (Ducharme, 1997). A ce propos, la Suisse n’est pas en reste. Le Conseil Fédéral a en effet sorti un rapport sur la situation des proches aidants et des structures requises, notamment au vu de l’évolution démographique et de l’incapacité financière et humaine du système de soins helvétique à prendre en charge l’ensemble des personnes malades chroniquement (Conseil Fédéral, 2014). En effet, toujours selon le Conseil fédéral (2014), « environ 40 % de la population âgée de 50 à 64 ans souffrent d’une ou de plusieurs maladies chroniques. Ce pourcentage augmente avec l’âge pour dépasser les 70 % chez les personnes âgées de plus de 80 ans » et, actuellement, « quelque 330 000 personnes en âge de travailler apportent régulièrement soins et assistances à des proches.
Environ 700 000 personnes de tous âges sont ainsi tributaires d’une aide informelle ». Au vu de ces chiffres, la Confédération souligne que le système de soins ne peut être viable qu’avec l’aide des proches aidants, malgré la charge de travail considérable que cela peut représenter. En effet, les familles ont certes pris soin des leurs depuis la nuit des temps (Ducharme, 1997), mais les systèmes familiaux actuels, notamment avec la nécessité d’un deuxième salaire, l’activité professionnelle des femmes et des familles plus petites, rendent la prise en soin toujours plus lourde (Conseil fédéral, 2014). De plus, l’espérance de vie augmentant, les situations de prise en soin de maladie chronique ont logiquement tendance à se prolonger (Conseil Fédéral, 2014). Concernant la fibromyalgie, l’âge moyen du début des symptômes de cette affection se situe aux alentours de 40 ans (Volken, 2013), c’est pourquoi le proche aidant principal de la personne atteinte de fibromyalgie est le plus souvent son conjoint ou sa conjointe.
Le prendre soin
Le prendre de soin, traduit par care ou caring en anglais, a été et est toujours un concept majeur de la discipline infirmière, certains le considérant même comme la nature profonde de cette science (Pepin, Kérouac & Ducharme, 2010). Défini comme étant un « ensemble d’aspects affectifs et humanistes relatifs à l’attitude et à l’engagement, de même que des aspects instrumentaux ou techniques » (Pepin et al., 2010), le prendre soin semble être dévolu à l’infirmière. Pourtant, suite aux éléments évoqués précédemment, le prendre soin est également intimement lié au proche aidant, puisqu’il est l’essence même de ce rôle (Vigil-Ripoche, 2011). Florence Nightingale écrivait déjà en 1859 : « En Angleterre, toute femme a déjà, à un moment ou l’autre de sa vie, pris en charge la santé de quelqu’un, enfant ou invalide ; autrement dit, toute femme est infirmière » (Ducharme, 1997, p. 40). Toutefois, le soin non-professionnel ou informel diffère du soin professionnel sur de nombreux aspects, en commençant par “son association à l’émotionnel, par opposition au rationnel” (Tronto, 2009). Walter Hesbeen (1999) pousse la comparaison encore plus loin en écrivant : « il [le prendre soin informel] s’inscrit également dans un acte de vie avant même que d’apparaître comme le pourtour qui caractériserait telle ou telle profession » (p. 8). L’étendue du prendre soin informel est donc particulièrement vaste et fait partie d’un processus beaucoup plus profond et substantiel de la condition humaine (Brugère, 2009). Philosophe et professeur de sciences politiques, Joan Tronto (2009) propose une définition du prendre soin dans sa globalité : Activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, en sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible.
Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie (p. 143). Le prendre soin mobilise alors une multitude de ressources provenant d’horizons très divers : « certaines sont théoriques, d’autres philosophiques, d’autres scientifiques, d’autres encore techniques et d’autres, enfin, issues de l’intuition… » (Hesbeen, 1999, p. 14). La délimitation du prendre soin semble alors infinie puisqu’il s’agit avant tout d’un état d’esprit que chacun modèle à sa manière en utilisant son propre vécu et ses propres ressources. Pourtant, malgré l’immensité des manières possibles pour y parvenir, le prendre soin a toujours le même but, celui de venir en aide à quelqu’un. Cette finalité peut, quant à elle, être délimitée par des unités que certains auteurs ont tenté de nommer et d’expliquer. Walter Hesbeen (1999) en propose trois : la perspective soignante, la démarche soignante et la capacité d’inférence. Tout d’abord, le prendre soin demande une perspective soignante, c’est-à-dire une volonté propre et “l’intention de prendre soin des personnes et pas seulement de leur faire des soins” (Hesbeen, 1999, p. 8). Il suppose également une démarche soignante qui désigne “la capacité de se mouvoir, de se porter vers autrui en vue de marcher avec lui” (Hesbeen, 1999, p. 9). Cela demande de s’intéresser à la personne soignée ainsi qu’à ce qu’elle considère comme important pour son bien-être et d’avancer conjointement vers cet horizon (Hesbeen, 1999). Pour finir, la capacité d’inférence qui demande de puiser dans ses nombreuses ressources, quelle que soit leurs origines, et de les combiner afin de mettre en place des actes subtils et pensés pour la personne soignée (Hesbeen, 1999).
1 Introduction |