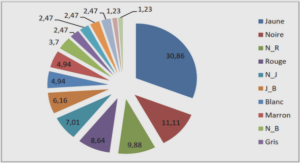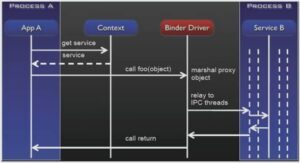La fabrique médiatique de l’événement au XIXe siècle
Démystifications langagières Araser le « haut fait »
À défaut d’élaborer des définitions sophistiquées – Vallès n’est pas un théoricien et ne veut pas en être un –, l’actualisme se construit sur une série de rejets qui a valeur de manifeste. C’est un programme ambitieux qui semble difficile à réaliser intégralement, en particulier quand il s’agit d’écrire l’événement. La production vallésienne est très ambivalente en la matière. Il lui est d’abord impossible de bannir les événements passés, publics et politiques, d’autant qu’elle est sous-tendue par une réelle conscience politico-historique : Vallès aurait pu écrire ce que Vaclav Havel écrit en préface du roman de Dominik Tatarka, Le Démon du consentement, à savoir que l’écrivain peut écrire sur l’amour, la jalousie, la nature, créer des allégories ou s’en tenir aux faits, etc., mais « il y a une chose qu’un véritable écrivain ne peut jamais éviter : c’est l’Histoire1 ». De surcroît, la forme et les figures que Vallès rejette avec virulence, comme pour mieux exorciser ses propres démons, imprègnent irréductiblement son écriture. Cette dernière est « éclaboussée de latin2 », « habitée3 » par l’Antiquité gréco-latine. Ses phrases se calquent souvent sur la rhétorique ancienne et respectent régulièrement une cadence oratoire, qui permet une « structuration émotionnelle du discours », en accentuant le commencement et la fin des séquences. L’écrivain-journaliste soigne tout particulièrement ses clausules, qui peuvent alors servir à amplifier les événements évoqués. À titre d’exemple, dans une « Chronique » du 15 novembre 1857, il précise que « pas un n’est mort au milieu du combat, sur l’échafaud ou bien devant une barricade5 » parmi Jean Cavaignac, Godefroy et Eugène. Mais la fin de la phrase suivante associe paradoxalement la mort de ces trois hommes à une action courageuse : « l’homme s’affaisse, le glaive tombe, et le héros s’évanouit6… » Elle utilise un vocabulaire militaire, emprunté à l’Antiquité romaine, ainsi qu’un rythme ternaire, qui culmine sur la mort d’un homme érigé en héros. En l’occurrence, le mot « glaive » n’est pas seulement une forme d’anachronisme lexical, il désigne aussi un objet-symbole, qui sert l’évocation allégorique d’une attitude combative. Il convient en effet de reconnaître que Vallès, « grand contempteur de l’allégorie», a « plusd’une fois mené sa lutte à coups d’allégories8 ». Enfin, à ces reprises inévitables et même fréquentes des formes et des figures anciennes, pourtant détestées, s’ajoute « une singulière fascination pour l’impact émotionnel de certains mythes9 », bien avant la Commune. En pratique, l’actualisme vallésien d’avant 1871 consiste donc aussi à réactualiser péjorativement un certain nombre de supposés « grands événements ». Il n’évacue pas tout à fait les événements historiques, mais il les déplace et les rabaisse en les transposant dans la sphère privée d’existences ordinaires ou médiocres, puisées dans la réalité contemporaine. En témoigne exemplairement l’histoire de « M. Chaque. Orientaliste, ancien Pallicare ». Le récit s’inspire d’un témoignage véridique sur le plan factuel, mais il ménage des effets imbriqués de distanciation ironique, entre le protagoniste et les événements historiques, d’une part, entre l’auteur et son personnage, d’autre part. Il relate une trajectoire individuelle d’où les « grands événements » sont ostensiblement tenus à distance. Ces derniers sont des abstractions lointaines qui ne parviennent pas à prendre corps dans la réalité concrète. La présentation initiale de M. Chaque est à cet égard éloquente : « Il a payé sa première inscription de droit en 1831, une autre en 1848 ; il en prend une le lendemain de tous les grands événements. Il a professé en France et à l’étranger . » D’emblée, elle insiste en filigrane sur l’ambivalence des liens qui unissent les deux révolutions du siècle – 1830 et 1848 – à la trajectoire personnelle de M. Chaque. Les deux inscriptions en droit semblent être les conséquences immédiates de ces deux événements historiques. Mais ce constat signale au fond un rapport d’extériorité entre le jeune homme et les « grands événements », dont l’importance se trouve alors relativisée. Les deux révolutions sont envisagées non pas dans leur retentissement sur la société entière mais simplement en tant qu’elles ont influencé le parcours universitaire d’un individu. En outre, le lecteur ne sait pas si M. Chaque a participé ou non à ces événements13. Il semble qu’il ait (ré)agi « le lendemain » et non pas au moment même de ces rendez-vous avec l’histoire : de manière symptomatique, il « a su organiser la résistance » mais seulement « contre la vie15 ». Quant à l’inscription, elle est un engagement écrit, non une activité concrète. Il y a donc loin du « grand événement » historique, action supposée collective et effective, aux petites décisions individuelles. Dans ce contexte, la démarche professionnelle de l’« Orientaliste, ancien Pallicare16 » peut même apparaître comme une version lointaine et dégradée de l’engagement républicain et patriote des volontaires de 1792. Vallès n’explicite pas ce rapprochement ; cela dit, ses mots parlent pour lui : M. Chaque a non pas combattu mais seulement « professé en France et à l’étranger17 ». 1831 et 1848 semblent donc moins des événements-clefs que des dates-jalons, tout comme « 184518 » et « 185219 » sont d’abord les bornes temporelles du travail alimentaire de M. Chaque dans les lycées. Un court passage au discours direct radicalise cette disjonction entre le jeune homme et l’événement révolutionnaire : « Je revins au bruit d’une révolution passant les mers . » L’explication de son retour en France, après un séjour en Asie, est en effet aussitôt annulée au discours indirect : « Et, en même temps, il se reproche ce retour si précipité21. » Dans ce cas, le revirement langagier révèle une attitude ambivalente, voire contradictoire, vis-à-vis des « grands événements », qui s’avèrent par là encore plus ambigus et insaisissables.
Waterloo évincé ?
Le 18 juin 1815, Napoléon Ier et ses hommes sont passés, voire ont trépassé74, à Waterloo, mais un événement majeur est né, et il est demeuré depuis comme « une date qui, selon l’expression consacrée, allait faire époque et tracer une ligne de partage entre un avant et un après75 ». Commencement76 ou fin77, il est communément considéré comme une rupture de premier ordre, dans l’épopée napoléonienne et, plus largement, pour l’histoire européenne. Il est l’événement par excellence : « Ce jour-là, la perspective du genre humain a changé. Waterloo, c’est le gond du XIXe siècle78 », affirme l’auteur des Misérables. Le titre du chapitre où s’insère cette déclaration hugolienne – « La catastrophe » – souligne par ailleurs que l’événement est une défaite cuisante pour la France. Revers inéluctable dû à une situation « impossible79 » ou « évitable défaite80 », c’est incontestablement une bataille « perdue81 ». Toutefois, paradoxalement, ne s’agit-il pas d’une « défaite glorieuse82 », pour reprendre la formule oxymorique d’une récente mise en perspective des différents discours83 qui ont constitué Waterloo en événement « de 1815 à nos jours84 » ? Certes, la date marque l’effondrement de l’ère impériale, du point de vue de la réalité historique, mais elle symbolise en même temps la naissance de l’épopée napoléonienne dans les imaginaires : C’est […] à ce moment que Napoléon, déchu, captif, bientôt mort, dépossédé de l’imperium qu’il avait exercé, commença un second règne – posthume – qui devait durer beaucoup plus longtemps que le premier et étendre sa domination bien au-delà des frontières qui avaient été celles de l’Empire : son règne sur les imaginations85 . Même dans la débâcle, l’événement s’est teinté d’une dimension grandiose. L’épopée hugolienne contribue largement à la légende napoléonienne lorsqu’elle souligne que le « génie86 » militaire de l’empereur fut pour une fois vaincu par le « calcul87 » à cause d’une fatalité divine, et qu’elle insiste sur l’ardeur héroïque et la violence tragique des combats. En outre, sa vision de la déroute française comme une « victoire contre-révolutionnaire88 » ennoblit a contrario les motifs de l’initiative napoléonienne, située dans un processus d’émancipation89 . Abondamment nourrie par la littérature, cette vision épique et romantique de l’événement a persisté au siècle suivant, y compris dans des approches politiques et historiques beaucoup moins favorables à Napoléon. « Sa chute fut gigantesque, en proportion de sa gloire90 », déclare par exemple le général De Gaulle dans son essai La France et son armée. Il n’est donc pas nécessaire d’admirer ou d’approuver le « Vol de l’Aigle91 », ni l’offensive impériale de l’époque, pour participer à l’édification d’un tel monument historique. À des degrés divers, plusieurs penseurs du XIXe siècle tels Thiers, Charras ou encore Quinet ont imputé l’issue tragique de cette « bataille décisive » à la responsabilité fautive de Napoléon, sans pour autant diminuer l’importance de l’événement. Dans son Histoire de l’Empire, faisant suite à l’Histoire du Consulat, Thiers fait le procès de Ney et de Grouchy après celui de Napoléon, et il invoque les causes morales de la défaite : « À cette hauteur, Napoléon reparaît comme le vrai coupable […] le génie le plus puissant devait échouer devant des impossibilités morales insurmontables93 . » Comme l’a souligné Karl Marx94 , l’Histoire de la Campagne de 1815 – Waterloo du colonel Charras porte, en 1857, un coup autrement plus dommageable au culte de Napoléon. Toutefois, l’ouvrage rabaisse l’action d’un seul homme et non pas l’événement tout entier, qui se trouve même rehaussé dans sa grandeur historique : Après la lecture de ce livre, un homme paraîtra peut-être bien diminué ; mais, en revanche, l’armée française paraîtra plus grande, la France moins abaissée. Ce résultat va mieux à ma raison, à mon cœur, à mon patriotisme que les fictions adoptées depuis si longtemps95 . À l’instar de Charras, et au grand dam de Pontécoulant, Quinet prend à tâche de « rabaisser la gloire de Napoléon96 ». Mais, comme Hugo, il insiste considérablement sur l’horreur et les séquelles des combats97. Il s’étonne entre autres que les circonstances climatiques du 18 juin 1815 aient pu déterminer « l’empire du monde98 ». En raison et au-delà de cette diversité d’approches, peu de batailles ont donc retenu à ce point l’attention des historiens et inspiré les écrivains. Plus qu’une énigme99, ce que Victor Hugo appelait « la chose de Waterloo100 » est devenu une source incessante d’intérêt et d’interrogation au fil du temps, un événement aussi bien historique que littéraire, un mythe en somme101 . L’événement n’a pas attendu ses grands anniversaires, tel le bicentenaire, ni ses occasions de commémoration102, pour révéler son immense fortune, à la fois historique et artistique. Ce fut le cas dès le début et tout au long du XIXe siècle. En témoigne parfaitement Vallès lorsqu’il explique, en 1869, que « l’histoire […] a donné l’immortalité103 » au village de Waterloo : l’événement est déjà envisagé comme un mythe transhistorique. Mais, loin de contribuer lui aussi à la pérennité d’une mythologie constituée, le texte vallésien fait d’emblée disparaître, à la source même de ses représentations, les traces tangibles de l’événement historique : C’est à Waterloo que Wellington rentra le soir et écrivit sur un bout de table deux lignes pour annoncer à Londres et faire savoir au monde qu’il venait de battre Napoléon. Mais il ne fut pas brûlé une cartouche, de ce côté-là, dans la journée du 18 juin 1815. Il n’y eut de saignée à Waterloo qu’une volaille grasse pour le souper. L’aigle reçut sa blessure et eut les serres cassées au-dessus du plateau de Mont-Saint-Jean104 . Ces quelques lignes ouvrent un article consacré au « champ de bataille de Waterloo » et consistent donc en une déclaration de guerre liminaire contre la légende de l’événement105. La célèbre bataille n’a pas eu lieu à Waterloo, elle a seulement été entérinée en tant que victoire des Coalisés dans ce village : Vallès fait allusion à la fameuse dépêche de Wellington du 18 juin 1815. Le grand événement fait en l’occurrence l’objet d’un rabaissement burlesque puisque l’annonce solennelle est associée à la plumaison d’une volaille. Le titre de l’article – « Le champ de bataille de Waterloo » – s’avère être un mirage. Ce motif ne suffit pas à expliquer le refus que Vallès essuya auprès du Grand Dictionnaire universel du XIX siècle, auquel son texte était pourtant destiné106. Un tel déplacement géographique de l’événement historique n’est pas inédit et n’a rien de proprement scandaleux à l’époque. Bien des Français avaient immédiatement évoqué non pas la « Bataille de Waterloo » mais la « Bataille de Mont-Saint-Jean ». C’est ce que confirme le rapport officiel des combats du 21 juin 1815107, à Paris, et ce que soulignent par exemple nombre d’écrivains romantiques, à commencer par Hugo : Waterloo n’a rien fait, et est resté à une demi-lieue de l’action. Mont-Saint-Jean a été canonné, Hougoumont a été brûlé, Plancenoit a été brûlé, la Haie-Sainte a été prise d’assaut, la Belle-Alliance a vu l’embrasement des deux vainqueurs ; on sait à peine ces noms, et Waterloo qui n’a point travaillé dans la bataille en a tout l’honneur108 . Le reste de l’article ne se contente pas de déplacer l’événement ; il travaille à l’effacer littéralement. Comme le précise le deuxième supplément du Dictionnaire Larousse, peu après la mort de Vallès, ce dernier « voulait écrire une page qui effacerait Thiers, Charras, Quinet, et après laquelle on ne parlerait même plus du fameux chapitre des Misérables109 ». Dans son texte, il s’amuse en effet à citer pêlemêle la plupart de ces hommes qui se signalent moins par la pertinence de leur œuvre que par la célébrité de leurs noms110. Déjà, en son temps, l’écrivainjournaliste est conscient du fait que « Waterloo est une date […] plus importante par les symboles et les idées qu’elle évoque que par ses conséquences historiques », qu’elle est d’abord une construction discursive. Pour effacer cet événement encombrant, il faut donc gommer ses représentations dominantes. Plus encore, les innombrables discours sur Waterloo, en dépit même de leur hostilité à l’épopée impériale, n’ont fait qu’amplifier chaque fois l’importance de l’événement. Craignant d’ajouter malgré lui sa pièce à l’édifice historique, Vallès adopte une démarche radicale, qui consiste à éluder le sujet annoncé dans le titre. Il ne se contente pas de s’opposer à une vision épique de l’événement112 ni d’éreinter la légende napoléonienne113 ; il esquive l’événement lui-même et s’amuse à renouveler explicitement cette dérobade historique. L’attendu du pèlerinage romantique et solitaire sur les lieux de mémoire1 laisse place à un voyage collectif115 , trivialement touristique, auprès d’un père Joseph très « rigolo116 ». Ce dernier constate amèrement que les voyageurs se font de plus en plus rares ; Vallès ricane discrètement, lui qui avoue un peu plus loin n’avoir « jamais tant ri qu’à MontSaint-Jean117 ». S’il évoque ensuite les « terribles combats118 » passés – il ne s’agit pas non plus de cautionner la guerre par le silence – il préfère néanmoins décrire les habitants du lieu présent, occasion de mépriser les « [h]istoriens et les flâneurs119 », autrement dit de rejeter l’événement en tant que catégorie historique et romantique. Puis, là où Hugo et Quinet conduisent une exploration géographique des lieux, le narrateur et ses compagnons rejoignent directement – « au bout du village120 » – l’hôtel des Colonnes, où ils préfèrent souper qu’entendre le récit de la bataille, et ils s’intéressent plutôt aux misères de leur époque qu’aux souffrances des guerres passées.
Poupelin, ou l’envers de la grande Histoire
Trente ans avant Vallès, au début de son roman La Chartreuse de Parme, Stendhal démythifie déjà l’épisode de Waterloo. Pour décrire la bataille, subsistent bien des notations concrètes, mais elles se trouvent déréalisées par les choix de construction narrative. L’événement est saisi à travers le point de vue de Fabrice del Dongo si bien qu’il consiste surtout en une superposition désordonnée de perceptions confuses. Loin du modèle traditionnel de l’affrontement homérique et, plus largement, du modèle épique, il s’évapore et donne à voir ce qu’un soldat « peut voir d’une bataille, c’est-à-dire rien1 », comme l’a constaté Stendhal luimême à Bautzen. Une dizaine d’années plus tard, le narrateur des Mémoires d’outretombe raconte qu’il a seulement entendu la bataille. Mais son émotion n’en est que plus vive, et sa puissance imaginative rehausse précisément le symbolisme épique de l’événement historique : Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j’aurais été moins ému si je m’étais trouvé dans la mêlée […]. Napoléon était-il là en personne ? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort ? Succès ou revers de l’une ou l’autre armée, quelle serait la conséquence de l’événement pour les peuples, liberté ou esclavage? En 1869, Vallès dissout le « haut fait » épique d’une manière autrement plus radicale dans la mesure où le guide Martin Pirson est encore moins héroïque que le soldat Fabrice del Dongo, pourtant déjà « fort peu héros4 ». D’abord, du roman à l’article encyclopédique, du personnage fictif – indissociable de la période narrée – à la personne réelle et contemporaine de l’auteur, l’horizon d’attente diffère sensiblement. Surtout, l’événement vallésien est une abstraction plus flagrante que l’événement stendhalien. Alors que l’honneur de Fabrice lui avait au moins valu d’être blessé au combat, Vallès précise d’emblée qu’« il n’y eut personne d’atteint par un boulet égaré ou une balle morte5 » dans le village de Martin Pirson. En outre, si la bataille est saisie par le point de vue du guide, ce n’est pas « de l’intérieur », mais longtemps après, dans la mesure où son témoignage est un commerce lucratif dont il a fait son métier : [Il] sait maintenant son champ de bataille sur le bout du doigt et, depuis quarante-quatre-ans, il attend les touristes et les historiens à l’entrée du village pour les guider à travers la plaine […]. Les paysans l’envient, quelques-uns le méprisent : ils ne trouvent pas honnête cet homme qui n’emploie pas ses bras et gagne sa vie sans faire pousser ni blé ni herbe, ils le regardent comme un parasite et un fainéant6 . Cela dit, l’avatar vallésien de Fabrice del Dongo n’est-il pas Poupelin, plus encore que Pirson ? Ce dernier est l’un des « Irréguliers de Paris », ces personnages réels que Vallès considère significativement comme des « romans vivants7 » et dont il retrace les « aventures8 » dans Le Figaro du 13 avril 1865, repris dans Les Réfractaires. Premier déplacement, qui vaut dégradation : l’histoire de Poupelin n’est pas liée à l’oncle, Napoléon Ier, mais au neveu, Napoléon III. De surcroît, la démythification stendhalienne de Waterloo provenait surtout d’un renouveau imbriqué à la forme romanesque, délaissant pour ainsi dire l’action extérieure au profit de l’exploration intérieure du personnage, comme l’a souligné Lukács : Pour le roman du XIXe siècle, un type de relation nécessairement inadéquate entre l’âme du héros et la réalité a pris le plus d’importance, inadaptation qui tient à ce que l’âme est plus large et plus vaste que tous les destins que la vie peut lui offrir […]. Assurément, c’est ici que réside la problématique qui caractérise le roman : la perte de toute symbolisation épique, la dissolution de la forme en une succession nébuleuse d’états d’âme, le remplacement de l’affabulation concrète par l’analyse psychologique9 . Vallès, pour sa part, ne s’intéresse presque pas à la psychologie. Le rabaissement des « hauts faits » impériaux – non plus Waterloo mais l’action gouvernementale du Second Empire – réside précisément dans l’enchaînement des (non-)événements qui façonnent l’existence concrète de Poupelin. C’est donc l’épopée ridicule – ou les « restes d’épopée» – d’un « petit homme » qui démystifie en retour les « grands événements » associés au « grand homme ».
Introduction |