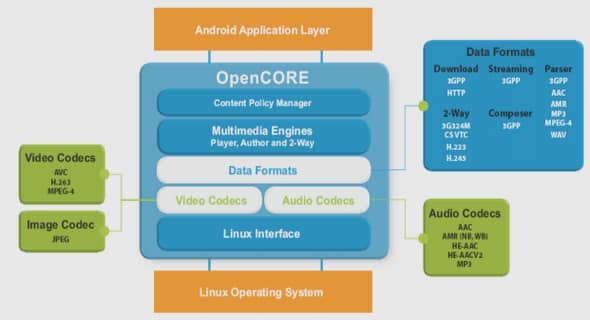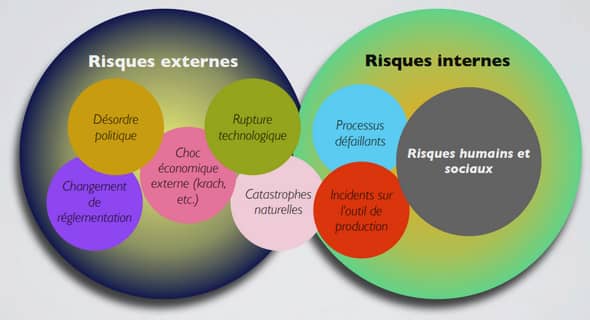La double série de la métaphore et ses unités
L’un des traits principaux de la métaphore est donc cette double série d’éléments rapprochés, cette double chaîne que nous avons observée à maintes reprises, impliquée dans la figure. Mais quels sont ces éléments rapprochés ? Pourquoi les appeler « objets de pensée » ? La tradition poétique et rhétorique considère que la métaphore et la comparaison associent des mots même si, dans le premier cas, l’un d’eux est pensé comme absent. De ce point de vue, George Lakoff et Mark Johnson ne s’inscrivent pas vraiment en rupture quand ils dédoublent le réseau conceptuel et le système des différentes métaphores qui l’atteste : ils sont tentés de remplacer la définition « un mot pour un autre » par « un concept pour un autre ».218 Or, ce qu’ils appellent concept ressemble beaucoup au lexème, comme les exemples choisis le montrent la plupart du temps – même si l’analyse du concept de causalité fait plutôt exception, ainsi que le concept de discussion qu’ils proposent, par exemple – ou comme l’indique leur réflexion sur les définitions du dictionnaire (chapitre 19). Le premier apport de leur démarche est surtout de souligner l’omniprésence et la systématicité des métaphores. Quand ils se penchent sur les « métaphores d’orientation », c’est par les seuls mots « haut » et « bas » qu’ils appréhendent la verticalité symbolique qui structure notre imaginaire et notre pensée (chapitres 4 et 12). De même, lorsqu’ils se penchent sur les « gestalts expérientielles » qui forment les concepts, notamment sur le « prototype de la manipulation directe » qui permet à la notion de causalité d’émerger (chapitre 14), ils n’en tirent pas matière à nuancer durablement leur compréhension « conceptuelle » de la métaphore : même s’ils prennent soin de souligner régulièrement le lien entre les concepts et l’expérience, c’est souvent au niveau des premiers que la métaphore semble travailler dans leur ouvrage ; ce sont eux que la figure d’analogie rapproche. Pour autant, l’ouvrage n’en reste évidemment pas là : son grand mérite est aussi de percevoir la métaphore en termes d’expériences, en quelque sorte médiatisées par des concepts, à la façon de la discussion quand « les dimensions de notre expérience sont conformes » à la fois à « la gestalt Conversation » et à « la gestalt Guerre ».219 Mais cette difficulté à cerner le niveau auquel intervient l’expérience n’en est pas moins sensible, surtout au début de l’ouvrage, où le « fondement expérientiel » apparaît en position de médiateur entre les concepts comparés et comparants (fin du chapitre 4). Il est donc entendu que la figure d’analogie opère à un niveau plus « profond » que celui des mots – dont, à mon sens, il est difficile de séparer le destin des concepts. Ne serait-ce que le cas de la catachrèse, quand elle est perçue comme métaphorique, témoigne du fait que l’on peut comparer des choses pour lesquelles il existe des mots à d’autres pour lesquelles il n’en existe pas. La définition de la métaphore par Aristote le souligne bien qui évoque « le transport à une chose d’un nom qui en désigne une autre ».220 Est-ce à dire que la métaphore travaille directement au niveau des référents ? L’erreur serait plus cruelle encore, du moins si l’on considérait ces référents comme les choses mêmes, les objets du monde réel auxquels les mots prétendent renvoyer. La métaphore travaille sur des représentations : si elle repose sur des expériences, celles-ci n’ont jamais rien d’immédiat ; elles « reposent » elles-mêmes sur des représentations ou, pour être plus exact, elles en sont inséparables. D’ailleurs, si nous avons besoin de la métaphore, dans un grand nombre de cas, c’est précisément parce que nos représentations usuelles sont perçues comme insuffisantes pour « atteindre » le réel, pour « traduire » notre pensée, que les mots dont nous disposons ne désignent pas d’une façon satisfaisante l’objet que nous avons en vue, qu’un détour semble donc profitable pour mieux désigner. Paul Ricœur développe cela parfaitement dans La Métaphore vive, notamment dans ses troisième et septième études, à cette exception, à cette nuance près qu’il reprend parfois l’expression de « référence ruinée » pour caractériser le destin de la référence première, comme si elle disparaissait ou comme si elle était vraiment « suspendue », là où elle est plutôt « relevée », « dépassée », supprimée si l’on veut mais aussi conservée, du moins dans la métaphore vive où la tension entre les deux séries ne disparaît jamais. Aussi pouvons-nous préférer l’expression de Claude-Louis Estève lorsqu’il évoque les « deux concepts-objets » que la métaphore « raccorde ».221 La figure d’analogie travaille en effet sur des objets de pensée dont la présence est plus ou moins affirmée selon les cas, pouvant aller de l’abstraction (bien sensible déjà dans « la discussion, c’est la guerre ») à la réalité sensible saisie à travers un plan de cinéma, un photogramme (une écrémeuse, une femme qui glane, une araignée ou un homme qui se maquille). Dans une autre perspective, plus récente mais inspirée par Bakhtine, celle de la praxématique, Catherine Détrie nous invite à abandonner l’unité du lexème au profit du praxème : il s’agit d’éviter le divorce entre « l’analyse du réel objectif » et l’« impression culturelle » des diverses « praxis humaines », de « réintégrer le monde extralinguistique et le sujet qui avaient été exclus de la linguistique de la langue telle que Saussure avait pu la problématiser ».222 Voilà qui souligne bien le problème du vocabulaire traditionnel de la linguistique : ce n’est pas seulement les mots et les choses qu’il s’agit de réconcilier en prenant en compte l’intentionnalité du sujet parlant. La métaphore repose sur une double expérience, exprimée en l’occurrence à travers la série comparante et la série comparée, et chacune de ces expériences implique une visée particulière, c’est-à-dire un sujet et une intention. On pourrait dire aussi que la figure d’analogie associe deux « états de choses », pour reprendre une expression de Wittgenstein rapprochée par Ricœur du travail de Benveniste et de Husserl pour désigner les « référents de phrase » 223, et qui évoque des situations concrètes, des sortes de situations de discours ou de fait : chacune des deux séries rapprochées par la métaphore possède bien une référence comparable à celle d’une phrase. Mais ces expressions n’ont pas été reprises pour autant dans la définition, pour ne pas l’alourdir par une intertextualité peut-être inutile, mais aussi pour éviter le malentendu qui touchait déjà à la notion de référent : « état de chose » suggère encore un référent de phrase réellement existant, renvoie davantage à une « situation de fait » qu’à une « situation de discours », alors que l’expression « objets de pensée » ne semble pas présenter ce défaut. Il est vrai qu’elle en présente un autre, celui d’imposer un dédoublement malheureux de l’expression, avec « objets de pensée ou séries d’objets de pensée » : il ne faut évidemment pas comprendre qu’il y aurait rapprochement véritable tantôt de deux « référents de phrase » tantôt de deux « référents de mots », mais que les « objets de pensée » n’apparaissent pas toujours immédiatement comme complexes, comme situations aux multiples composants. En revanche, en soulignant la nature subjective des deux « ensembles de réalités » rapprochés, l’expression « objets de pensée » indique bien la dimension « praxématique » des composants de la métaphore, le fait que les deux séries renvoient avant tout à des expériences. De ce point de vue, on aurait pu adopter aussi « mondes de discours », employée par exemple par Sylvianne Rémi-Giraud, qui souligne bien quchaque mot composant une métaphore est susceptible de déployer tout un monde qui n’est pas pour autant le réel objectif. Son article offre d’ailleurs une analyse très éclairante pour préciser le problème de la référence. Il a beau partir de la métaphore lexicalisée et conclure à une relative unité de tous les phénomènes métaphoriques, il n’en intègre pas moins la problématique de la métaphore vive dès le début. Aussi permet-il de souligner ce que je relevais tout à l’heure : la référence n’est jamais « suspendue » dans la métaphore vive (ou la « métaphore lexicalisée », quand elle n’est pas perçue comme morte). Le monde de discours convoqué a beau être virtuel, il repose sur la perpétuelle tentative d’actualisation du comparant : c’est ce qui rapproche « Robert est un bulldozer » de « Basile est un teckel » et le distingue de « Robert est une brute », pour reprendre les exemples de l’article.224 L’idée de suspension est donc dangereuse si elle est comprise comme « ruine » de la référence : s’il n’y a pas « existence effective » du référent, à la différence du « monde “réel” » du comparé, il n’en appartient pas moins « à un monde virtuel, déréalisé », certes « “déconnecté” en quelque sorte de celui où se trouve le référent du sujet », mais qui possède une existence dans le discours. Nous ne sommes pas loin, en fait, de l’idée de Ricœur selon laquelle la métaphore est une fiction – et donc, dans les œuvres de fiction, une fiction au second degré. C’est ainsi, en prenant en compte « l’hypothèse des deux mondes », que l’énoncé métaphorique conserve « sa signification littérale »
Le rapport entre les deux séries
Avec cette question de la subordination ou non d’une chaîne à l’autre, c’est celle du rapport entre les deux séries d’objets de pensée qui se pose. Je ne reviens pas sur ce problème des notions de comparant et de comparé, sinon pour rappeler que François Rastier fait un choix similaire en refusant de cerner dans une métaphore, dans une « poly-isotopie », une « isotopie dominante », prééminente.227 Mais, plus largement, si je préfère parler simplement d’un « rapprochement » entre les deux séries, c’est qu’il me semble essentiel de refuser une approche substitutive : la métaphore n’est pas un mot « à la place » d’un autre. Ce n’est pas non plus le fait de « comprendre quelque chose […] en termes de quelque chose d’autre ».228 Cette dernière expression, qui sous-tend beaucoup d’analyses de ces dernières décennies, présente le défaut de concevoir la métaphore comme un simple mécanisme de projection, où le sens circulerait en quelque sorte à sens unique négligeant une bonne part de la dialectique qui s’instaure entre les deux séries. C’était déjà le travers des théories, pourtant stimulantes à certains égards, du « filtre », de l’« écran », développées notamment aux États-Unis. Or la métaphore noue des liens réciproques entre les deux séries, comme Aristote le montre bien avec ses métaphores proportionnelles, y compris en précisant que l’on peut dire « le soir de la vie » comme « la vieillesse du jour ». Mais, si l’on peut objecter qu’il y a là deux métaphores différentes, il s’agit surtout de percevoir que, dans une même métaphore, « le soir de la vie », ou « la coupe d’Arès » par exemple, la signification circule dans les deux sens, que l’idée de coupe apporte quelque chose à celle de bouclier et vice-versa. C’est d’ailleurs ce qui rend la métaphore absurde aux yeux de Umberto Eco : on y voit mal la logique qui unit les deux termes, et plus largement les quatre termes, à la différence du « soir de la vie ».229 Car telle est bien l’idée contenue dans la proportionnalité : il s’agit d’un rapport, établi en l’occurrence entre deux autres rapports – et ce rapport n’est autre que celui du raisonnement analogique, où il s’agit de s’assurer que les deux chaînes s’ajustent bien l’une à l’autre. Pour l’auteur de Sémiotique et philosophie du langage, « la coupe d’Arès » semble justement constituer une mauvaise métaphore pour cette raison : l’analogie n’y est pas bonne. Pour lui, ce qui unit les deux séries, et notamment Dionysos à Arès, c’est presque uniquement « leur diversité », le fait qu’« au panthéon des dieux païens » ils s’opposent. La dissemblance serait trop grande. Quoi qu’il en soit de cet exemple, ce n’est pas seulement pour Aristote que l’image est bonne lorsqu’elle implique cette proportion, cette convenance dans les deux sens. Quintilien vante les « représentations réciproques », ces présentations de la « similitude » (c’est-à-dire de la comparaison) sous forme de parallèle, où « la chose est valable dans les deux sens » : « la vraie représentation réciproque place, pour ainsi dire, les deux éléments de la comparaison devant nos yeux et les montre parallèlement. » 230 On retrouve ce caractère « bijectif » des belles images chez Cicéron, lorsqu’il relève « le mouvement alternatif » de la pensée qui passe « d’une notion à une autre » et ramène l’esprit « à la première », ce « va-et-vient rapide » de la métaphore qui fait son charme.231 Il ne faut donc pas négliger ce dialogue entre les deux séries, comme la théorie de la substitution y invite : il apparaît même comme le signe de la métaphore vive, comme ce qui la constitue. À mon sens, I. A. Richards ne parle pas d’autre chose lorsqu’il évoque cette « interaction » mal comprise par Max Black et, en conséquence, par Searle qui pourtant s’y montre lui aussi sensible