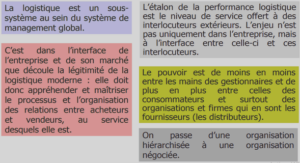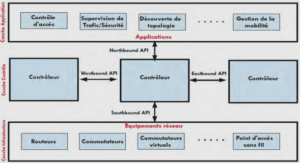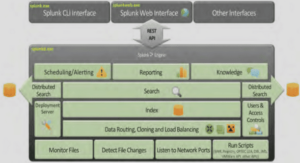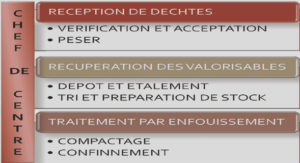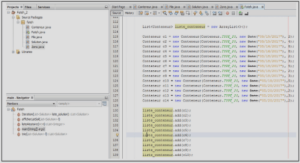Jouer de la frustration : le fossé sensoriel comme atout journalistique
Dans les chapitres précédents nous avons pu dénombrer différentes méthodes journalistiques visant à combler le fossé sensoriel entre la nourriture et sa représentation : style d’écriture, types de narration, techniques de montage, référence à la nature. Toutefois, on peut se demander si le fait d’insister sur ce fossé sensoriel, et de souligner l’incapacité du média à le combler, ne serait pas le meilleur moyen d’éveiller les sens des spectateurs. En effet, les journalistes culinaires usent de nombreuses stratégies pour créer des stimuli sensoriels et glissent ainsi d’une représentation des sens à une sur-représentation de ceux-ci grâce à des synesthésies : « les signes sensoriels, à caractère indiciel par rapport aux sensations gustatives : le plus souvent par synesthésie de formes, de couleurs, de proportions, et, selon les médias, de sons et de mouvements, nient la coupure sémiotique avec la sensation de base mais la sursignifient dans le même temps85 ». Dans cet extrait du dossier sur la médiatisation du culinaire, les auteurs constatent que les journalistes culinaires se retrouvent à « sursignifier » la sensation originelle pour tenter de la transmettre à l’écran. Cette sursignifaction des sensations est un aveu honnête d’impuissance de la part des journalistes face à « la coupure sémiotique86 » à laquelle ils sont confrontés. Cependant, on peut constater que cet aveu n’est pas tacite mais bien explicite dans nombre de productions journalistiques sur le culinaire. Ainsi, les journalistes soulèvent cette impossibilité de transmettre parfaitement le goût par l’écrit, le son ou l’image et se chargent de verbaliser le manque.
Si un vocabulaire gustatif et olfactif existe, il reste très restreint par rapport à la multitude de saveurs et d’odeurs que l’homme peut distinguer. Un parfumeur en fin de carrière peut reconnaître environ 3 500 essences87, il apparaît donc évident que le vocabulaire fait défaut face à une telle richesse sensorielle. Les expressions communes attachées à l’odorat ou au goût sont déjà des aveux d’impuissance linguistique. La parade stylistique est alors celle de la comparaison : « ça sent comme, ça a le goût de ». En évoquant ce qu’il goûte, l’homme souligne par là même son impuissance à le définir parfaitement dans son unicité en utilisant un comparatif. En mangeant une cuisse de grenouille, de nombreuses personnes affirment « ça a le goût de poulet », prenant ainsi immédiatement un référent plus connu. Dès lors, si qualifier la spécificité gustative d’un aliment est déjà une gageure au quotidien, ceci l’est encore davantage par le biais d’un média. Bien conscients de ce défi, les journalistes tâchent alors de verbaliser, de souligner, ce fossé sensoriel, cette « coupure sémiotique », ce manque et réussissent alors une pirouette remarquable. Ce qui est a priori un défaut, l’impossibilité de faire goûter au spectateur, s’avère être un atout : l’article ou le documentaire ne donne pas toutes le sensations au spectateur, il ne le nourrit pas mais lui fait ressentir un manque, une envie, un besoin. Le spectateur a faim, n’est pas rassasié par le documentaire. Cette frustration créée par les programmes culinaires peut ainsi jouer en leur faveur, l’envie de « consommer » l’article ou l’émission est d’autant plus forte que le spectateur ne peut goûter à ce qui lui est montré. C’est cette stratégie qu’analyse C. Brachet dans l’émission « C à vous » : « Dans cette émission, tout est pensé pour donner envie : envie de faire en transmettant un savoir-faire, envie de manger en évoquant des goûts et des odeurs et en sollicitant le téléspectateur visuellement, envie de regarder l’émission jusqu’au bout en proposant un dénouement à la narration88 ». Le manque fonctionne comme une composante essentielle des films : le suspense. Le suspense est une mise en intrigue qui encourage le spectateur à anticiper le développement d’une action incertaine. En comparaison, verbaliser le manque de goût revient à maintenir le spectateur en alerte et à l’inviter à s’imaginer les différentes saveurs. Rappeler et signifier le manque revient à provoquer le désir et constitue ainsi une stratégie efficace sur laquelle les programmes culinaires peuvent s’appuyer. Le documentaire « Chef’s Table », s’il fait le choix de centrer son propos sur le chef et son rapport à la nature, s’attache néanmoins à filmer les visages satisfaits des clients. Le moment de la dégustation, celui-même qui fait défaut au spectateur, est ainsi central dans les productions journalistiques. Si le spectateur ne peut goûter, il doit faire l’expérience de la dégustation des autres pour prendre activement conscience du fossé sensoriel où il se trouve. Les épisodes d’ « On va déguster » commencent ainsi par la dégustation d’une recette et la mise en son du goût : bruits de bouches, « mmmmmh », et premières impressions échappent ainsi aux chroniqueurs. Si ce procédé ne permet pas à l’auditeur de mieux goûter le plat, cette stratégie n’est pas gratuite. Tandis que les chroniqueurs se régalent, l’auditeur fait l’expérience du manque, et n’en est que davantage mis en appétit. La même stratégie est employée au format audiovisuel, lorsque les caméras se fixent sur les visages des convives, aucune saveur n’est donnée aux spectateurs, seulement celle du manque de saveur. La production « Top Chef » joue ainsi sur le suspense en étirant le temps de la dégustation du plat par les chefs étoilés. Tributaire des mots dans son approche du goût, le spectateur attend ainsi que les chefs verbalisent leur ressenti. Si « Chef’s Table » axe davantage son propos sur la vie des chefs et leur rapport à la nature, aucun épisode ne manque de filmer les clients et ainsi de montrer ce moment qui n’apporte aucune information au récit.
Seuls les visages de clients, à qui la production ne donne même pas la parole, défilent à l’écran. En filmant le moment de la dégustation, les productions journalistiques montrent aux spectateurs un moment qu’ils connaissent nécessairement (tout le monde mange) mais dont il ne font pas l’expérience à ce moment précis. Par ces plans de dégustation, les productions exploitent donc le manque sensoriel ressenti par le spectateur. Les chances de captiver l’attention du public par cette stratégie sont donc multipliées.
Par ailleurs, verbaliser ce fossé sensoriel peut avoir un second bénéfice sur le spectateur. Face à l’expérience du manque de goût, le spectateur est invité à combler ce manque par sa propre action. Il doit poursuivre chez lui la recette pour venir à bout de l’expérience. Ce qui commence dans le salon, devant la télé, se poursuit dans la cuisine. De ce fait, on peut voir dans le journalisme culinaire, un pouvoir performatif : le média commence quelque chose que le récepteur doit poursuivre. Le consommateur de l’article, du documentaire devient acteur en quittant son canapé pour enfiler son tablier. Ainsi, pour François-Régis Gaudry, « le but de l’émission est aussi de donner envie aux auditeurs de cuisiner à la maison89 ». L’heure de diffusion (11h) n’est pas un hasard, l’écoute des recettes peut ainsi coïncider avec l’heure de cuisiner pour les auditeurs. À sa façon, le magazine ELLE à table invite également ses lecteurs à participer à l’activité culinaire, notamment par le biais des fiches-recettes détachables en fin de magazine90. Cet élément pratique, a priori anodin, est devenu un incontournable du magazine, et témoigne de sa volonté de migrer du canapé à la cuisine par l’intermédiaire de ces cartes plastifiées. De plus, l’interaction entre public et média fonctionne dans les deux sens et le journalisme culinaire donne une grande place à la parole de ses lecteurs/auditeurs… Contrairement à d‘autres sujets journalistiques, à propos desquels le public attend plus passivement un transfert d’informations et où la totalité des données peut être transmise par le média, le sujet culinaire s’enrichit de la collaboration avec le public. Par divers moyens, le journalisme culinaire cherche par conséquent à être proche de son lectorat ou de ses spectateurs. Nous pouvons remarquer que cette particularité a pris une ampleur supplémentaire avec le début de la période du confinement causée par le covid-19 (16 mars 2020). De nombreux médias culinaires ont alors invité leur public à partager leurs propres recettes. C’est le cas d’ « On va déguster » dans l’épisode « Cuisiner quand on est confinés » qui est présentée sous ses termes : « Comment reprendre en main notre alimentation quand nous sommes confinés ? Des recettes, des solutions pour mieux cuisiner, pour limiter notre gaspillage et pour renouer avec notre équilibre alimentaire. Vous pouvez intervenir en direct à l’émission par le 01 45 24 70 00 91 ». Un auditeur a ainsi expliqué à l’antenne sa recette de pain d’épices qui a ensuite été publiée sur le site de l’émission. Par conséquent, dans la mesure où les goûts sont personnels, inviter les spectateurs à s’exprimer sur leurs recettes préférées est une stratégie récurrente des productions journalistiques culinaires. En plaçant le spectateur au centre de la production, le journalisme culinaire répond à la fois au caractère individuel des goûts et aux valeurs de partage et de convivialité inhérentes à la cuisine.
Ainsi, malgré leur incapacité à transmettre chimiquement les sensations gustatives, les médias parviennent à captiver un public nombreux notamment en l’invitant à combler par lui même le fossé sensoriel. Le consommateur est donc placé au centre des sujets culinaires comme acteur potentiel. La presse culinaire fait exister son lecteur en ne se contentant pas de lui servir des informations sur un plateau mais en l’invitant plutôt à cuisiner sa propre assiette.
Poursuivre le repas sur « Insta » : quand les médias culinaires s’emparent des réseaux
Face à un contenu aussi propice à faire du spectateur un acteur, les médias culinaires se sont dernièrement saisi de l’opportunité, offerte par les réseaux sociaux, d’être en lien direct avec leur public. Parmi ces réseaux, Instagram s’avère être particulièrement adapté au contenu culinaire. Créé en 2010, Instagram met en place un règne de l’image où les photographies de cuisine rencontrent un franc succès. Par conséquent, les médias « classiques » cherchent à s’emparer de ce nouveau support et permettent ainsi d’augmenter l’interaction avec leur public. Par cet outil, une marque comme ELLE à table parvient à toucher un nouveau public et à diversifier et prolonger l’expérience du public déjà conquis. En effet, le compte Instagram d’ELLE à table propose régulièrement des lives (vidéos diffusées en direct) où la rédactrice en chef Danièle Gerkens propose une recette. C’est dans ce format que l’interaction avec le public est la plus poussée puisque les spectateurs peuvent interagir avec Danièle Gerkens à l’aide des commentaires diffusés en direct. Le rapport média/ spectateur connaît alors un renversement puisque la rédactrice en chef reçoit des conseils de la part des spectateurs. Dans ce cadre, ce que l’on a nommé « pouvoir performatif » des médias culinaires atteint son paroxysme puisque le spectateur n’est plus acteur uniquement à son échelle (en cuisinant les recettes issues du magazine) mais aussi à l’échelle du magazine. Sur les captures d’écrans suivantes, les instagrameurs expliquent par exemple à Danièle Gerkens comment réussir son caramel. La rédactrice revendique à l’écran son manque d’expérience pratique en cuisine et n’hésite pas à demander aux instagrammeurs de l’aiguiller pour la préparation du caramel. Sur l’illustration 23, « julieduteuil » tout comme « moniquewillot » avertissent la rédactrice en chef que son caramel est prêt : « ça suffit », affirme par exemple cette dernière.
Sur l’illustration 22, « Snoopy.64 » met en garde Danièle Gerkens tandis que « niya.dyna » interroge D. Gerkens sur la marque de sa casserole. En l’espace de quelques secondes, un échange si réciproque s’opère qu’il devient difficile d’utiliser la classique dénomination « média/ spectateur ». Danièle Gerkens apprend autant des instagrammeurs que ces derniers apprennent d’elle. Si la technologie actuelle ne permet pas encore de transmettre les odeurs et saveurs, les réseaux sociaux permettent toutefois de partager conseils et encouragements, dans une dynamique tout aussi chère au monde culinaire.
La presse culinaire n’est pas le seul type de média à étendre son activité aux réseaux sociaux. François-Régis Gaudry est très actif sur son compte Instagram. Les dimanches, l’animateur partage le backstage de l’émission « On va déguster ». Ainsi, les auditeurs peuvent compléter leur écoute de l’émission par les photos de l’animateur. Ils découvrent alors le visuel des plats dégustés pendant l’émission, la mise en place des chroniqueurs, augmentant ainsi le sentiment d’être à la table d’ « On va déguster ». La mise en appétit et l’esprit de convivialité sont donc décuplés par l’intermédiaire d’Instagram.
Illustration 24 : capture d’écran du compte Instagram de Laura Zavan, invitée sur le plateau d’ « On va déguster » (28/04/19)
Illustration 25 : capture d’écran du compte Instagram d’Esterelle Payani, chroniqueuse chez « On va déguster » (15/02/20)
Dans la mesure où la cuisine appelle le partage, et où internet est également fondé sur cette fonction, les deux domaines se complètent et se recoupent. Dès lors, des médias dont la cuisine n’est pourtant pas le thème principal, exploitent cette ressource afin d’interagir avec le public. Si le goût ne peut être totalement transmis par les médias, l’esprit de partage intrinsèque à la cuisine peut l’être et l’émission d’actualité « C à vous » s’appuie sur cet atout. En direct de l’émission, les spectateurs sont invités à réagir sur le site internet pour commenter la recette confectionnée. Les spectateurs/internautes peuvent proposer des recettes pour les prochaines émissions. Ils peuvent même bénéficier d’un angle de vue spécifiquement culinaire depuis internet, puisqu’une caméra filme en intégralité la réalisation de la recette. L’écran d’ordinateur vient donc se substituer ou se superposer à celui de télévision pour permettre des échanges multiples. Camille Brachet analyse ainsi l’engouement que peut générer un tel dispositif : « Cette possibilité d’agir sur le contenu de l’émission confirme la convivialité annoncée : par l’impression de proximité instaurée avec la cuisinière, un lien est tissé et le téléspectateur est, en apparence, intégré au processus ; il participe au dîner entre amis. L’adhésion est plus forte quand on est un acteur potentiel du programme92 ».