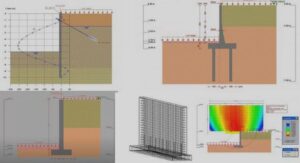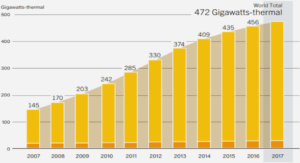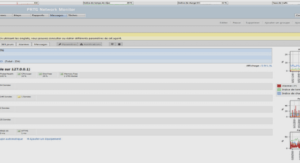LA CONSTRUCTION SOCIALE DES SEXES
ETRE UN HOMME, ETRE UNE FEMME A TONGA A
La division sexuelle du travail En ce qui concerne la répartition du travail selon chaque sexe, beaucoup de voyageurs ont noté que les travaux les plus durs étaient réservés aux hommes. De meme, le travail de la terre revenait aux hommes des statuts les plus bas, les tu’a. Anderson écrit ainsi: « the province alloted to the men is as might be expected far more laborious and extensive than that of the women : agriculture, architecture, boat building and fishing » ( Beaglehole, 1968, vol III : 933). Les femmes ne travaillaient jamais dans le domaine de l’agriculture, le travail le plus important qui leur était réservé consistait, comme dans beaucoup d’autres sociétés, à mettre les enfants au monde, les soigner et les élever. Mais les hommes aussi participaient à l’éducation des enfants. En général les taches étaient réparties de la manière suivante : les femmes fabriquaient des nattes, des tapas, de l’huile de coco, des paniers décorés. Elles pratiquaient aussi un peu de cueillette et de pêche dans les lagons, ramassant petits coquillages et crustacés. La fabrication du gnatu tenait la première place parmi les travaux des femmes (Martin, 1817, tome II : 337)1 . Les paniers décorés, les peignes, les parures des chefs étaient fabriqués par des femmes de haut rang et circulaient toujours dans la chefferie (F. Douaire-Marsaudon, 1998 : 124). Outre l’agriculture et la pêche en haute mer, les hommes fabriquaient de l’artisanat tels les casse-tête, les lances, les pirogues, les appui-tête en bois, les bols à kava. Selon les propos de F. Douaire-Marsaudon, l’artisanat des femmes c’est-à-dire la fabrication des nattes et tapa, « n’était pas considéré comme un métier mais plutôt comme une occupation » et ces productions féminines étaient « revêtues d’une grande valeur sociale et cérémonielle » (Ibidem, 1986 : 179). Les productions féminines avaient le statut particulier de koloa, « biens de valeur » ou « richesse » En revanche l’artisanat des hommes était considéré comme un travail, étant effectué par des artisans « professionnels » qui connaissaient les secrets de fabrication. Lorsque les enfants grandissaient, ils étaient encouragés à participer aux activités en rapport avec leur sexe et leur rang social. L’apprentissage se faisait généralement par l’imitation des adultes. Par exemple les filles étaient encouragées à s’exercer à la fabrication de l’artisanat féminin. Les enfants apprenaient aussi les attitudes attendues selon leur classe et le respect envers les supérieurs. Quand les enfants atteignaient l’âge de la puberté, les garçons partaient dormir dans une maison spéciale jusqu’à leur mariage.
Devenir homme, devenir femme
Pour les filles, la puberté était marquée par l’arrivée des premières règles et lorsqu’il s’agissait d’une fille de chef, celle-ci ne devait pas prendre de bain durant la première période en raison de la croyance selon laquelle le flot de sang pourrait s’arrêter. Par ailleurs, un grand festin était donné par son père, la mère distribuant des koloa (objets de valeur) et le tout était surveillé par la sœur du père, la mehekitanga. Les filles n’étaient pas mariées avant leurs premières menstrues. La perte de la virginité était aussi marquée par un autre acte: « une mèche de cheveux par-dessus une tempe, appelée fangafanga, était portée par les jeunes filles jusqu’à ce qu’elles perdent leur virginité. Par la suite la mèche était coupée du front jusqu’au cou » (Gifford, 1929 : 186). Chez les garçons une longue mèche de cheveux, tope, était aussi portée sur la tempe et coupée à la puberté. Selon un informateur de Gifford, un garçon ne rentrait dans la masculinité que quand sa voix changeait, que les poils se développaient sur le corps et le visage et que sa mèche de cheveux était coupée (Ibidem). Mais la puberté des garçons était marquée par le rite de la supercision, suivie d’un tatouage des hanches jusqu’aux cuisses. Il semblerait que W. Anderson fut le premier à décrire l’opération de la supercision à Tonga : « the men are all circumsi’d or rather supercis’d, as the operation consists in cutting off only a small piece of the foreskin at the upper part…it is practic’d merely from a notion of cleanliness » (Beaglehole, 1968, vol III : 930). Cette idée que la circoncision chez les peuples non européens était avant tout une question d’hygiène, eut court en Occident jusqu’au 19ème siècle. L’ethnologue Gifford quant 70 à lui, donne une autre interprétation de la circoncision, plus en rapport avec les représentations tongiennes « la supercision était vue comme un signe de masculinité » (Gifford, 1929 : 187). En effet selon lui, les jeunes qui ne voulaient pas subir cette opération n’avaient pas le droit de manger avec les autres membres de la maison, ne pouvaient toucher la nourriture des autres et étaient raillés par les filles (Ibidem). De plus, une personne non circoncise avait un nom particulier : kou ou taetefe (Ibidem). Le dictionnaire mariste tongien-français donne, à propos du premier de ces termes, les précisions suivantes : kou : incirconcis (Missions Maristes, 1890 : 262). Quant au mot taetefe il se décompose en taè, qui dans la composition de certains mots, équivaut à une négation, mais dont le sens premier est « excrément » (Ibidem : 242) ; et en tefe, qui signifie « circoncision » mais le dictionnaire mariste précise à son propos : « c’est un mauvais mot et le terme vulgaire pour la circoncision des naturels ; le terme honnête est kaukau » (Ibidem : 262). D’après ce vocabulaire, on peut donc facilement déduire que ces termes, employés pour désigner les non circoncis, étaient particulièrement injurieux et que le fait de ne pas être circoncis était considéré comme méprisable. Les jeunes non circoncis n’étaient pas considérés comme des hommes à part entière ou plus précisément comme des hommes « civilisés ». Par ailleurs, Gifford précise que la circoncision était accompagnée d’un repas cérémoniel où les garçons circoncis mangeaient avec les hommes de leur parenté, les femmes étant strictement exclues (Gifford, 1929 : 187-188). Les hommes tongiens se définissaient par l’habileté à la guerre ou aux jeux guerriers, une résistance lors des longs voyages en mer : la virilité était fondée pour une bonne part sur la force physique. Selon F. Douaire-Marsaudon, « à Tonga, la force physique et la virilité n’étaient pas supposées appartenir de manière générale à tous les individus relevant du sexe masculin ; la virilité était d’abord et avant tout l’apanage des chefs. L’identité sexuelle des hommes du commun était perçue comme moins nette, moins affirmée et moins accomplie que celle des chefs » (Douaire-Marsaudon, 2001 : 27). La force physique, base essentielle de la virilité, était censé provenir des ancêtres et plus le nombre d’ancêtres était important, plus l’individu était puissant et donc viril. Or à Tonga, les roturiers n’étaient pas censés avoir des ancêtres, ainsi seuls les chefs pouvaient bénéficier de la force physique. Françoise Douaire-Marsaudon pose l’hypothèse que le rituel du kava, pratiqué dans toute la Polynésie, était à Tonga « le lieu où les hommes en position de chef se transmettaient une forme idéalisée de virilité […] et se reproduisaient rituellement en tant que « vrais » hommes » (Ibidem. 2001: 7) .