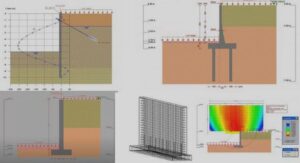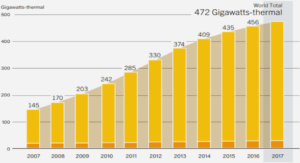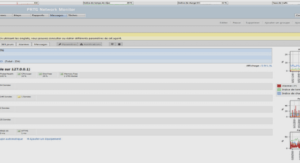La consécration d’un droit
Une procédure pénale qui affaiblit la présomption d’innocence
Dans cette recherche de la vérité judiciaire en matière pénale, le postulat repose sur le principe qu’il appartient au Ministère public, ou à la partie civile, quand cette dernière engage la procédure, de rapporter la preuve de la culpabilité, c’est-à-dire d’établir l’existence qu’une infraction a bien été commise, et que la personne poursuivie a effectivement participé, en connaissance de cause, à la réalisation des faits criminel, objet des poursuites pénales. L’accusé se voit dispensé de prouver son innocence. Il n’a donc pas à fournir la preuve de son absence d’implication dans la commission des faits. Sa situation personnelle, qui oscille entre simple éventualité et certitude affirmée, crée une certaine ambivalence dans la mesure où son innocence ne se trouve que supposée. En fonction de cette problématique, les règles édictées pour le fonctionnement de la procédure pénale, assurent un point d’équilibre entre les droits de l’accusé et les droits de la société, et notamment par l’application du principe de la présomption d’innocence dans ses développements procéduraux sur la charge de la preuve et le bénéfice du douteCe cadre structurant peut toutefois se révéler défaillant dans ses applications. La procédure d’instruction, qui participe de cette construction, peut avoir pour conséquence de dilater la portée juridique de la présomption d’innocence. Dans ce cadre d’intervention des différentes parties au procès pénal, il se trouve établi que l’on donne à celui qui poursuit, une plus grande aisance dans l’administration de la preuve judiciaire. L’accusé voit sa situation amoindrie. Plus précisément, en favorisant, grâce à la sémantique, l’action du demandeur, c’est-à-dire du ministère public, on programme de fait une anticipation de la culpabilité. Ainsi, l’article 80 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dans sa version de 1990, précise t-il que » le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés ». Outre cette omnipotence qui transpire de la rédaction de cet article, et qui confère au juge d’instruction le sentiment de pouvoir disposer d’une autonomie de puissance, il faut noter que l’inculpation résulte d’un préjugement particulièrement explicite. Au regard de cette rédaction, il apparait que lorsque le juge prend sa décision l’ensemble des éléments constitutifs d’une infraction sont parfaitement réunis. La présomption d’innocence est immédiatement ignorée, lors même qu’elle doit s’appliquer. Cette attitude d’une culpabilité en devenir se retrouve également à l’article 80-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993. Il est énoncé que « le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou comme complice, aux faits dont il est saisi ». C’est parce qu’il apprécie souverainement les éléments, fondement des poursuites pénales, que le juge prend une décision de faire du suspect un accusé. Ce dernier tire de faits connus, et à la valeur indéfinie, le postulat que vraisemblablement l’accusé ne peut être que l’auteur des faits poursuivis. Le juge d’instruction présuppose, dans le cadre d’une démarche intellectuelle, que celui-ci a, selon toute vraisemblance, participé à l’infraction dont il est saisi. La présomption d’innocence connaît, dès les premières mesures d’instruction, un affadissement dans le cadre de cette rédaction qui pourtant était censée favoriser l’accusé.
Une présomption d’innocence paralysée par la nécessité de l’efficacité judiciaire
La règle civile reus in excipiendo fit actor, qui pose le principe que le défendeur doit rapporter la preuve de son moyen de défense, n’a pas à être appliquée en droit pénal La présomption d’innocence dispense l’accusé de démontrer son absence de participation aux faits, objets des poursuites pénales (1336). Ce droit à la passivité, demeure toutefois relatif. Il faut faire ici un premier constat relatif à la terminologie que le législateur devait employer pour définir un inculpé ou un prévenu. Ainsi, relève-t- on dans un décret du 20 mai 1903 portant sur l’organisation et le service de la gendarmerie, un article 126 qui énonce les différences sémantiques entre l’inculpé, le prévenu et l’accusé. S’agissant des deux dernières catégories, il est ainsi précisé que le prévenu est l’individu poursuivi comme présumé coupable d’un fait qualifié délit par la loi, tandis que l’accusé est l’individu poursuivi comme présumé coupable d’un fait qualifié crime par la loi. Certes, le qualificatif ainsi retenu constitue une présomption de culpabilité mais elle ne concerne que le fait poursuivi. Il s’agit donc d’une présomption de fait, non d’une présomption légale et encore moins d’une présomption de principe comme la présomption d’innocence. Il faut cependant admettre que la liberté prise avec le vocabulaire juridique ne fait qu’affaiblir la réalité de ce principe. En figeant juridiquement une situation factuelle avant toute procédure, celui qui sera initialement en charge de l’enquête va ainsi imprimer à la procédure un cours qui modifiera le regard porté sur l’accusé.Une telle situation sémantique complète en réalité une atmosphère où l’accusé se retrouve, sur le plan procédural, dans une situation où le présupposé est négatif. Il faut relever, qu’au sortir de la Révolution de 1789, le législateur impérial, pour prévenir des troubles éventuels qui pouvaient porter atteinte aux intérêts de l’état et des citoyens (1337), envisagea des solutions juridiques assurant une répression immédiate. Elles supposaient que la personne poursuivie réunissait les conditions matérielles faisant de lui l’auteur de l’infraction. La charge de la preuve, supportée normalement par la partie poursuivante, se déplaçait sur la personne poursuivie. Cette dernière devait justifier de son innocence, à savoir son absence de participation aux faits qui lui étaient reprochés. Il était ainsi créé une culpabilité supposée qui imposait un renversement de la charge de la preuve. Inscrites dans le code pénal de 1810, ces présomptions de culpabilité n’avaient d’autre finalité que d’assurer une paix intérieure mais aussi de préserver un ordre social nouvellement instauré. Ainsi l’article 277 du Code Pénal énonçait-il que « tout mendiant ou tout vagabond qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque, ou porteur d’armes, bien qu’il n’en ait usé ni menacé, ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons sera puni de deux à cinq ans d’emprisonnement ». De même, l’article 278 du même Code confirmait-il cette suspicion qui se voulait légitime à l’égard des gens au domicile incertain en précisant de façon plus topique que, « tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d’un ou plusieurs effets d’une valeur supérieure à 1F, et qui ne justifiera point d’où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l’article 276 ». En présence de ces textes, certes anecdotiques, mais qui perdurèrent néanmoins jusqu’en 1994 (1338), il faut reconnaître que le Code Pénal de 1810 avait, de fait, consacré une présomption de culpabilité qui portait sur l’intention criminelle, s’agissant de l’article 277 du Code pénal, et sur l’élément matériel pour l’article 278 du même code.
CONCLUSION
La consécration d’un droit à être protégé des mesures arbitraires que la royauté pouvait prendre à l’encontre de toute personne que l’on soupçonnait, résultait de la rédaction de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. La reconnaissance implicite d’un principe de procédure pénale, qui entendait organiser différemment la démonstration de la culpabilité, ne fut jamais envisagée par les Constituants. La volonté de rompre avec la justice de l’Ancien régime était réelle, mais l’attachement au système de la preuve légale demeurait. La présomption d’innocence se trouvait ainsi construite sur une antinomie puisque demeurait un mécanisme probatoire qui ne pouvait techniquement l’admettre, même si des mesures immédiates prises pour faire disparaître les aspects inhumains de la justice criminelle de l’Ancien régime. L’instauration de la procédure du jury par la loi des 16-29 septembre 1791 ouvrait cette possibilité de promouvoir le questionnement du juge sur sa certitude et donc de l’obliger à se décider autrement que suivant des règles probatoires rigides. La raison, le bons sens et la conviction intime allaient servir de viatique à la réflexion du juge. Toutefois, la transformation du procès pénal n’inscrivait pas la présomption d’innocence tirée de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen comme règle organisant le rapport antagoniste entre l’accusé et l’accusateur au profit du premier. Le silence qui allait recouvrir, par la suite, ce principe dans l’élaboration d’une nouvelle procédure criminelle, pourtant héritière en partie de l’Ancien régime et de la Révolution, mais aussi le fait que l’intime conviction devienne le seul vecteur du processus décisionnel, paralysa une approche différenciée de la preuve pénale. L’article 372 du Code Délits et des Peines du 3 Brumaire an IV repris sous l’article 342 du Code d’Instruction Criminelle, tout en traduisant « toute la foi de la fin du XVIIIè siècle et du début du XIXè siècle en l’homme »(1349), confirme ce silence sur la présomption d’innocence, ou plus précisément continue d’ignorer la réelle dimension procédurale de ce principe.