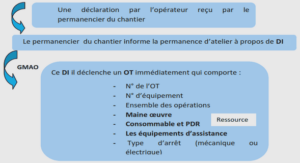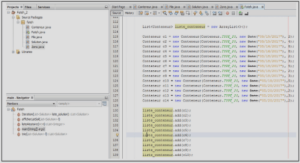La connaissance par sentiment au XVIIIème siècle
La connaissance de soi Introduction
Dans sa grande recherche sur les sources de la pensée religieuse de Rousseau, PierreMaurice Masson considère que, dans l’esprit des philosophes de la première moitié du XVIIIe siècle qui ont influencé Rousseau, il n’y a qu’une seule science nécessaire qui est de se connaître soi-même1 . Il est tout à fait remarquable qu’il associe dans son analyse cette préoccupation propre aux Addison, Saint-Aubin, abbé Pluche ou Père Buffier, avec l’antirationalisme qui les caractérise2 , manifestant ainsi à grands traits un point classique de l’histoire de la philosophie : la connaissance de soi, au XVIIIe siècle, est l’affaire du sentiment. L’autobiographie telle qu’elle est pratiquée par Rousseau manifesterait l’accomplissement littéraire de ce principe3 . Si ce trait est bien connu, les raisons de sa nouveauté et la complexité de sa signification sont moins bien établies. Nous ne remonterons pas jusqu’à la conception antique de la connaissance de soi et à l’interprétation que reçoit l’inscription du temple de Delphes dans la philosophie grecque . Nous nous contenterons d’évoquer ici la façon dont elle est comprise dans la philosophie occidentale du Moyen-Age à partir des analyses d’Étienne Gilson5 : comme dans la conception socratique, cette connaissance est comprise sous un horizon moral, en ce qu’elle est supposée rendre meilleur celui qui s’y applique. À cela, le christianisme ajoute cependant un enjeu théologique de taille : se connaître doit permettre de saisir ce qui rend l’homme à l’image de Dieu. Si la connaissance de soi commence par un examen de conscience dans lequel l’âme doit reconnaître ses péchés, elle doit aboutir à la découverte de l’image universelle de Dieu en elle6 . L’influence de cette perspective est encore très marquée au XVIIe siècle : la plupart des traités portant sur la connaissance de soi sont écrits par des 1 Pierre-Maurice Masson, La religion de Jean-Jacques Rousseau, Tome I, La formation religieuse de Rousseau, chapitre VII, Genève, Slatkine reprints, 7, p « Tenons-nous en garde, disent ces sages, contre « les clartés ténébreuses » de la raison et « la science imaginaire » des prétendus philosophes ; « réprimons les saillies de notre curiosité ». « L’ivresse d’un faux savoir » conduit à l’athéisme. Il n’y a qu’une science nécessaire, c’est de se connaître soi-même : le seul bénéfice des autres sciences, c’est de nous faire sentir que nous ne savons rien », ibid D’après Jean Starobinski commentant le « Je sens mon cœur » du début des Confessions, la connaissance de soi chez Rousseau est fondée sur le sentiment immédiat et transparent que l’âme a d’elle-même, Cf. La transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, 71, p Pour un condensé de la conception socratique de la connaissance de soi, voir Platon, Alcibiade, 1 b-c, traduction de Chantal Marboeuf et Jean-François. Pradeau, Paris, GF, , p. Jean-Pierre Vernant présente les grandes caractéristiques de la connaissance de soi chez les Grecs : elle n’est ni individuelle, ni introspective, ni immédiate cf. L’individu, la mort, l’amour, Paris, Gallimard, 89, p-2 Étienne Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, chapitre XI, Paris, Vrin, 89. La grande nouveauté qu’apporte le christianisme au problème de la connaissance de soi selon lui vient de la ressemblance de l’homme avec Dieu, créé à son image. Voir aussi Pierre Courcelles, Connais-toi toi-même de Socrate à Saint Bernard, Paris, Études augustiniennes, 3 volumes, 74-75 Ibid., p et 2. moralistes pour qui la réflexion sur soi peut aussi bien renforcer l’amour propre si elle est mal menée, que porter à l’humilité et, in fine, à l’union à Dieu si elle est bien menée1 ; ainsi en estil du protestant Abbadie dans L’art de se connaître soi-même ou la recherche des sources de la morale (92), de Bossuet dans son traité De la connaissance de Dieu et de soi-même (7-8), ou encore de Nicole dans ses Essais de morale (71), qui commencent par un traité sur la connaissance de soi. Dans le sillage du « Socratisme chrétien2 », c’est à chaque fois l’âme seule qui est l’objet et le sujet de cette étude. Concernant les modalités de cette connaissance, elles diffèrent dans la tradition augustinienne et dans la tradition thomiste. Pour le dire vite, Augustin considère que l’âme peut se connaître directement par son essence : elle entretient un rapport immédiat à ellemême par lequel elle se connaît tout entière3 . Pour Thomas, l’âme se connaît par elle-même, mais seulement par ses actes tels qu’ils s’appliquent aux réalités matérielles4 . Selon É. Gilson, la philosophie chrétienne du Moyen-Age lègue en tout cas cette idée que le soi à connaître est une substance spirituelle immortelle, qui, en tant qu’elle porte l’image de Dieu, demeure toujours incompréhensible5 . C’est aussi pour cette raison que c’est toujours par ce qu’elle a de plus haut, la pensée ou l’intellect, qu’elle doit chercher à se connaître6 . On peut dire que sur ce point, Descartes manifeste plutôt une continuité avec la philosophie chrétienne du MoyenAge : c’est par la pensée que le soi, identifié à l’âme, se connaît, dans la mesure où la pensée est toujours consciente de ses actes. Arnauld, Leibniz, ou encore Mérian s’approprieront ce principe en donnant un sens fort à la notion de conscience qui apparaît à cette époque dans son sens psychologique – nous y reviendrons –, en la comprenant comme une conscience réflexive, apanage des substances intelligentes Geneviève Rodis-Lewis présente ce paradoxe du rapport classique à la connaissance de soi dans l’introduction du Problème de l’inconscient et le cartésianisme, Paris, P.U.F., 5, rééd5, p sqq. Elle décrit très bien de quelle façon le contexte culturel et religieux, respectivement inspirés de Montaigne et de saint François de Sales, favorise l’introspection tout en découvrant la complexité de l’âme É. Gilson, op. cit., p « Enfin lorsque l’âme cherche à se connaître, elle sait déjà qu’elle est une âme : autrement, elle ignorerait qu’elle se cherche et risquerait de chercher une chose pour une autre. (…) Or, puisque l’âme, lorsqu’elle cherche ce qu’est l’âme, sait qu’elle se cherche, c’est donc qu’elle sait qu’elle est âme. Au surplus, si elle sait intuitivement qu’elle est âme et qu’elle est tout entière âme, c’est qu’elle se connaît tout entière », saint Augustin, De la Trinité, X, IV, 6, BA , p-1 Ibid., p-2. Voir Saint Thomas : « Selon le Philosophe au livre III de l’Ame et le Commentateur au même endroit, l’âme rationnelle se connaît elle-même moyennant une certaine similitude ; d’autre part, selon Augustin au neuvième livre De la Trinité, la partie spirituelle de l’âme, là où se trouve l’image de Dieu, se connaît elle-même, et immédiatement par elle-même. Donc la raison ne se confond pas avec cette partie spirituelle où l’on reconnaît l’intellect », Questions disputées sur la vérité, question XV, article I, 6, Paris, Vrin, 91, p. ; « L’esprit se connaît par lui-même, parce qu’il finit par arriver à la connaissance de lui-même, bien que ce soit par son acte », Somme théologique, I, qu7, art. I, Tome I, Paris, éditions du Cerf, 9, p58 Ainsi, même pour Augustin, « la pensée elle-même ne peut être comprise, fût-ce par elle-même, en tant qu’elle est une image de Dieu », De symbolo, I, 2, cité par É. Gilson, op. cit., p Ibid. Ce bref aperçu permet de mesurer par contraste la rupture introduite à la fin du XVIIe siècle par la conception de Malebranche d’après qui la connaissance de l’âme se fait par sentiment intérieur. Ce n’est pas par ce qu’il y a en elle de divin et d’infini que l’âme se connaît mais, au contraire, par ce qui manifeste sa finitude et révèle l’union qu’elle a avec le corps. L’âme ne peut parvenir à saisir son essence pour des raisons toutes autres que celles alléguées par les philosophes médiévaux : que l’âme soit connue par sentiment signifie qu’elle n’est jamais connue telle qu’elle est indépendamment du corps. Ce qui fait de la connaissance de soi une tâche difficile et même vaine n’est pas notre union à l’Être infini, mais la dimension affective et sensible des pensées par lesquelles nous nous connaissons. Malebranche joue ainsi un rôle très important dans le développement d’une conception « sensible » de la connaissance de soi, dont témoigne, par exemple, l’évolution lexicale du terme « conscience » de trois dictionnaires de l’époque. Le Dictionnaire de Furetière de 9 définit la conscience comme « témoignage ou jugement secret de l’âme raisonnable, qui donne l’approbation aux actions qu’elle fait qui sont naturellement bonnes, et qui lui fait un reproche ou qui lui donne un repentir des mauvaises. La conscience est ce que nous dicte la lumière naturelle, la droite raison (…) ». La conscience, encore définie dans son sens moral scolastique1 , renvoie alors à un acte de la raison. Dans le Dictionnaire de Trévoux de 71, on trouve, après une première définition quasiment identique à celle-là2 , une nouvelle définition qui donne un sens psychologique à la conscience et l’associe à une affection intérieure plutôt qu’à un jugement de la raison : En métaphysique, on entend par la conscience ce que d’autres appellent sens intime, c’est-àdire le sentiment intérieur qu’on a d’une chose dont on ne peut former d’idée claire et distincte. Dans ce sens, on dit que nous ne connaissons notre âme et que nous ne sommes assurés de l’existence de nos pensées, que par la conscience ; c’est-à-dire par le sentiment intérieur que nous en avons, et par ce que nous sentons ce qui se passe en nous-mêmes. Enfin, le Littré de 72 présente l’intérêt de faire passer en premier la définition psychologique et affective de la conscience définie comme « sentiment de soi-même ou mode de la sensibilité générale qui nous permet de juger de notre existence : c’est ce que les métaphysiciens nomment la conscience du moi » ; il confirme ainsi l’orientation générale que suit la question de la connaissance de soi à l’époque moderne Le Lexicon philosophicum de Goclenius de définit la conscience à partir de trois éléments comme : 1/ ensemble de principe moraux qui doivent guider nos actions ; 2/ souvenir des pensées et des actions que nous avons accomplies ; 3/ Jugement moral de nos actions remémorées à partir des principes moraux « Témoignage ou jugement secret de l’âme raisonnable, qui donne l’approbation aux actions qu’elle fait, qui sont naturellement bonnes ». Le problème est de déterminer le sens qu’il faut donner à ce sentiment par lequel le soi se rapporte à lui-même à l’âge classique. En premier lieu, se connaître par sentiment pourrait simplement signifier qu’on se connaît à partir de perceptions sensibles plutôt qu’à partir d’une pensée discursive et abstraite. C’est l’interprétation de Locke, qui voit dans le sentiment malebranchien une simple perception de notre esprit, synonyme pour lui d’idée. Dire qu’on se connaît par sentiment reviendrait alors à insister sur la passivité de cette connaissance obtenue par une observation intérieure. Locke, cependant, ne reprend pas le terme de sentiment qu’il juge de ce point de vue inutile par rapport à celui, déjà existant, de sensation. En second lieu, se connaître par sentiment pourrait signifier se connaître par des sentiments qui ne renverraient plus aux perceptions ou idées que nous observons en notre esprit mais aux plaisirs et aux douleurs que nous ressentons, qui sont liés à notre existence corporelle. Georges Vigarello, dans son livre Le sentiment de soi1 , qui porte sur l’histoire de la perception du corps, considère justement que le XVIIIe siècle marque une étape décisive dans l’intégration du corps à l’identité individuelle. L’attention aux sensations internes serait croissante ; le développement conséquent du sentiment interne viendrait enrichir la connaissance de soi en lui ajoutant cette perception de l’organisme, le Rêve de d’Alembert de 79 étant le point culminant de cette évolution2 . Toutefois, si la nouveauté qu’instaure la connaissance de soi par sentiment au XVIIIe siècle revient à dire que l’on se connaît par nos sensations, pourquoi le terme donné pour définir la conscience dans les dictionnaires est-il celui de sentiment ? Il nous semble que G. Vigarello manque un aspect crucial de la connaissance de soi au XVIIIe siècle : c’est justement qu’elle repose sur le sentiment plutôt que sur les sensations. Nous entendons comprendre ce qui fait du sentiment ce mode privilégié de la connaissance de soi par rapport aux sensations. Nous avons vu dans l’introduction générale de cette étude qu’il désignait, au XVIIe siècle, la faculté de sentir en général. L’enjeu de cette première partie est de montrer que c’est justement en rapport avec le problème de la connaissance de soi que se réalise la distinction entre la sensation et le sentiment et d’en tirer les conséquences : les sentiments vont peu à peu désigner les perceptions sensibles qui nous informent sur notre état intérieur plutôt que sur celui des objets extérieurs. Ainsi, nous verrons que si Malebranche, par le sentiment, « sensibilise » la connaissance de soi, ce n’est pas parce 1 G. Vigarello, Le Sentiment de soi, Histoire de la perception du corps, XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil, Ainsi Diderot, selon G. Vigarello, « tente de parler du corps comme jamais jusque-là, s’aventurant, selon ses propres termes, à son « étendue réelle ou imaginaire », soulignant la convergence entre les sensations physiques « intérieures » et le sentiment d’identité d’une personne, suggérant un rapport nouveau entre l’appréciation de l’organique et celle du « je » (…) », ibid., p. . qu’il tente d’en rendre compte à partir des seules perceptions des sens : le sentiment intérieur ou la conscience renvoie à une modalité affective irréductible à la sensibilité dérivée des sens externes, même si, en commun avec elle, elle est une connaissance immédiate que le sujet reçoit passivement, opposée à la réflexion.La connaissance de l’âme. A – La connaissance de soi chez Descartes et les cartésiens) Descartes : semences du problème. Descartes considère le sentiment, compris comme faculté de sentir, comme une propriété de l’âme. Conformément au §9 de la quatrième partie des Principes de la philosophie, le sentiment désigne la perception en l’esprit des mouvements transmis par les nerfs1 . « Sentiment » est un terme générique pour qualifier toutes les perceptions de l’âme issues des sens – le terme « sensation » n’étant pas encore en usage à l’époque2 . Ce mot traduit le mot latin « sensus » que nous trouvons par exemple dans le texte latin des Principia3 , et qui désigne indistinctement toutes les perceptions sensibles. Ces sens peuvent être internes, les sentiments renvoient alors aux appétits naturels et aux passions, ou externes, les sentiments sont alors les perceptions sensibles causées par l’impression des corps extérieurs sur nos organes. Un des points de départ de l’entreprise cartésienne visant à fonder la science est de révéler le préjugé qui consiste à croire que les sentiments sont des propriétés des objets extérieurs. La science physique ne doit pas se fonder sur le sentiment mais sur les idées claires et distinctes conçues par l’entendement et articulées au moyen des opérations de l’intuition et de la déduction. Si le sentiment se trouve ainsi disqualifié comme principe pour la connaissance des corps, il est moins sûr qu’il ne trouve pas une place dans la connaissance que l’esprit a de lui-même, ne serait-ce que parce qu’il est une propriété de l’esprit à connaître. Dans la mesure où Malebranche fera du sentiment le mode privilégié par lequel l’âme se connaît, il est intéressant de reprendre les textes cartésiens sur la question pour pouvoir évaluer, au moment venu, si oui ou non il y a dans la conception malebranchiste de la connaissance de soi un héritage cartésien4 . Dans cette perspective, nous n’étudierons pas l’acte de sentir en lui-même tel que le comprend Descartes, comme mode de la pensée 1 « Les mouvements qui passent ainsi, par l’entremise des nerfs, jusques à l’endroit du cerveau auquel notre âme est étroitement jointe et unie lui font avoir diverses pensées, à raison des diversités qui sont en eux ; et enfin, que ce sont ces diverses pensées de notre âme, qui viennent immédiatement des mouvements qui sont excités par l’entremise des nerfs dans le cerveau, que nous appelons proprement nos sentiments, ou bien les perceptions de nos sens. », Descartes, Les Principes de la philosophie, IV, §9, AT IX-2, p. Sur ce point, voir l’introduction de R. de Calan à son ouvrage Généalogie de la sensation, p. – Pour le §9 de la quatrième partie que nous venons de citer, l’original latin est : « Motus autem qui sic in cerebro a nervis excitantur, animam, sive mentem intime cerebro conjunctam, diversimode afficiunt prout ipsi sunt diversi. Atque hae diversae mentis affectiones, sive cogitationes ex istis motibus immediate consequentes, sensuum perceptiones, sive, ut vulgo loquimur, sensus appellantur », Principia philosophiae, AT VIII-1, p Ce passage nous semble incontournable, dans la mesure où le XVIIIe siècle se réfère sans cesse à Malebranche, mais aussi à Descartes. Nous prions notre lecteur d’excuser la reprise de thèmes bien connus dans ce premier temps. engageant un rapport particulier au corps, mais la modalité particulière par laquelle l’âme se connaît. a) L’objet de la connaissance de soi dans les Méditations de Descartes. Les Méditations métaphysiques font apparaître la structure spécifique de la connaissance de soi chez Descartes, en rupture avec la conception scolastique que défendra Gassendi dans les Cinquièmes objections : c’est une connaissance directe et non réfléchie. Il convient en premier lieu de reprendre le début des Méditations, où la connaissance que le sujet a de lui-même se présente comme la première connaissance qui est mise à l’épreuve par l’exercice du doute : avant les vérités scientifiques et l’existence de Dieu, c’est ce que le sujet sait de lui-même par ses sens qui est révoqué. Pour se connaître de façon assurée, il va donc faire abstraction de son corps. Partant, au début de la Seconde Méditation, la première certitude que trouve le sujet méditant, sur laquelle il pourra rebâtir l’édifice de ses connaissances, est son existence en tant que chose qui pense. Il s’agit de transformer cette certitude en connaissance adéquate, en dégageant ce qu’il est. Seuls les attributs de l’âme qui n’ont pas besoin du corps pour exister peuvent constituer des propriétés assurées de son être : c’est le cas de la pensée, qui est reconnue comme étant l’attribut essentiel du sujet considéré comme esprit. Ainsi, dans la Seconde Méditation, Descartes découvre que la nature de l’esprit s’épuise dans la pensée ; toute action du sujet pensant est une manière de pensée qui se rapporte au moi comme à son principe. Les résultats de la connaissance de soi peuvent paraître limités : tout ce qu’apprend le sujet méditant de lui-même revient à découvrir qu’il est présent derrière chaque pensée1 : l’exercice de la méditation lui découvre que lui seul, comme sujet pensant, ne peut être séparé de lui2 . Le doute montre de quoi je peux me distinguer et qui peut ainsi être un objet pour moi, et ce qui ne deviendra jamais un objet pour moi-même dans la mesure où je ne peux absolument pas m’en distancier. C’est ce qu’a bien compris Gassendi, qui, dans les Cinquièmes Objections, rapporte ce qu’il estime être les décevants résultats de l’analyse cartésienne de la substance pensante à la structure même de la pensée, dont la proximité avec le sujet la disqualifie comme possible objet de connaissance. Selon lui, il n’est pas étonnant 1 Voir par exemple l’article de Denis Kambouchner « Des vraies et des fausses ténèbres », in Antoine Arnauld, Philosophie du langage et de la connaissance, Jean-Claude Pariente (dir.), Paris, Vrin, 95, p. – 1 et p-8 « Y a-t-il aussi aucun de ces attributs qui puisse être distingué de ma pensée, ou qu’on puisse dire être séparé de moi-même ? Car il est de soi si évident que c’est moi qui doute, qui entends, et qui désire, qu’il n’est pas ici besoin de rien ajouter pour l’expliquer », Descartes, Méditations métaphysiques, II, AT IX-1, p. . que Descartes ne soit pas parvenu à dégager des propriétés inconnues de son esprit, dans la mesure où le rapport que l’âme entretient avec elle-même ne satisfait pas aux conditions requises pour toute connaissance, qui reposent avant tout sur la distance existant entre l’objet et le sujet de connaissance : Or étant d’ailleurs nécessaire, pour avoir la connaissance d’une chose, que cette chose agisse sur la faculté qui connaît, c’est-à-dire qu’elle envoie en elle son espèce, ou bien qu’elle l’informe et la remplisse de son image, c’est une chose évidente que la faculté même n’étant pas hors de soi ne peut pas envoyer ou transmettre en soi son espèce, ni par conséquent former la notion de soi-même. Et pourquoi pensez-vous que l’œil, ne se voyant pas lui-même dans soi, se voit néanmoins dans un miroir ? C’est sans doute parce qu’entre l’œil et le miroir il y a un espace, et que l’œil agit de telle sorte contre le miroir en envoyant contre lui son image, que le miroir après agit contre l’œil en renvoyant contre lui sa propre espèce. Donnez-moi donc un miroir contre lequel vous agissiez en même façon, et je vous assure que, venant à réfléchir et renvoyer contre vous votre propre espèce, vous pourrez alors vous voir et connaître vous-même, non pas à la vérité par une connaissance directe, mais du moins par une connaissance réfléchie ; autrement je ne vois pas que vous puissiez avoir aucune notion ou idée de vous-même1 . D’après Gassendi, pour avoir une connaissance de lui-même, l’esprit doit disposer d’une idée de lui-même. Selon le modèle scolastique qu’il reprend et d’après lequel les idées sont formées à partir des espèces reçues des objets extérieurs, cela supposerait que l’esprit s’envoie à lui-même une espèce et agisse ainsi sur lui-même. L’action d’un objet sur un sujet présuppose que le premier soit extérieur au second. Or, le propre de la pensée est de ne pas être hors de soi. À l’instar de l’œil qui a besoin d’un miroir pour se voir, rien ne peut connaître ce qui n’a aucune distance avec lui-même : par excellence, soi-même. Pour l’atomiste, la seule manière pour que l’âme se connaisse supposerait qu’elle se considère à partir d’un point de vue extérieur. En l’état, la méditation de Descartes n’instaure pas, selon lui, les conditions de cette connaissance réflexive qu’il appelle de ses vœux. L’intérêt de la critique de Gassendi pour nous est de mettre au jour les conditions de possibilité de la connaissance telles qu’elles sont définies dans la philosophie scolastique dont hérite le XVIIe siècle, ainsi que la spécificité du rapport de l’âme à elle-même, que Gassendi reconnaît en la critiquant. À partir de là, la défense de Descartes pourrait se développer sur deux fronts : 1/ montrer que l’esprit dispose en lui-même d’un miroir qui lui permet d’instaurer une certaine distance avec lui-même, qu’on nommera « réflexivité » ; 2/ montrer que la distance n’est pas requise pour tout type de connaissance, notamment pour celle où l’esprit se prend lui-même pour objet. La réponse de Descartes à Gassendi est énigmatique et ne permet pas vraiment de décider lequel de ces deux fronts est privilégié : 1 Pour les Cinquièmes et les Septièmes objections et réponses, on citera la traduction de Ferdinand Alquié dans son édition, Paris, Classiques Garnier, 3 volumes, ; pour le passage cité, voir les Cinquièmes objections, tome II, p-7. (…) ce n’est point l’œil qui se voit lui-même ni le miroir, mais bien l’esprit, lequel seul connaît et le miroir, et l’œil, et soi-même1 . Descartes reconnaît que l’œil ne se voit pas lui-même, mais pour une autre raison et qui est bien connue : même face à un miroir, ce n’est pas l’œil, compris comme organe, qui se voit lui-même ; c’est l’esprit, par l’œil. Seul l’esprit est sujet de connaissance, et en connaissant la chose, il se connaît soi, dans la mesure où le propre de l’esprit est de se reconnaître dans chacune de ses activités, comme l’a établi la Seconde Méditation. Il demeure que Descartes ne répond pas à la question de savoir si l’esprit peut se connaître lui-même directement, sans un détour par la connaissance d’un objet extérieur ou, plus généralement, par une activité de l’esprit. Si Descartes, dans la Seconde Méditation, établit que les modalités de l’esprit pensant lui apparaissent avec évidence – il apparaît par exemple évidemment à l’esprit que l’action d’imaginer ne peut être distinguée de sa pensée et ainsi de lui-même – il semble, dans les réponses, établir la réciproque de cette découverte : tout ce qui se fait en signalant sa présence à l’esprit est une pensée. C’est ce qu’expose clairement la première définition de la pensée dans l’exposé géométrique qui apparaît à la fin de la Réponse aux Secondes Objections : Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous, que nous en sommes immédiatement connaissants (ut ejus immediate consciisimus). Ainsi toutes les opérations de la volonté, de l’entendement, de l’imagination et des sens, sont des pensées2 .
Remerciements |