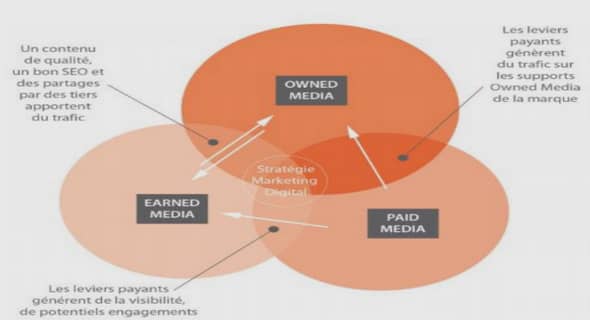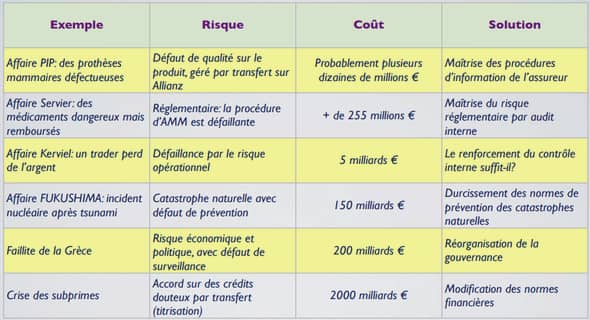Dans la poursuite de ce qui précède, une démarche scientifique sur un phénomène humain se distingue, selon Mucchielli (2006), d’une simple démarche « narratologique » par le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de raconter ou de rapporter les phénomènes, ou encore de partager ses impressions ou sentiments à leur propos. « A contrario, une approche scientifique nécessite une compréhension du pourquoi et du comment, et non une seule connaissance de l’existence du phénomène » (Mucchielli, 2006, p.38). L’approche scientifique doit décortiquer le fonctionnement d’un phénomène, en le rendant compréhensible à l’aide de schémas intellectuels de référence. Dans cette perspective, nous présentons le cadre de référence de notre recherche qui comprend trois schémas intellectuels de référence : un positionnement compréhensif pour l’exploration du phénomène du savoir-être humaniste, une approche coconstructiviste pour explorer le savoir-être humaniste, et le cadre de référence de la science-action pour comprendre que le phénomène du savoir-être humaniste est enraciné dans la pratique d’un leadership démocratique.
Un positionnement compréhensif
Lorsqu’un chercheur veut situer sa recherche selon les conditions de la connaissance scientifique, il est en présence de deux principaux positionnements épistémologiques, selon qu’il étudie les phénomènes naturels et physiques ou les phénomènes humains. Les phénomènes naturels et physiques demandent des « explications » tandis que les phénomènes humains plus complexes requièrent avant tout une « compréhension ». Cette quête de compréhension s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative qui favorise une « démarche subjectiviste » (Mucchielli, 2006) du chercheur pour comprendre, selon une logique inductive, le phénomène étudié. Selon Mucchielli (2009) : « l’approche compréhensive est un positionnement intellectuel (une prise de position épistémologique) qui postule d’abord la radicale hétérogénéité entre les faits humains et sociaux et les faits des sciences naturelles et physiques » (p. 24). Il suppose également qu’il est possible pour tout homme de pénétrer le vécu et le ressenti d’un autre homme. Cette compréhension comporte une part de saisie intuitive basée sur des efforts d’empathie de la part d’un chercheur pour avoir accès au monde subjectif des personnes qui vivent le phénomène étudié. Pour Pourtois et Desmet (2009) : « le paradigme compréhensif accordera donc une attention aux données qualitatives, intégrera l’observateur et l’observé dans ses procédures d’observation » (p.28). C’est ce type de positionnement et d’attitude de compréhension empathique que nous adoptons pour entrer dans l’univers subjectif de gestionnaires afin de comprendre, comme eux le vivent, le phénomène du savoir être humaniste. Mucchielli (2006) souligne que « cet effort conduit, par synthèses progressives, à formuler une synthèse finale, plausible socialement, qui donne une interprétation en compréhension de l’ensemble étudié » (p. 43). Comme nous l’illustrerons, en suivant l’itinéraire des gestionnaires, sujets de notre étude, nous anticipons par un travail de synthèses en synthèses de leurs réflexions et de nos réflexions sur leur pratique d’un leadership démocratique parvenir à la fin du processus à un modèle intégré du savoir-être humaniste lié à cette pratique.
En demeurant dans le schéma intellectuel du positionnement compréhensif, cinq postulats du positionnement compréhensif systématisés par E. Morin (cité dans Mucchielli, 2006, p.44) illustrent bien notre compréhension du phénomène du savoir-être humaniste issu de la pratique d’un leadership démocratique:
1) Il n’existe pas de réalité objective donnée ; par conséquent, nos observations et les réflexions des gestionnaires sont des données qualitatives subjectives issues de leur processus perceptuel qui traduit la réalité du savoir-être humaniste telle que chacun la perçoit.
2) Il existe plusieurs réalités construites aussi vraies les unes que les autres ; chaque sujet de notre recherche nous donne accès à sa propre réalité de la pratique d’un leadership démocratique.
3) Un phénomène n’existe jamais tout seul, il existe nécessairement en relation avec d’autres phénomènes ; le phénomène du savoir-être humaniste est interdépendant du phénomène de la pratique d’un leadership démocratique.
4) Si une réalité de sens émerge, elle n’est pas due à une cause mais à un ensemble de causalités circulaires ; le phénomène du savoir-être humaniste étant complexe implique qu’il ne peut se comprendre selon un mode de causalité linéaire en lien avec une pratique du leadership démocratique. Ce phénomène s’appréhende par un ensemble de causalités circulaires qui font que la pratique d’un leadership démocratique et le savoir-être humaniste évoluent en tandem pour former un tout organisé, dynamique et complexe de telle sorte que plus un gestionnaire exerce un leadership démocratique, plus il développe son savoir-être humaniste.
5) La cause n’est plus seulement une cause antérieure mais aussi une visée ; la compréhension du phénomène du savoir-être humaniste étant interdépendante de la pratique d’un leadership démocratique ne suppose pas une antériorité entre ces deux phénomènes de telle manière qu’il est difficile de déterminer si le savoir-être humaniste est la cause ou le résultat d’un leadership démocratique.
Un positionnement constructiviste
À ce positionnement compréhensif est lié un positionnement d’ordre méthodologique que représente une démarche scientifique « constructiviste » qui implique que le regard du chercheur pour comprendre un phénomène humain est constamment en construction (Paillé & Mucchielli, 2008). Pour le constructivisme, la connaissance, dont celle d’un modèle théorique du phénomène du savoir-être humaniste issu de la pratique d’un leadership démocratique, est :
1º) construite, 2º) inachevée, 3º) plausible, convenante et contingente, 4º) orientée par des finalités, 5º) dépendante des actions et des expériences faites par les sujets connaissants, 6º) structurée par le processus de connaissance tout en le structurant aussi, 7º) forgée dans et à travers l’interaction du sujet connaissant avec le monde (Mucchielli, 2006, p.48).
Ces postulats du constructivisme se traduisent en huit principes. Les quatre premiers sont qualifiés de « faibles » signifiant ainsi qu’on retrouve ces règles dans toutes les recherches qualitatives. Les quatre autres principes du constructivisme scientifique sont dits forts dans le sens qu’ils caractérisent spécifiquement une recherche constructiviste et qu’ils ont des exigences difficiles à mettre en œuvre. Nous allons présenter comment nous avons pris en considération ces quatre principes dans notre recherche.
a) Le principe téléologique : on ne peut pas séparer la connaissance construite des finalités attachées à l’action de connaître. Rappelons que l’acte cognitif a un caractère intentionnel et a donc une finalité pratique. Or selon Mucchielli (2006) : « il faut que le chercheur prenne la peine de l’énoncer, puisque cette finalité va orienter ses résultats » (p. 51). Pour respecter ce premier principe, nous avons planifié de présenter aux participants la finalité de notre recherche en tant que la production d’un modèle général d’un savoir-être humaniste dans l’exercice du leadership démocratique. Cette finalité nous apparaît comme une orientation utilitariste à la connaissance constructiviste.
b) Le principe de l’expérimentation de la connaissance : la connaissance est totalement liée à l’activité expérimentée et donc vécue du sujet. Selon Mucchielli (2006), pour qu’une recherche réponde à ce principe : « le chercheur doit donc être au contact des phénomènes qu’il explore » (p. 51). Ce deuxième principe fort du constructivisme stipule que la connaissance du phénomène du savoir être humaniste est totalement liée aux réflexions que font les gestionnaires sur la pratique du leadership démocratique présente quotidiennement dans leur vie et aux activités vécues tout au long de leur itinéraire réalisé dans le présent projet de recherche. Pour appliquer ce principe à notre recherche, l’approche d’une recherche coopérative (Reason, 1999) est un choix que nous faisons pour que les gestionnaires, sujets de notre étude, soient également des cochercheurs puisque ce sont eux qui expérimentent par leur pratique d’un leadership démocratique leur théorie d’usage du savoir-être humaniste.
c) Le principe de la connaissance par l’interaction : la connaissance est le fruit d’une interaction du sujet connaissant et de l’objet de connaissance. Pour répondre à ce critère d’interaction, nous avons prévu que les participants de notre recherche participent à une construction de la connaissance en utilisant des outils variés tels que le récit de pratique, le journal d’itinérance, l’apprentissage dans et sur l’action en contexte de nature et d’aventure. Le choix de ces outils est de nature à mettre chaque gestionnaire en interaction avec le phénomène du savoir-être humaniste qu’il vit dans sa pratique d’un leadership démocratique. Pour favoriser cette interaction du sujet connaissant avec l’objet de sa connaissance, nous créons des contextes diversifiés d’interaction entre les gestionnaires, ainsi qu’entre les gestionnaires et le chercheur pour connaître ce phénomène.
d) Le principe de récursivité de la connaissance : la connaissance établie et le processus de connaissance qui l’établit se structurent réciproquement. Ce quatrième et dernier principe du constructivisme découle du fait que la connaissance est à la fois un processus et un résultat. Pour Mucchielli (2006) : « il y a récursivité de ce qui est en train de se construire sur les processus de la construction elle-même » (p. 52). Toujours selon l’auteur, ce principe « semble exclure toutes les méthodologies fermées, c’est-à-dire incapables de souplesse et d’un minimum d’adaptabilité aux résultats qui sont progressivement construits. Il semble privilégier toutes les méthodologies itératives et modulables » (Mucchielli, 2006, p. 53). Pour répondre à ce quatrième principe, nous avons planifié une démarche de recherche qui se concrétise par un accompagnement des participants sur une année avec différentes activités en progression, dans le but de voir émerger une connaissance qui se construit progressivement. Lors de la dernière phase, soit l’expédition en plein air vécue en groupe de façon intensive, les périodes de discussion en groupe (débriefing sur l’expérience vécue) que nous avons envisagées pourront être des moments particulièrement riches en récursivité. Les connaissances du moment présent sont alimentées par l’instant passé et structurent l’action future d’observation. Nous avons pensé pouvoir privilégier ainsi un aller-retour créatif entre la méthode et le résultat propre à ce dernier principe d’une recherche constructiviste.
INTRODUCTION |