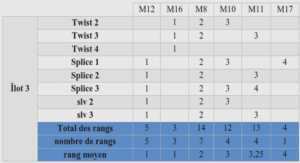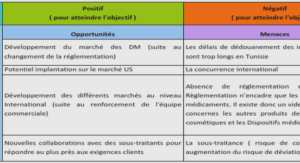La carnavalisation le monde à l’envers
Selon Bakhtine, pendant le carnaval le monde est mis à l’envers parce que l’ordre des choses se retrouve légèrement inversé avec la suspension temporaire de certains interdits. La carnavalisation est la transposition vers les arts de certaines caractéristiques carnavalesques telles que l’humour, la satire et l’inversion des choses, des procédés typiques des chanchadas. Les chanchadas ont mis le monde à l’envers sans se préoccuper de savoir si cela était bon ou mauvais, si cela allait réformer le monde ou le rendre plus conformiste, plus révolutionnaire ou plus conservateur. L’objectif de ces films était avant tout de faire rire, de proposer une inversion de la vie ordinaire sans se préoccuper de sa réversibilité permanente. Insatisfaits de l’inégalité de la société brésilienne qui excluait les classes subalternes du processus de développement industriel, ils ont essayé de représenter le monde que ces classes auraient aimé voir et avoir ; ils ont osé imaginer comment serait ce monde où les riches et les libéraux anti-nationaux seraient les marginaux – sens qu’ils ont pris au pied de la lettre en confondant assez régulièrement, de façon très manichéenne, richesse et délinquance. Richesse et délinquance sont très bien matérialisées dans le personnage du Conde Vedura dans le film Carnaval Atlântida. José Lewgoy, le principal vilain du genre, joue le rôle d’un chauffeur qui se fait passer pour un comte afin d’épouser la nièce du directeur et producteur Cécil B. De Milho, jouer dans le métafilm et devenir riche. D’une certaine manière, le salarié qu’il représente sait qu’il ne pourra pas s’en sortir par son travail. Le producteur le déteste et s’en méfie, craignant qu’il soit un imposteur. Un jour, après avoir attendu pendant plus de quatre heures pour lui parler, le faux comte s’endort et rêve qu’il est riche. Il arrive dans une belle voiture décapotable à un café-concert sophistiqué où il est reçu par six belles femmes qui sonnent les clairons en annonçant son arrivée. Il est élégamment vêtu et porte des blasons. Il est heureux, il danse et caresse une à une les six femmes. Il est salué par le portier qui se courbe devant lui. A l’intérieur du lieu, nous voyons des personnes qui semblent représenter la haute élite brésilienne, des personnes qui ressemblent à des princes et des princesses arabes et asiatiques – des personnages très caricaturés par le carnaval brésilien. Presque tous ses « rivaux » dans le film sont à son service et travaillent pour lui faire plaisir, pour le servir et le rendre heureux. Les deux malandros sont les serveurs, la secrétaire est une danseuse, Oscarito joue un enfant et le batteur du groupe de musiciens est l’assistant du réalisateur/producteur. En sortant du restaurant, après avoir humilié le producteur Cécil B. De Milho, le portier du restaurant, il se dirige vers sa belle voiture. En y rentrant, la réalité le rattrape. Quand il touche les La carnavalisation le monde à l’envers 248 épaules du chauffeur afin d’indiquer sa destination, celui-ci se retourne et il découvre effrayé son propre visage d’ouvrier exploité. Nous ne rentrerons pas dans les aspects psychologiques de ce rêve qui carnavalise la vie du comte en renversant les rôles des personnages et qui sert, à lui tout seul, de métaphore au procédé carnavalisant des chanchadas, où le subalterne devient un personnage surpuissant, tandis que les maîtres deviennent des subalternes ; où le rêve cinématographique corrige par l’utopie carnavalesque la réalité insatisfaite des pauvres. Cette inversion est d’autant plus originale et intéressante qu’au Brésil le carnaval ne provoque pas vraiment d’inversion de l’ordre, comme dans d’autres carnavals. Le pauvre ne s’y habille pas comme un riche et vice-versa. Ce qu’il y a, c’est une suspension critique de l’ordre dominant et une inversion des rôles sociaux. Le grand et intouchable politique devient un prisonnier, la prude et pudique jeune fille devient une marchande de sourires, la femme facile devient une nonne et, plus important, le segment social le plus marginalisé de la société, les pauvres et Noirs des favelas, deviennent les maîtres du carnaval. Pendant les jours de la fête, ils quittent la marge où ils sont constamment surveillés par les forces de sécurité d’un État qui les écrase et les opprime pour envahir le centre sous la protection des bourreaux et les applaudissements des maîtres. Le carnaval est aussi une fête hiérarchisée avec ses différents bals plus ou moins aristocratiques, ce qui fait que l’ordre n’est pas vraiment inversé. Mais le carnaval principal, celui de la rue – que la violence a fait disparaître pendant quelque temps, mais qui semble renaître ces dernières années -, est un carnaval égalitaire, où les différences sociales et raciales sont plus ou moins abolies, dissimulées par les masques et les déguisements, tandis que les races se mélangent de façon quasiment harmonieuse, proche du rêve d’une démocratie raciale. Le carnaval est une grande utopie populaire. C’est cette utopie que les chanchadas ont récupérée en la transformant en forme narrative et discours de leurs films. Dans ces comédies, musicales ou non, le monde réel des classes subalternes est mis à l’envers, corrigé et réinventé, tandis que les pauvres, sujet de ces films, ont un peu plus d’espace dans une société qui les marginalise dans le quotidien. Comme le suggère l’article « Entertainment and utopia377», de Richard Dyer, ces comédies musicales corrigeraient une réalité insatisfaisante en proposant aux plus démunis une solution utopique à leurs manques, besoins et nécessités. Comme dans le cas de certains mythes, les chanchadas essayaient de solutionner à leur façon les incohérences de la société, faisant apparaître à l’écran ce qu’elle essayait de refouler.
Les parodies
Les parodies ont toujours été présentes au sein de la production culturelle brésilienne. Du théâtre de revue au Modernisme, de la musique populaire au cinéma, du cirque au carnaval, en passant par les chanchadas et les pornochanchadas, le discours parodique a toujours inspiré les créateurs et les arts brésiliens dans le but d’abord de faire rire, de se moquer, de critiquer, mais aussi parfois de rendre hommage. Souvent confondues avec la satire, les parodies constituent un dialogue ambivalent de valorisation et de critique avec une œuvre source dont elle essaye de déformer le sens de façon plus ou moins ironique. Il ne s’agi pas forcément de copier ou reproduire l’œuvre de référence, mais de chercher à souligner ce qui, dans cette dernière, pose problème. Ou encore, comme dans le cas des chanchadas, de ricaner d’un modèle de production qui serait inadapté à la réalité brésilienne. Au surplus, quelques-unes des grandes carnavalisations dans les chanchadas arrivent par le biais des parodies de la culture et du cinéma dominants. Les parodies ont procuré une forme de dialogue entre la culture populaire et la culture dominante, entre le cinéma brésilien, qui cherchait son identité, et d’autres cinématographies, notamment l’américaine qui était aussi la dominante. On partait d’un modèle cinématographique établi et on l’adaptait à la réalité locale dans un jeu ambivalent de reconnaissance des mérites, mais aussi de critique. Somme toute, comme l’avait si bien écrit Carlos Estevam, l’un des idéalisateurs dans les années 1960 des CPCs, les Centres Populaires de Culture : « C’est fondamental pour le développement de la culture populaire qu’elle se constitue par les moyens d’appropriation les plus variées et d’origines les plus diverses. Elle doit s’approprier des biens créés par la culture aliénée, aussi nationale qu’internationale ; elle doit incorporer comme s’ils lui appartenaient, des produits originaux de la culture non aliénée et non aliénante de la même façon qu’elle a aussi besoin d’assimiler organiquement toute la richissime gamme de valeurs culturelles qui a sa source dans la vie concrète du peuple lui-même. Au contraire de ce qui est proclamé de manière insistante par les critiques renommés, mais liés à l’avant-garde culturelle, il n’est pas essentiel que les manifestations de la culture populaire soient originelles383 ». Même si le jeune sociologue marxiste parle de la culture populaire révolutionnaire, celle faite pour et non pas par les pauvres, nous pouvons affirmer que les chanchadas semblent avoir suivi ces consignes-là au pied de la lettre. Mais à une différence près, étant donné le postulat de valorisation quasiment manichéen de la culture populaire prédominante dans ces films, que le dialogue tournait en dérision ou ridiculisait les autres cultures auxquelles les films se réfèrent. En réalité, ces parodies constituent une sorte »d’anthropophagisation » des autres cultures. Comme l’avait recommandé le Manifeste aAnthropophage d’Oswald de Andrade, ces films triturent la culture d’élite ou le cinéma américain jusqu’à les rendre populaires et nationaux. Cette popularisation des alter-cultures sert au propos d’un cinéma brésilien entièrement appuyé sur la culture populaire. Mais que signifie le terme parodie ? Selon le Dictionnaire des genres et notions littéraires, « la parodie désigne une œuvre littéraire ou artistique qui transforme une œuvre préexistante de façon comique, ludique ou satirique384», c’est nous qui soulignons pour bien marquer la notion de dialogue avec une autre création et pour expliquer que c’est justement cette antériorité qui crée une certaine ambiguïté dans l’intention des parodies. D’ailleurs, comme nous allons le voir, dans les parodies des chanchadas, la ligne qui sépare la critique de la consécration ou de l’hommage au modèle est très mince.
Un cinéma brésilien et populaire
Dans les années 1950, il y avait deux manières très différentes, complètement antagoniques, de faire du cinéma. L’une, un peu élitiste, qui cherchait à utiliser le cinéma américain comme modèle de productions chères et bien soignées totalement éloignées du cinéma comique et léger. Et l’autre, totalement opposée, qui faisait du cinéma divertissant et bon marché, avec une forte invocation populaire, le modèle d’un cinéma typiquement brésilien s’appuyant amplement sur la représentation de la culture populaire. Selon Mônica Rugais Bastos : « Ces deux courants dialoguaient à l’écran, représentant la position de leurs compagnies. Celles qui suivaient le modèle hollywoodien mettaient de l’emphase sur les recours techniques spéciaux et les dialogues élaborés, en cherchant des thèmes universels ; les autres créaient une formule nationale à succès, s’appuyant sur des dialogues directs, des jeux de mots et des situations comiques. Aucune des deux tendances ne discutait de la finalité du cinéma, la condition requise pour le maintien du système ou son insertion dans l’univers culturel comme forme d’expression artistique. Quelques entrepreneurs, tels que Humberto Mauro, pendant les années 30, et Franco Zampari, pendant les 50, fondèrent des entreprises avec la ferme intention de faire des films de qualité internationale. Cela signifiait produire des scénarios avec peu de références locales. L’intrigue devait 259 réveiller l’intérêt global d’un large public, abordant des thématiques universelles et utilisant les techniques les plus actualisées possibles 393 ». Ces deux propositions et styles différents de cinéma – qui cherchaient une identité pour le cinéma brésilien – opposèrent l’Atlântida Empresa Cinematográfica do Brasil – carioca, appuyant ses films sur le carnaval, la musique populaire, les vedettes de la radio et sur un système comprenant le trépied production, tournée vers le marché interne, distribution et exploitation – à la Compagnia Cinematográfica Vera Cruz – compagnie fondée et financée par les industriels de São Paulo qui, en envisageant de façonner un cinéma sérieux et industrialisé dont le modèle était le cinéma américain, ont importé des techniciens étrangers394 placés sous la direction du grand cinéaste brésilien Alberto Cavalcanti, qui résidait à l’étranger depuis longtemps. Ces films visaient surtout le marché international. La compagnie Vera Cruz est apparue à São Paulo dans un moment de véritable profusion culturelle où la bourgeoisie de l’état était décidée à investir dans la culture d’élite au détriment de la culture populaire ou périphérique. Dans un court laps de temps, la ville a vu apparaître deux musées – le Museu de Arte (1947) et le Museu de Arte Moderna (MAM-SP, 1948) -, une grande compagnie dédiée au théâtre bourgeois (le TBC, Théâtre Brésilien de Comédie, 1948), la fondation d’une filmothèque (1948), base de la future cinémathèque, et la création d’une biennale d’art contemporain (1951)395. Le fait que le cinéma était à la fois art et industrie venait à propos pour cette bourgeoisie assoiffée de culture savante aux desseins « mazombistes » et civilisateurs. Malgré toute cette effervescence culturelle dans un intervalle d’environ quatre ans, Maria Rita Galvão pense que la simultanéité de tous ces événements culturels ne configurent pas un mouvement, quand bien même ils avaient l’intention de répandre une vision du monde des classes dominantes de São Paulo et de restaurer, par l’art, l’hégémonie politique et économique perdue avec l’avènement de l’État centralisateur et entrepreneur survenu avec la Révolution de 1930 396 . Toutefois, le rêve d’une industrie cinématographique brésilienne de la bourgeoisie de São Paulo, totalement opposée au cinéma populaire qui se réalisait à Rio, n’a duré que cinq ans, de novembre 1949 à 1954. Nous y reviendrons dans la partie suivante. Ici, nous nous intéressons plutôt au genre de cinéma avancé par la Vera Cruz en ce qu’il s’opposait à celui défendu par l’Atlântida. Citons un long extrait d’un texte de Randal Johnson où il explique de façon limpide les principales raisons de cette débâcle : « La Vera Cruz a tenté de créer une Hollywood au Brésil sans une connaissance profonde de la réalité de la commercialisation des films dans le pays. L’entreprise s’est préoccupée de la production de films dont les coûts étaient bien plus élevés que ceux du film brésilien moyen, et n’a pas pris en considération le fait que pour s’établir comme une industrie cinématographique elle devait se préoccuper aussi de la distribution et de l’exploitation. Tout cinéma national, y compris le nord-américain, s’appuie principalement sur le marché interne. La Vera Cruz a essayé de conquérir le marché international sans avoir une base solide sur le marché interne. Tout bêtement, elle a laissé la distribution de ses films dans les mains de la Columbia Pictures, qui était intéressée, dans un marché déjà dominé par par les films nord-américains, à promouvoir ses propres films. Dit autrement, La Vera Cruz fut une tentative d’industrialiser le cinéma brésilien sans prendre en considération la réalité économique de ce cinéma. Liés à la bourgeoisie de São Paulo, les films de la Vera Cruz reflétaient des valeurs de classe qui seraient balayés par le cinéma novo… ».