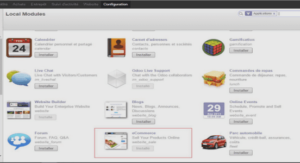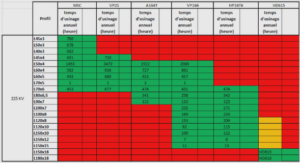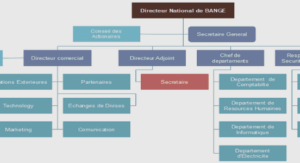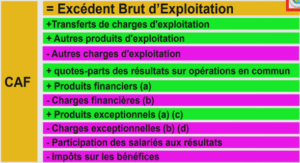La capacité à investir dépend, en premier lieu, du système bancaire en place et du système de crédit. Comprendre et mieux cerner de situation de l’investissement national implique l’examen du système bancaire, avec à sa tête la Banque Centrale. La banque centrale est une émanation du pouvoir monétaire d’un Etat ou d’un groupement économique de pays. On parle dans ce dernier cas de la Banque Centrale Européenne (BCE) qui gère l’euro ayant cours légal dans les différents pays membres de la CEE : France, Grande Bretagne, Grèce,… Mais encore, chaque pays a sa propre banque centrale qui gère, cette fois, leur monnaie nationale. A chaque monnaie correspond donc, en principe, une banque centrale émettrice et gérante. L’étude de cette institution doit alors se faire avec celle de la monnaie dont elle a la charge de gérer ainsi que les impacts économiques de ses agissements.
Toute croissance doit être précédée d’une hausse, en termes de qualité et de quantité, de la productivité, et soutenue par de multiples investissements. A Madagascar, le niveau de l’investissement demeure encore assez faible pour permettre à l’économie de s’épanouir. Durant les cinq dernières années, les hausses annuelles des crédits accordés, en valeur, par les banques restent faibles, fluctuant entre 5 et 7%, pour diverses raisons ; et ce, malgré le nombre toujours croissant d’établissements financiers, banques et institutions de microfinances sur tout le territoire (plus de 44). Ce fait est majeur et constitue à la fois une cause et une conséquence de la récession économique que le pays est en train de subir. D’ailleurs, essoufflée entre deux crises sociopolitiques successives, dont la dernière persiste, l’économie souffre encore d’une incapacité à se mobiliser. Les IDE, et les activités économiques en général, sont en baisse depuis l’année 2009 à cause de la crise sociopolitique récente.
La Monnaie
Je tiens à rappeler l’importance de cette première analyse. Une banque centrale est une banque qui détient le monopole de l’émission des monnaies nationales, celles dont elle a la charge de gérer. La frontière entre l’étude de ses deux institutions (Banque Centrale et Monnaie) paraît floue. Par ailleurs, le concept de monnaie est vaste allant de son origine jusqu’à ses fonctions, à travers l’évolution de sa forme dans le temps et dans l’espace. L’évolution de la forme de la monnaie est le produit du développement de la production et des échanges.
Origine et Concept de la monnaie
Historique
La monnaie n’a pas toujours existé. Le système de troc apparait comme une période de gestation de la monnaie. Depuis son apparition, la forme monnaie de la valeur évoluait parallèlement aux développements de la production et des échanges dans la société.
Le système de troc
Dans les sociétés primitives, les individus ignoraient encore la monnaie. Dans ce système de troc, ils échangent directement un bien contre un autre en fonction de leur besoin. Suivant l’évolution de la société, la forme valeur a pu passer de sa forme la plus simple à sa forme générale.
Forme simple de la valeur :
Dans cette forme, la valeur d’une marchandise est exprimée en une autre marchandise dont l’utilité est, en principe, différente de la première. Cette expression de la valeur d’un bien en un autre peut se faire dans une certaine proportion.
Elle peut s’écrire, par exemple : une hache = 3kg de blé.
A cette époque, l’échange avait un caractère fortuit et accidentel, comme un acte culturel même. Pour qu’il ait lieu, il fallait précisément que deux besoins réciproques trouvent satisfaction en même temps, dans un même endroit.
Forme totale ou développée de la valeur :
Et la société évoluait. La première grande division de travail apparaissait. Les gens commençaient à s’intéresser un peu plus aux échanges. De ces faits, les éleveurs amélioraient leur élevage pour les échanger contre les produits agricoles, dont ils ont besoin. Les agriculteurs font la même chose avec leur récolte.
L’échange devenait plus régulier. Si, dans sa forme simple, la valeur d’une hache est uniquement exprimée dans celle du blé, cette fois elle peut être exprimée dans la valeur d’usage de quelques biens. A ce stade de développement, la forme valeur a atteint sa forme totale ou développée.
Elle peut s’écrire par exemple : 1 chèvre = {5m de toile ; 1 couteau ; 2kg de blé} .
Forme générale de valeur :
Et la société évoluait encore. La division de travail s’approfondissait davantage, et se généralisait. Aussi, la production se développait. Le troc, ou l’échange direct d’une marchandise contre un autre, faisait obstacle à ce développement impulsif des échanges.
De plus en plus, en effet, la coïncidence des besoins se faisait rare. Le possesseur de la hache (A) s’oppose à l’échange avec le propriétaire du sac de café (B) car il cherche, non pas de café mais du riz. L’obstacle est surmonté lorsque A trouve un échange de sa hache contre une marchandise normalisée et plus souvent acceptée et/ou recherchée par tous les échangistes, ou du moins par la plupart, le sel par exemple.
Progressivement, l’échange direct disparait ; et il apparait quelques marchandises contre lesquelles on peut échanger presque toutes les autres marchandises. La valeur a atteint sa forme générale.
Elle peut s’écrire, par exemple : 1 chèvre = 30 kg de riz
Ou 10m de soie
Ou 15 haches
Ou 3g d’or
L’évolution de la forme de la monnaie
La forme première de la monnaie fut l’or. Suivant le développement de la société ainsi que celui de la production et de l’échange, la monnaie a pris des formes de plus en plus complexes et évoluées : de l’or et de l’argent à la monnaie électronique.
Forme monnaie de la valeur :
Dans la forme générale de la valeur développée précédemment, la marchandise qui servait le plus souvent dans les échanges (bétails, sel, ou fourrures,… selon les lieux) jouait le rôle d’équivalent général.
Et la société évoluait toujours. La production marchande se développait jusqu’à un stade plus avancé encore. L’existence de marchandise d’espèces différentes d’un lieu à un autre jouant le rôle d’équivalent général devenait un obstacle au développement des échanges. Cette contradiction était résolue en adoptant un équivalent général unique, dont l’echangeabilité est immédiate et universelle. En plus cet équivalent unique devait avoir une forme naturelle et une certaine valeur (assez rare). Par ailleurs, il ne doit pas être facilement frappé d’usures. Ces caractéristiques correspondent à celles des métaux précieux ; et finalement, ce fut l’or qui joua le rôle d’équivalent général. On peut alors parler de prix qui est l’expression en quantité (poids ou pièces) d’or de la valeur d’une marchandise.
La forme monnaie de la valeur peut s’écrire :
30 kg de riz = 3 pièces d’or
Ou 10m de soie
Ou 1l de huile de soja…
Le billet de banque :
Jusqu’au début du XIXe Siècle, l’or et l’argent constituaient pratiquement la masse monétaire. Puis, l’ère du machinisme arrivait. Les productions d’or et d’argent n’arrivaient plus à suivre l’accroissement de la production industrielle. Découvertes techniques et développement économique risquent d’être compromis par cette insuffisance de moyens de paiement disponibles. Les banques commencèrent alors à créer des « billets aux porteurs » représentatifs des espèces métalliques en dépôts et à les faire circuler à la demande des entrepreneurs. Tandis qu’elles gardent dans leur encaisse une quantité suffisante en ces espèces afin de répondre aux éventuelles demandes de remboursement : le billet de banque était né. Mais avec la révolution industrielle, l’abus de cette création de billet de banque risquait de nuire à l’économie et poser de graves problèmes sociaux. Progressivement, l’émission fut règlementée et confiée à un Institut d’Emission ou la Banque Centrale.
Introduction |