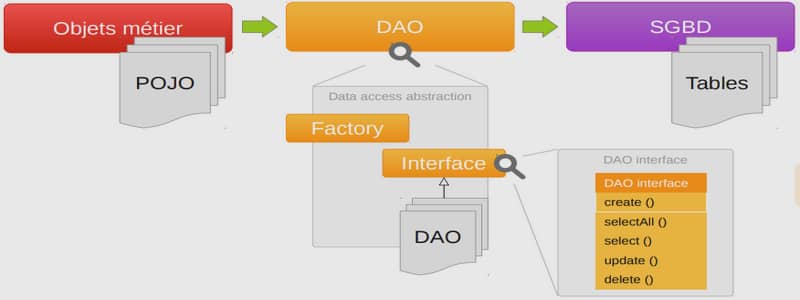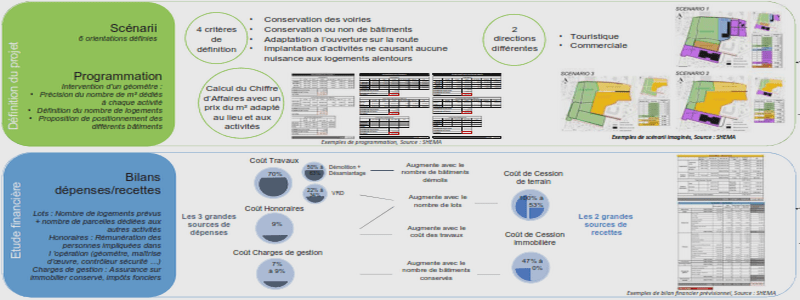Les petites
S ABA, sur le pas de la porte, me fixe de son regard de sorcière. Elle se méfie de moi. Elle risque sa réputation si je ne donne pas satisfaction à mon mari. Son business pourrait pâtir de mon attitude. Payée rubis sur l’ongle – je l’ai entendu dire par une des femmes hier soir –, ma tante voudrait qu’Ahmed n’ait plus à se plaindre de moi. Cette nuit, je leur ai donné du fil à retordre. Je la connais assez pour deviner qu’elle a dû garantir que ça ne se produirait plus, qu’à l’avenir je serais docile. Elle m’a parlé tout à l’heure. Je devrais dire « menacer ». Si je ne suis pas sage, mon mari me renverra ici et je le paierai, cher. Quand elle dit ça, moi, il faut que je baisse les yeux. Si j’ose la regarder, elle me claque. À la fin de son discours, je dois dire oui, que j’ai compris.
Je monte dans la voiture, sans bagage. Rien à emporter avec moi. Je ne possède rien. Même ma peau n’est pas à moi. Je sens les yeux de Saba sur moi. Elle vérifie qu’elle se débarrasse bien de moi, que je suis en train d’embarquer, ficelée par ses ordres. Les voisins assistent à mon départ. Les femmes, accroupies, en train de piler, ont levé les yeux et me suivent du regard.
Assise à l’arrière de la voiture, je vois défiler les maisons, les mobylettes, les enfants qui courent, la ville. Nous roulons doucement à cause des charrettes. Bientôt nous sommes dans la rue où se trouve la case de mes parents. Ma mère, devant, avec ses nattes qu’elle s’apprête à vendre au marché. Elle porte un boubou vert et sur la tête son fichu rose, mon préféré. Malgré sa joue balafrée, je la trouve jolie, ma mère. Son regard est si parlant. On y lit de la douceur, de la souffrance, de la bienveillance.
Elle a le temps de me voir, quelques secondes, je le remarque à son expression. Pas de larmes, pas de cri. Stoïque, elle laisse la voiture la dépasser. Aucun son n’est sorti de sa bouche. Elle demeure figée devant la maison, je la vois par la vitre arrière, je regarde le plus longtemps possible les taches de couleur. L’essentiel, ma mère, Nafissa, le tait. On se passe de mots pour être complices. On se comprend toutes les deux, elle m’aime. Mais elle ne peut pas empêcher ce qui m’arrive. Ici, au Village, elle n’a pas les armes appropriées pour me défendre face à ma tante et son frère, mon père. Originaire du sud du pays, maman, ici, reste une étrangère. Avant mon père, elle a eu un autre mari. Quand elle est arrivée dans la région, elle avait avec elle une fille et un peu de bien, trois poulets et quatre vaches. Avec ce qu’elle tisse, ces tapis locaux qu’elle propose au marché, elle gagne un peu d’argent. Elle se montre courageuse, ma mère. Ses journées sont harassantes tant elle se charge de mille et une choses. C’est elle qui est levée la première pour puiser de l’eau et piler le mil destiné à toute la famille. Ensuite, dans les champs, elle laboure avant de nourrir ses animaux, les vaches, les moutons, une chèvre, quelques poules. Le soir, il faut encore traire les vaches et la chèvre pour échanger le lait contre du mil. Tout cela en plus du tissage et du marché auquel elle se rend dès qu’elle peut. La vie de ma mère se compare à celle d’une bête de somme, laborieuse et soumise.
Face à son mari, et surtout à ma tante, elle se laisse dominer. Comme on doit l’être ici, surtout lorsque l’on vient d’ailleurs et que l’on a déjà été mariée. Elle admet ce qu’on lui impose, ce qu’elle n’a pas le pouvoir de contrer. Elle souffre en silence. Et jamais ne pleure. Quand la douleur devient insupportable à l’intérieur, elle prie, elle chante. Les sons coulent dans l’espace comme des larmes et voilent ses yeux d’une brume subtile.
Quand, le jour de mes un an, il a été décidé que je partais chez Saba, ma mère n’a pas eu son mot à dire. On m’a arrachée à son sein, on a estimé que j’étais sevrée, que je n’avais plus besoin d’elle. Elle a dû, comme aujourd’hui, demeurer dans le silence, et me regarder partir accrochée dans un pagne au dos de Saba, le cœur gros et l’inquiétude immense. Ils n’ont pas dit pourquoi et j’étais trop petite pour comprendre. Ça ne m’a pas plu mais j’ai fait comme ma mère : j’ai obéi. Et, rapidement, j’ai grandi.
C’est mon père qui m’avait promise à sa sœur quand elle a su qu’elle était stérile. Avant même ma naissance, je lui appartenais puisqu’elle m’avait réservée. Le jour de mon baptême, sept jours après que ma mère eut accouché, mon père aurait dit à Saba : « Mon enfant est ton enfant, même si tu l’égorges, je ne te le reprocherai pas. » Elle souhaitait, de préférence, une fille, pour se faire aider et pour mieux la livrer en pâture contre de l’argent. En fait, elle ne m’a pas adoptée, elle m’a prise dans son élevage. Elle n’a pas prévu de m’éduquer, de me nourrir, et de m’apprendre à être heureuse mais de me dresser, me mater, me préparer à être vendue. Je ne suis qu’une parmi une dizaine de femelles dans sa maison close. Des plus âgées, déjà prostituées, et des petites comme moi. Ma tante nous donne quand même à manger car il n’est pas question que nous soyons décharnées. Sinon, nous serions invendables.
Moi, chez elle, j’ai cessé de manger. Le menu, il est vrai, n’était pas très appétissant. Du thé au lait avec du pain le matin, des sardines avec du pain le midi et, le soir, de la pâte de manioc avec quelques maigres morceaux de viande. Mais les aliments ne sont pas le problème. Le problème, c’est de m’alimenter. Dès six ans, je n’ai plus voulu me nourrir. Je préférais mourir. Ça n’a pas échappé à Saba et ça l’a énervée. Elle a pris des mesures, radicales. Le gavage. Comme une oie. Elle s’asseyait sur une chaise, me coinçait la tête entre ses cuisses. D’une main, elle ouvrait grand ma bouche, de l’autre, elle y fourrait, par poignées, du pain trempé dans du thé au lait. Je pleurais, ma gorge se serrant, je déglutissais de plus en plus mal. Je recrachais une partie, en absorbais difficilement une autre. Et si j’osais lever les yeux vers elle pour l’implorer d’arrêter, elle me frappait. Je les fermais pour ne pas être tentée de la regarder. Mais j’avais alors l’impression de voir la bouillie blanche dans ma gorge, j’étais d’autant plus concentrée sur ce qui s’y passait. C’était pire. Malgré ces séances de torture où Saba brisait violemment mes grèves de la faim, je m’obstinais à ne pas m’alimenter.
Elle me reproche de n’être pas comme il faut, de ne pas convenir à ce qu’elle espérait de moi. Je suis et je fais tout mal. Elle me punit très durement pour tout et n’importe quoi. Si elle m’ordonne d’aller chercher de l’eau et du savon et que, par malheur, je mets deux minutes de trop à rapporter le seau, elle s’énerve, me l’arrache des mains en me bousculant et me fait tomber en m’injuriant. Elle adore me traiter de « squelette qui a passé cent jours sous terre ». Une fois que je suis à terre, elle s’assied sur moi et me frappe tant qu’elle peut, jusqu’à ce que ses mains lui fassent mal. Alors elle va casser la branche d’un arbre pour pouvoir continuer. Elle me roue de coups, d’autant plus douloureux qu’ils sont distribués avec la baguette. Je me zèbre de rouge et pleure intensément. Mes larmes ne l’amadouent pas, au contraire, on dirait qu’elles l’excitent.
Ostensiblement, elle apprécie de me voir souffrir. Souvent, je m’abîme les orteils parce que je marche pieds nus et heurte des pierres. Une fois, pour me soigner, j’ai l’idée puérile de recouvrir le doigt de pied meurtri avec du sable et de le mettre au soleil. Or le sable que j’utilise se trouve devant les toilettes, donc plein de bactéries en tout genre. Alors, bien sûr, la blessure s’infecte et lorsque je finis par aller voir ma tante pour qu’elle résolve le problème, elle en profite pour titiller ma plaie. Elle verse dessus de l’eau bouillante avec du sel et se moque de mes hurlements. Elle insiste et me lance : « Demain aussi, fais-toi la même blessure et viens me voir, ça me fait plaisir. »
La haine de ma tante, je l’ai ressentie très fort, très vite. Souvent, elle m’appelle « la bâtarde » et insiste : « Tu n’es pas la fille de ton père, on ne sait pas d’où tu sors ! » Elle ne la précise pas mais la déduction paraît évidente : elle n’est pas ma tante. En conséquence, elle ne me doit rien, pas du bien en tout cas, pas ce qu’un lien de sang impliquerait normalement. Quand elle me jette ces mots méchants à la figure, je reste imperturbable. Je ne la crois pas. Je ressemble trop à mon père pour ne pas être sa fille. « Bâtarde » est son mot favori, mais elle dispose d’une palette étonnante de saloperies à dire. Quand il s’agit de moi, elle ne tarit pas d’insultes. Tous les jours, j’ai droit à mon lot de vilains mots censés me coller à la peau. Mais ses mots m’atteignent bien moins que ses gestes. Ses coups, ses gifles me laissent des traces, continuent de me faire mal après. S’impriment en moi comme des numéros, non de fabrication mais de destruction.
Elle me maltraite et ça me semble presque normal. Sauf qu’il y a une autre petite fille dans la maison, plus jolie, plus gentille, qu’on traite autrement. Elle n’est ni frappée, ni humiliée. Elle est plutôt traitée comme une poupée précieuse, une marchandise rare qu’il ne faut surtout pas casser. Bien sûr, je suis jalouse de Rama. Dans la comparaison, je suis perdante. Elle fait tout mieux que moi et comme elle ne subit pas ce que je subis, elle reste gentille. Un cercle vertueux en quelque sorte. Alors que moi, je me trouve dans l’autre cercle, le vicieux, celui qui m’enchaîne au mauvais sort. Saba profite de Rama pour m’enfoncer un peu plus, m’infliger d’autres tortures psychologiques.
Ma tante, par exemple, rapporte deux robes à la maison, une bleue et une rouge. Comme j’arrive la première, elle me laisse choisir. Je m’étonne qu’elle soit si bien disposée, qu’elle me donne un vêtement et qu’elle me laisse prendre ma couleur préférée. Timidement, je montre du doigt la bleue. Elle dit : « Prends-la, d’accord. » Je suis si contente que je serais presque prête à oublier tout le reste, ce que ma tante me fait de mal le reste du temps. On est simple finalement quand on est enfant. Un peu de gentillesse, un petit cadeau suffisent à effacer les empreintes fraîches. On met tant de bonne volonté à être aimé.
Alors que je suis en train de regarder, de caresser la robe avec passion, j’entends Saba qui m’appelle d’une voix tonitruante et agressive, celle qu’elle prend pour me gronder quand elle estime que j’ai fait une bêtise. Penaude, je me présente devant ma tante. L’autre petite fille pleure à côté d’elle et me regarde avec un air de peste. En fait, elle préfère, elle aussi, la bleue. Qu’elle n’a pas vue. Et, puisqu’elle est prioritaire et qu’elle fait céder ma tante à son caprice, je dois rendre la robe. Maintenant Rama sourit, c’est moi qui pleure. Dans ce revirement, Saba manifeste encore une fois sa perversité à mon égard. Elle ne manque pas d’imagination pour me brutaliser.
Ma mère me voit peu mais elle le sait, le sent. Alors dès qu’elle peut, quand elle est parvenue à économiser sur la recette du marché, elle s’invite poliment chez ma tante pour lui donner de l’argent. Elle espère ainsi amadouer un peu la sorcière, la mettre dans de meilleures dispositions à mon égard. Quand ma maman apparaît, je saute de joie. Elle m’apporte de délicieuses galettes de mil et des morceaux de sucre de canne. Je sais déjà qu’elle ne sera pas autorisée à rester longtemps, mais ça suffit pour qu’elle constate que je vais mal, que j’ai des bleus, des jaunes, des cicatrices, le regard triste et que je suis maigre comme nos chèvres. Elle a une idée précise de ce que j’endure. Comme elle ne peut pas me retirer des griffes de ma geôlière, elle lui graisse la patte pour que cette patte glisse sur moi, ne s’arrête pas, choisisse une autre trajectoire. Alors elle se sacrifie pour que je souffre moins. Une fois, elle a même vendu deux vaches pour en donner le prix à ma tante.
Mais Saba a la mémoire courte et remet du cœur à l’ouvrage de destruction dès le lendemain. L’argent gagné durement par ma mère est déjà dilapidé, l’accord tacite rompu. Je suppose que ma tante prend un certain plaisir à m’infliger des châtiments corporels. Perverse.
Comme chez elle, c’est un bordel, des gens entrent et sortent. Si je m’avise de répondre à quiconque pose une question anodine comme « Vous n’avez pas vu Untel ? », elle fait venir l’homme à la machette. De lui aussi, j’ai très peur. C’est un voisin qui me semble immense à moi qui suis petite, terrifiant aussi parce qu’il entre chez ma tante brutalement et armé d’une longue machette. Avec, les deux adultes menacent de me couper la langue parce que je parle trop. Saba me tient tandis que l’homme rapproche sa machette de mon visage pour me signifier qu’il ne plaisante pas. Je serre fort la bouche pour éviter que ma langue ne s’échappe et passe sous la lame du bourreau. Après quelques minutes de supplice, ils me relâchent. Effrayée, je ne bouge plus, ne parle plus.
La réalité ne cesse de me prouver que j’ai intérêt à garder le silence. J’ai commis l’erreur de parler à une voisine. Je me suis contentée de dire la vérité, les violences en tous genres. Sur le moment elle a fait mine de me comprendre, même de me plaindre et me consoler. En fait, elle gagnait ainsi ma confiance, m’incitait à la confidence dans l’idée de tout répéter ensuite à ma tante. Une façon pour elle de se faire bien voir par Saba la sorcière, genre de caïd local, de parrain en jupon. Cette voisine poussait même l’obligeance jusqu’à seconder ma tante au moment où, informée de mon bavardage, elle m’infligeait la punition due. Les deux harpies me battaient comme plâtre, jouissant de m’avoir prise dans leur piège, telles deux veuves noires.
J’en ressortais brisée, abîmée, et bien décidée, une bonne fois pour toutes, à me taire, pour toujours. Juré, craché, si je meurs… je suis déjà en enfer.
Avant de me vendre complètement à Ahmed, ma tante m’a vendue par petits bouts. Avec elle. Saba est réputée pour être une très belle femme qu’on recherche en tant que prostituée. Sa bouche joliment dessinée, ses yeux de biche, son petit nez pointu, et puis sa taille de guêpe et ses fesses bombées la classent dans la catégorie des très belles femmes. En plus, elle est très coquette et a l’art de se mettre en valeur avec de superbes et onéreux pagnes Wax qu’elle serre sur ses hanches. Quand elle marche dans la rue, tout le monde admire son allure impériale et le balancement de son postérieur. Aussi ma tante ne compte plus les clients ni l’argent dont de généreux donateurs la gratifient.
Outre les amants de travail, elle a épousé, par sécurité, un commerçant nanti qui a trois autres femmes. Pour chacun de ses clients, elle adapte sa tenue, elle choisit dans sa garde-robe le pagne le plus approprié à sa classe sociale, ses goûts et ses envies. Il lui arrive de se changer dix fois par jour pour correspondre aux hommes variés auxquels elle se loue. La plupart du temps, elle organise ses passes à la maison. Elle suit une sorte de rituel avant l’arrivée d’un client : elle se regarde dans le miroir sous lequel sont disposés ses crèmes et autres produits de beauté, et se parle en se souriant. En fait, elle s’entraîne à être charmante, elle répète le discours enchanteur qu’elle va tenir d’une voix sucrée au mâle.
Hormis le commerce à domicile, elle pratique aussi la livraison. Et dans ces cas-là, elle m’emmène avec elle. Elle me fait porter une jolie robe jaune qu’elle garde dans sa chambre, hors de ma portée, pour ces occasions. Et pour elle, elle élabore une tenue très sophistiquée à laquelle elle coordonne son maquillage. À la fin de ses préparatifs, elle s’enrobe dans un nuage de parfum.
Ces soirs-là, Saba et moi, on ressemble à deux poupées. Généralement, une grosse voiture nous attend dans la rue. Pendant le trajet, comme je suis petite, il m’arrive de m’endormir et de ne pas avoir envie de me réveiller devant la maison cossue du client. Une fois arrivées, nous nous séparons. Ma tante me laisse avec le gardien, garde du corps du client, et elle s’enferme avec le maître de maison. Je déteste le moment où elle me dit : « À tout à l’heure. » Je sais ce qui va se passer pour moi. J’ai l’habitude sauf que je ne m’y fais pas. Le gardien va abuser de moi, ça fait partie du programme négocié par ma tante. Je suis donnée au garde pendant qu’elle se vend à son patron. Je l’ai entendue une fois faire ses recommandations à ces hommes auxquels elle me livre sans rougir. Elle interdit qu’on me déflore, limite le périmètre d’action.
La première fois, ça m’a surprise d’accompagner ma tante et de me retrouver dans une petite maison infestée de moustiques en tête à tête avec un type. Je n’ai pas compris tout de suite ce que je faisais dans la chambre avec le monsieur et son sourire lubrique. Quand il m’a attrapée et m’a forcée à « être bien sage », là, ses intentions ont paru claires. Il m’a expliqué que je le paierais très cher si je ne faisais pas exactement ce qu’il voulait. Et ce qu’il voulait était dégueulasse : me toucher, partout.
Ensuite, à la fin, l’odeur âcre de la transpiration de mon violeur s’est répandue sur moi. La satisfaction inscrite sur son visage m’avait soulevé le cœur.
J’étais une faveur que Saba offrait à ses bons clients, les plus fortunés, les plus intéressants pour elle, ceux qu’il fallait câliner. Elle me présentait comme un genre de magazine à disposition pour la salle d’attente ou de friandise à volonté. La première fois avait été la plus difficile. Ensuite, consciente de ce qui m’attendait, je tentais de penser à autre chose. Je me répétais que je me vengerais. L’idée m’apportait un peu de réconfort, j’imaginais ma tante découpée en morceaux, je me figurais émasculer ces hommes qui me prenaient pour un jouet. Je me disais qu’un jour je serais plus forte, j’aurais les moyens de prendre ma revanche, de les corriger tous ces adultes qui abusaient de moi. Et ceux qui se taisaient. Les voisins qui savaient mais craignaient ma tante, les clients, ma famille qui était au courant, la ville entière aux yeux ouverts et aux bouches fermées. Personne ne me vient en aide. Je suis une petite fille, je ne peux rien faire contre une maquerelle soutenue par ses riches clients à qui le trafic de chair humaine profite d’une manière ou d’une autre. Ma tante détient le pouvoir de l’argent, avec, elle a muselé les gens qui baissent le regard quand ils me croisent. On laisse faire la sorcière, enfermer les gamines, les livrer en pâture à des hommes, les vendre, les frapper…
Quand je suis trop triste, que je n’y arrive plus, que tout est trop noir dans ma tête et mon cœur, j’attends que la nuit tombe et je sors dérouler une natte sur laquelle je m’allonge face au ciel. Je contemple les étoiles et lève la main pour caresser la lune. D’un coup, j’ai l’impression que l’univers entier me parle harmonieusement. Il interprète la chanson de ma mère : « Si tout autour de toi, les gens ne te voient pas, moi, je te vois. S’ils ne t’aiment pas, moi, je t’aime. S’ils ne t’aiment pas, toi aime-les. S’ils ne te voient pas, toi vois-les. S’ils ne t’écoutent pas, écoute-les. S’ils ne te donnent pas, toi donne-leur. Et s’ils ne te pardonnent pas, toi pardonne-leur. »
Trente ans plus tard, rien n’a changé. Je suis grande aujourd’hui, adulte. J’ai prié, appelé le courage et je suis retournée voir Saba. Dans la maison et ses souvenirs au goût de sang, j’ai filmé ce que j’ai vu. Et ce que j’ai vu m’a déplu. Des femmes oisives en attente de clients, et une fillette de quatre ans attachée comme un chien par la cheville. Avec une laisse trop courte pour qu’elle puisse se tenir debout. On aurait dit qu’elle n’était plus humaine. Elle m’est même apparue comme une chose rampante et triste. Le lien en tissu paraissait si serré qu’il lui coupait la circulation de la jambe.
J’ai pris à parti ma tante, je l’ai interrogée, j’ai voulu savoir pourquoi elle l’avait attachée. Elle m’a donné une réponse peu satisfaisante, celle que je pouvais prévoir. Soi-disant, la petite fille n’était pas sage. Il valait mieux l’enchaîner, c’était plus prudent. Ma tante prétextait qu’elle n’avait pas le temps de veiller sur cette gosse dissipée. N’est-ce pas le propre d’un enfant que d’être agité ? L’image me fait mal, me donne envie de la tuer. Je maîtrise ma rage et je délivre plutôt la petite. Je dénoue le tissu, frotte la petite cheville et l’embrasse. Je dis : « C’est fini, c’est fini. » Pourtant, elle grogne, elle ne paraît pas contente d’être libérée. Elle me demande de lui remettre la corde au pied, elle pleurniche. Je suis sidérée qu’elle ne veuille pas de sa liberté. À sa place, dans cette même pièce, moi je rêvais de m’en aller, qu’on vienne me délivrer. Je priais pour qu’on me kidnappe et qu’on me rende ensuite ma liberté. Mais je n’ai pas été exaucée. C’est Ahmed qui est venu.
Tel père, tel homme
M ON MARI m’a emmenée avec lui. Pour que je puisse prendre l’avion, pour lui éviter d’avoir à prendre la route, ma tante s’est occupée de me faire faire un passeport. Ses relations avec certaines personnes de la ville ont dû lui permettre de l’avoir vite, à un prix raisonnable. Je l’ai entendue évoquer le sujet avant mon mariage et à ce moment-là, je n’ai pas compris pourquoi elle cherchait à m’obtenir des papiers d’identité. Au Village, je n’en avais pas besoin, mon prénom était connu de tous et je ne voyageais pas si ce n’est entre chez mes parents et ma tante, sur de courtes distances donc. Là, c’est à l’étranger que j’allais, chez Ahmed, dans sa ville. Loin de chez moi. En scrutant les nuages à travers le hublot, je tentais de me consoler en me disant que le pire était déjà derrière moi, qu’Ahmed ne pourrait surpasser ma tante en matière de tortures diverses, que j’avais déjà enduré l’insupportable. Alors, maintenant, j’étais apte au pire.
Un profil d’aigle, un visage dur, un regard bien noir, Ahmed n’inspire pas confiance. Il y a quelque chose en lui de mécanique, une raideur et une froideur qui m’inquiètent. Il reste muet. Moi aussi. Dans le silence qui nous unit pèsent les images de la nuit de noces et celles à venir, qui seront tout aussi laides. Je ne me fais aucune illusion. À mon âge, normalement, on ne se nourrit que d’illusions, de rêves fous et romantiques. On chuchote le prénom du fiancé sur lequel on fantasme ou on dessine la tête du garçon idéal, celui qui est fait pour nous. J’ai onze ans et mes songes ont déjà séché sur la corde de la réalité.
Pas de prince charmant virtuel pour moi mais un mari violent, concret, armé. Et énervé d’avoir récupéré une bête sauvage alors qu’il avait commandé un animal domestique. J’ai remarqué qu’il me surveillait du coin de l’œil. Il s’attend à me voir m’échapper et grimper de nouveau dans un arbre. Mais moi, je suis trop abattue et fourbue, atteinte par ce que j’ai subi la nuit dernière, pour tenter quoi que ce soit. Je m’efforce d’obéir, je le suis sans broncher.
Là où il vit, une grande maison sur plusieurs étages, il a installé ses femmes. Chacune dispose d’un appartement, de sa partie à elle. En évitant la promiscuité, le maître du harem limite la rébellion et les conflits. Les épouses se connaissent mais se fréquentent peu. Quand j’arrive, elles sont au nombre de trois et semblent, à première vue, contentes de leur sort.
Je dois avouer qu’ici, c’est bien plus confortable que chez ma tante, luxueux même. Une salle de bains, une chambre et un grand salon avec de belles frises dans les tons de vert et bleu, et puis de larges canapés beiges avec des motifs, des banquettes orientales. Mais ce qui m’émerveille le plus, ce sont les rideaux, dorés. Je n’ai jamais vu ça. Nous sommes bien logées et bien nourries aussi. Alors les autres estiment que c’est suffisant. Comme moi, elles viennent de pays affamés. Chez elles, elles ont vécu la misère ! Pour ne pas manquer, elles sont prêtes à tout, n’importe quelle situation plutôt que la pauvreté. Elles s’estiment chanceuses d’appartenir à un seul homme, à l’abri de la rue. Ici, elles ne sont pas forcées de travailler, au contraire, il leur est interdit de mener une activité quelle qu’elle soit.
Ahmed a établi la liste des règles en vigueur dans sa maison. Écrites nulle part, à moi de les retenir afin de ne pas les transgresser bêtement, par oubli. En fait, nous n’avons aucun droit et surtout pas celui de sortir. Il faut rester à l’intérieur, s’occuper toute la journée comme on peut et attendre, le soir, le retour du patron. Moi, je ne l’attends pas, je voudrais au contraire qu’il ne rentre pas ou fatigué, incapable de me faire du mal. Je croise les doigts pour qu’il ne me choisisse pas, qu’il opte pour les femmes à côté qui, elles, se sont faites belles, s’enorgueillissent de le chérir quand moi je m’obstine à le haïr.
En tant que dernière recrue, j’ai malheureusement l’honneur d’être la favorite. La résistance que je lui oppose, peut-être, l’excite. Le soir, Ahmed se montre souvent dans mon studio. Comme j’essaie de me dérober à ses envies, il s’énerve. Il commence par me menacer, ensuite, il passe aux actes. La violence ne l’effraie pas, il s’y engouffre naturellement. Il finit toujours par me dominer. Pourtant, je ne cesse de lutter. À chaque assaut, je me cabre, je rue pour que mon mari ne me ligote pas. Saba lui a indiqué la façon de me contrôler, de faire de moi une gamine docile : les liens. Quand il m’attrape, réfugiée dans un coin de l’appartement, il entrave mes pieds et mes mains avec des foulards. Il fait des nœuds étroits qui ne me laissent aucune chance de me dégager. Une fois les garrots posés, je suis à sa merci. Pour m’empêcher de rouler ou de me cambrer, il me bloque avec ses genoux qu’il enfonce dans mes cuisses jusqu’à me faire hurler. Avec la pointe de ses coudes aussi, il me fait mal au ventre, à la gorge, il m’asphyxie. J’étouffe sous ses prises.
Parfois, quand il peine à me mettre la main dessus, il utilise ses chaussures. Il m’en lance une, dans le visage en priorité, et prend l’autre pour me frapper. Un de ses jeux de prédilection, c’est celui du fil électrique. Il me fouette avec, attachée ou pas. Si je suis loin, il s’en sert comme d’un lasso, et quand je suis soumise, il me tape avec. Un jour, j’ai entendu dire que pour dresser les animaux, il ne fallait pas utiliser sa main directement mais des ustensiles, baguettes, fouets, bâtons… pour garder une distance, leur enseigner le respect du maître. Instinctivement, Ahmed suit cette technique. Pour me réduire, m’apprendre à n’être rien, à obéir à ses désirs qui sont des ordres. Il est l’homme de la maison, il est l’homme, l’autorité suprême, presque l’égal de Dieu. D’ailleurs, il a le pouvoir de vie et de mort sur moi.