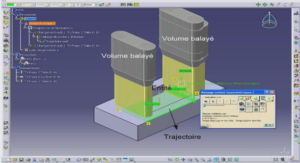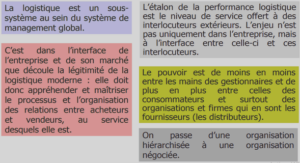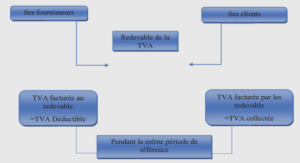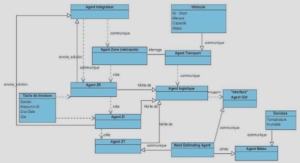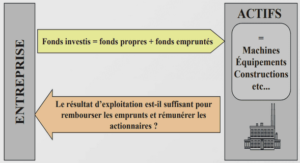Cadre théorique : introduction à la géographie du droit
Depuis une vingtaine d’années dans le monde anglo-saxon et plus récemment dans le monde francophone est apparue une géographie du droit, visant à développer les complémentarités et l’interdisciplinarité entre la géographie et le droit. Selon Belaidi et Koubi (2015 : 2-3), afin d’effectuer le lien entre ces deux disciplines, il conviendrait d’examiner la relation entre le droit et l’espace/territoire. Pour Azuela et al. (2015 : 2-3) le cadre juridique agirait en tant que langage, étant interprété par divers acteurs et localisé géographiquement. Selon ce dernier, l’interprétation du droit par les différents protagonistes dépendrait de son passage du virtuel (une norme juridique, un texte de loi en tant que tel) au réel (la localisation de la loi) (Azuela et al., 2015 : 8). Effectivement, les normes juridiques s’interprèteraient en fonction de leur localisation sur un territoire dans lequel reposent plusieurs systèmes : sociaux, économiques, politiques, écologiques. Ainsi, la géographie contribuerait à l’interprétation du droit tandis que le droit contribuerait à la construction et à la définition de nouveaux espaces (par la fixation d’une norme sur un certain terrain). Ces espaces de différentes natures, passant d’une portion de territoire à une zone d’intervention, seraient créés en fonction du champ d’application des politiques gouvernementales ou des revendications de la société civile : zone de sécurité, zone urbaine sensible, etc. (Koubi, 2015 : 2-7).
Selon Forest (2015 : 1), afin de faire le lien entre la géographie et le droit, il conviendrait d’opter pour « une approche croisée qui intégrerait les savoirs, les méthodes et les théories propres aux deux disciplines. » Ce dernier a mis en garde les chercheurs contre quelques difficultés quant aux recherches étant inscrites dans ce monde interdisciplinaire. Afin de pallier à ces obstacles, quatre principaux éléments devraient être pris en compte : a) la consultation de la littérature et la considération de la méthodologie dans les deux disciplines, b) la création de réseaux entre les chercheurs, c) la mise en évidence de l’analyse plutôt que la simple description des caractéristiques géographiques ou des différentes lois ainsi que d) la constitution d’un vocabulaire commun. Koubi a déjà suggéré quelques exemples de ce vocabulaire pouvant être propre aux deux disciplines (carte, bassin, réseau, pôle) tout en accentuant l’importance du terme « zone » (zone côtière, zone de montagne, zone sensible, zone de défense, etc.). Selon cette dernière, « ce terme est assorti de constructions juridiques qui réaménagent le rapport aux territoires et aux espaces pour nombre d’actions publiques » (Koubi, 2015 : 5).
Finalement, Forest a suggéré que l’émergence d’une géographie du droit est possible, mais nécessiterait davantage de pratique et devrait se développer là où des points communs existent. Il pourrait s’agir de concepts communs entre les deux disciplines comme le territoire et la frontière ou de certaines sous-divisions complémentaires du droit, comme l’aménagement du territoire, le droit de la mer, le droit international, etc. (Forest, 2015 : 2-5).
Ainsi, la géographie du droit s’est avérée utile dans l’analyse de la rhétorique des dirigeants russes concernant l’incorporation de la Crimée à la Fédération de Russie. Des documents du droit international comme la Charte fondatrice des Nations Unies (ce qu’Azuela et al. nommeraient le virtuel), ont été interprétés et localisés (devenant donc le réel) par des protagonistes lors du conflit russo-ukrainien, que ce soit par les représentants de la Fédération de Russie, de l’Ukraine ou d’autres membres de la communauté internationale. Dans ce cas-ci, cette interprétation des normes juridiques a été localisée sur deux territoires s’emboîtant : la péninsule de Crimée et l’Ukraine dans ses frontières reconnues internationalement (incluant la Crimée). De ce fait, des divergences sont nées dans les interprétations, les dirigeants russes analysant le droit international à l’échelle de la Crimée tandis que la majorité des autres acteurs de la communauté internationale l’examinent à l’échelle de l’Ukraine.
Survol du droit international et des documents des Nations Unies
Dans leur rhétorique justifiant l’incorporation de la Crimée, les dirigeants russes, principalement le président Vladimir Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l’ancien représentant permanent de la Fédération de Russie aux Nations Unies Vitali Tchourkine, ont eu recours au droit international. Leur argumentaire a fréquemment fait référence aux divers documents adoptés par les Nations Unies ou par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Parmi les documents utilisés se sont retrouvés a) la Charte fondatrice des Nations Unies de 1945, b) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, c) le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, d) la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies de 1970, e) l’Acte final d’Helsinki de 1975 et f) le mémorandum de Budapest de 1994. Trois déclarations unilatérales (Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis) effectuées devant la Cour internationale de justice concernant l’indépendance du Kosovo, événement jugé comparable par les élites russes à l’incorporation de la Crimée, ont également été mobilisées en ce qui concerne l’interprétation du droit international. Dans leur rhétorique légale, les autorités russes ont mis en relation deux principes fondateurs du droit international : le droit à l’autodétermination des peuples et l’intégrité territoriale des États. Leur objectif a été de démontrer la prédominance du droit à l’autodétermination des peuples sur l’intégrité territoriale des États dans le cas de la Crimée. En premier lieu, un survol des divers documents légaux employés dans l’argumentaire russe sera effectué en accordant une attention particulière aux deux principes mentionnés ci-haut. En second lieu, il sera question de l’interprétation de ces principes par les dirigeants de la Fédération de Russie en abordant deux éléments essentiels de leurs discours légaux : la conception des événements de l’Euromaïdan en tant que coup d’État organisé par des forces extrémistes ainsi que la représentation du référendum en Crimée comme étant légitime et en accord avec la volonté des habitants. En troisième lieu, il sera question des doubles standards occidentaux concernant le droit international en donnant comme exemple les précédents du Kosovo et de l’île Mayotte. En quatrième lieu, la diplomatie internationale en lien avec l’incorporation de la Crimée sera abordée en analysant les sessions de l’ONU et les alliances qui s’y forment entre les divers protagonistes.
La Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, mais entrée en vigueur le 24 octobre de la même année, met de l’avant les principes fondateurs de l’organisation (ONU, 2017a). Dans leurs discours, les dirigeants russes ont fait référence à l’Article 1 (Alinéa 2) et à l’Article 2 (Alinéa 4) du Chapitre 1 de la Charte. En premier lieu, concernant l’Article 1, les quatre principaux objectifs des Nations Unies sont mentionnés : maintenir la paix et la sécurité à l’international, développer des relations amicales avec les nations fondées sur l’égalité des droits et sur le droit à l’autodétermination des peuples, promouvoir la coopération internationale pour les problèmes de nature économique, sociale, culturelle ou humanitaire ainsi qu’harmoniser les actions des nations afin de réaliser les éléments précédemment mentionnés. Afin de légitimer l’incorporation de la Crimée, dans leur rhétorique, les élites russes ont abordé le second objectif qui inclut le droit à l’autodétermination : « to develop friendly relations among nations based on respect for the principles of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace » (UN, 1945 : 1). En second lieu, concernant l’Article 2, sept principes à respecter pour réaliser les objectifs de l’Article 1 sont mentionnés : l’égalité souveraine des membres, la réalisation de bonne foi des obligations liées à la Charte, la résolution pacifique des conflits, le non-usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, l’assistance aux Nations Unies pour réaliser des actions en accord avec la Charte, l’obligation de s’assurer que les États non membres agissent en conformité avec la Charte et la non-interférence dans les affaires internes des États. Afin de légitimer l’incorporation de la Crimée, les dirigeants de la Fédération de Russie ont tenté de démontrer que dans ce cas, l’autodétermination prédominerait sur l’intégrité territoriale, quatrième principe de l’Article 2 : « all Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations » (UN, 1945 : 1).
Dans la Charte des Nations Unies de 1945, la référence aux droits de l’homme est une thématique récurrente et primordiale. En 1948, afin de définir davantage ce droit, a été mise en place la Déclaration universelle des droits de l’homme. Le 16 décembre 1966, deux autres documents ont été adoptés comme compléments : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (entrée en vigueur le 23 mars 1976) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (entrée en vigueur le 3 janvier 1976). Ensemble, ces trois documents forment la Charte internationale des droits de l’homme (ONU, 2017a). Dans leurs discours, les élites russes ont fait référence à ces Pactes pour renchérir leur argumentaire concernant le droit à l’autodétermination des peuples dans le cas de la Crimée (Alinéas 1 et 3 de l’Article 1 de la Partie 1 du Pacte). Les deux Pactes abordent l’autodétermination des peuples de manière identique : « all people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development » et « the States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provision of the Charter of the United Nations » (UNGA, 1966a : 1; UNGA, 1966b : 1).
En 1970, l’Assemblée générale, principal organe décisionnaire des Nations Unies, a adopté une résolution lors de sa 25e session afin de renforcer la paix internationale et de contribuer au droit international : la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies (ONU, 2017a). Sept principes sont mentionnés : le non-usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État, le règlement pacifique des conflits, la non-intervention dans les affaires internes des États, le devoir des États de coopérer en accord avec la Charte, le droit à l’autodétermination des peuples, l’égalité souveraine des États et le respect de bonne foi des obligations énoncées dans la Charte. Dans leur argumentaire concernant la légitimité de l’incorporation de la Crimée, les autorités russes ont fait référence à cette Déclaration : les principes d’autodétermination des peuples et d’intégrité territoriale y sont davantage détaillés. En premier lieu, concernant le droit à l’autodétermination, il est inscrit : « by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all people have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter » (UNGA, 1970 : 6). Les États ont donc le devoir de promouvoir le droit à l’autodétermination conformément à la Charte afin d’assurer leur coopération et leurs relations amicales ainsi que de mettre fin au colonialisme. Ce principe implique la prise en considération de la volonté des peuples quant à leur appartenance territoriale. Afin de faire valoir le droit à l’autodétermination, quelques moyens sont suggérés tels que : l’établissement d’un État indépendant, l’intégration ou l’association à un autre État indépendant ou l’émergence d’un statut politique distinct déterminé librement par un peuple (UNGA, 1970 : 3-7). Ainsi, les États ne peuvent poser des actions contrevenant au droit à l’autodétermination, à la liberté et à l’indépendance. Par contre, l’autodétermination des peuples ne doit pas contrevenir à l’intégrité territoriale d’un État si ce dernier agit conformément à ce droit et possède un gouvernement représentant l’ensemble des peuples présents sur son territoire indépendamment de leur couleur, ethnie ou religion (UNGA, 1970 : 6-7). En second lieu, concernant l’intégrité territoriale, il est noté : « every State has the duty to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations et « every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to in the elaboration of the principle of equal rights and self-determination of their rights to self-determination and freedom and independence » (UNGA, 1970 : 3). Afin de faire valoir l’intégrité territoriale, quelques lignes directrices ont été prescrites : interdiction d’utiliser la force ou la menace contre l’intégrité territoriale d’un État, de priver les peuples de leur droit à l’autodétermination, d’organiser ou d’encourager des groupes armés afin de saisir le territoire d’un État, d’encourager ou de participer à des guerres civiles ou à des actes terroristes dans un autre État ainsi qu’occuper militairement le territoire d’un autre État. Par conséquent, toute occupation territoriale résultant de menaces ou d’usage de la force sera considérée illégale (UNGA, 1970 : 3-4).
Outre les documents des Nations Unies, dans leur argumentaire légitimant l’incorporation de la Crimée, les élites russes ont brièvement fait référence à un document de l’OSCE, soit l’Acte final d’Helsinki de 1975. Lors des sommets de cette organisation, les chefs d’État décident des priorités ainsi que de l’orientation générale à prendre pour les prochaines années. En 1975, à Helsinki, a eu lieu le premier sommet qui a mené à l’adoption du document fondateur; l’Acte final (OSCE, 2017). Dans le premier chapitre du document sont abordés dix principes : l’égalité souveraine, l’abstention de l’usage de la force, l’intangibilité des frontières, l’intégrité territoriale, le règlement pacifique des différends, la non-intervention dans les affaires internes d’un État, le respect des libertés et des droits fondamentaux de l’homme, le droit à l’autodétermination des peuples, la coopération entre les États et l’adhésion de bonne foi aux obligations découlant du droit international. Pour résumer ces principes, ils garantissent le respect de l’égalité judiciaire, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique. Ainsi, il est strictement interdit de saisir ou d’usurper un territoire ainsi que d’utiliser la force, les menaces ou l’occupation militaire contre l’intégrité territoriale d’un État. Il est également prohibé d’intervenir dans les affaires internes d’un État et d’encourager les activités terroristes visant à renverser un gouvernement. De plus, tous les habitants d’un territoire ont le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Advenant le cas où des minorités ethniques sont présentes au sein d’un territoire, elles sont égales devant la loi et leurs droits et libertés doivent être respectés. Par ailleurs, les divers peuples ont le droit à l’autodétermination, tant que cela soit conforme à la Charte des Nations Unies et respecte l’intégrité territoriale des États (OSCE, 1975 : 3-10). Ainsi, il est inscrit : « by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external interference, and to pursue as they wish their political, economic and cultural development » (OSCE, 1975 : 7).