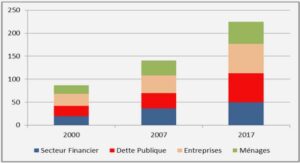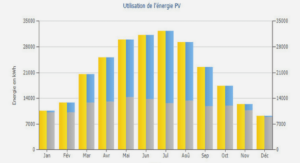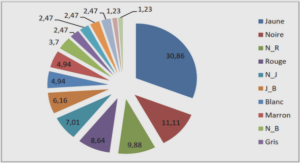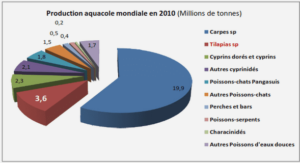LA MONDIALISATION
Dès l’empire romain, une 1ère mondialisation s’est organisée autour de la Méditerranée. Mais pour assurer la connexion entre la mise en place de cette « éco-monde » et les sociétés de la terre, il faut attendre la phase des grandes découvertes au XVe siècle.
Au XIXe siècle, entre 1870 et 1914 nait un espace mondial des échanges, qui était traduit par : des ouvertures de nouvelles routes maritimes, doublement de la flotte marchande mondiale, extension des chemins de fer, multiplication par six des échanges, déversement dans le monde de 50 millions d’Européens qui cherchent des nouvelles terres et annexent d’immenses empires coloniaux.
Enfin, nous nous trouvons à notre époque : la naissance de la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd’hui.
D’après Sylvie Brunel, depuis le début des années 1990, la « mondialisation » désigne une nouvelle phase dans l’intégration planétaire des phénomènes économiques, financières, écologiques et culturels».
CAUSES DES ECHANGES INTERNATIONAUX
LES DIFFERENTS PAYS : A cause de plusieurs différences entre les pays comme le degré de développement économique et technologique de chaque pays, les situations géographiques, les théoriciens du commerce international ont basé leurs analyses sur cette diversité des pays dans plusieurs domaines. Ainsi, ces différences ont catégorisé automatiquement les plans de chaque pays au niveau du commerce international : les PD sont considérés comme des producteurs de produits manufacturés, des matériels de technologie de pointe, des machines et équipement industriels et les PED sont fournisseurs de produits agricoles, des matières premières et des biens de consommation. A CAUSE DES INTERETS ET GAINS TIRES DE L’ECHANGE : D’après David Ricardo (1772-1823), un pays a intérêt au commerce international s’il se spécialise dans les produits en lesquels son désavantage est le plus faible. C’est la Théorie de l’Avantage Comparatif de Ricardo. Il a remis en cause la Théorie de l’Avantage Absolue en tenant compte qu’il se peut qu’un pays n’ait d’avantage absolu sur aucun produit. On va illustrer cette théorie par des chiffres. On est en présence de deux pays : le Portugal et l’Angleterre. Ce dernier serait dans un désavantage absolu (tandis que réellement c’est faux pour l’époque). On s’intéresse sur la quantité.
LA LOGIQUE DES ZONES D’INTEGRATION REGIONALE
LA NEGOCIATION ECONOMIQUE
Le nouveau système commercial multilatéral marque le passage du GATT à la création de l’OMC en 1995. L’OMC n’est encore pas très connue du public par rapport à d’autres institutions comme la Banque Mondiale, les Fonds Monétaire International ou l’Union Européenne. Cependant il importe de savoir que l’OMC a plus de pouvoir que le GATT : en plus des domaines classiques du commerce des marchandises, elle englobe de nouveaux domaines tels que les éléments sur les brevets et les autres aspects de la propriété industrielle, les investissements affectant les échanges et le commerce des services.
En outre, ces dernières années marquent le retour en force du régionalisme comme instrument et cadre d’expansion des échanges. Entre autres les ALENA (Association de Libre Echanges Nord-Américaine), ANASE (Association des Nations du Sud-est Asiatiques), CEA (Communauté Economique Africaine) et UE (Union Européenne). Cette tendance résulte de plusieurs facteurs : lourdeur des processus de négociations multilatérales, limite financière et commerciale de l’Etat-Nation, reflexe de regroupement face à la globalisation. Par ailleurs, ces accords régionaux doivent faire l’objet d’une notification d’existence et de rapports périodiques à l’OMC. C’est donc dans ce contexte particulier qu’il faut analyser la dynamique des organisations régionales actuelles de l’Océan Indien et de l’Afrique de l’Est.
LES ASPECTS DE L’INTEGRATION REGIONALE
Selon le dictionnaire économique et social, J. Brémond, Hatier, Paris 1991, « L’intégration désigne, soit un processus, soit un résultat. En tant que processus, l’intégration est un ensemble de mesures destinées à supprimer les discriminations entre unités économiques des différents pays.
En tant que résultat, elle se caractérise par l’existence d’un espace économique unifié ». En fait, par définition, l’intégration régionale traduit la circulation libre des hommes, des marchandises, des capitaux au sein d’un bloc qui vise les accords commerciaux sur une base géographique dont l’objectif est de libéraliser les échanges entre les pays signataires. Dans ces accords, les mesures suivantes sont prises :
Réduction tarifaire, L’harmonisation des liasses documentaires douanières, Les réformes juridiques et réglementaires, La rationalisation du système de paiement, Les motivations à l’investissement, La réorganisation des normes, des exigences sanitaires et phytosanitaires.
Ensuite, il y a 6 étapes de l’adhésion dans une communauté régionale. La Zone d’Echange Préférentielle (ZEP).
Son adhésion est conditionnée par une mise en œuvre d’un plan d’abaissement tarifaire menant vers la mise en place de la Zone de Libre Echange.
La Zone de Libre Echange (ZLE) : Elle admet une annulation des droits de douane, les restrictions tarifaires et non tarifaires relatives aux échanges commerciaux entre les pays membres. Chaque Etat membre de la ZLE est libre d’établir indépendamment des restrictions tarifaires aux pays non membres. L’Union Douanière : Consiste à éliminer les restrictions tarifaires et non tarifaires aux échanges commerciaux entre les Etats membres ; et aussi à établir une protection commune tarifaire et non tarifaire dans leurs relations avec les Etats tiers. qui sont : la COI, la SADC, le COMESA et l’IOR.
LES INTERETS DE L’INTEGRATION REGIONALE
Pour affronter la concurrence de plus en plus rude dans le contexte actuel d’ouverture, l’intégration régionale est la solution adoptée par les pays d’Afrique subsaharienne, donc ces intérêts sont plusieurs:
Pour acquérir un milieu plus vaste : Un marché plus vaste est un facteur de croissance. Il permet de trouver des débouchés où les entreprises locales écoulent leurs produits au-delà des frontières nationales. Puis, permet de réaliser des économies d’échelle en se spécialisant sur la production seulement d’une variété limitée de biens et de services.
Donc, chaque pays pourra produire ceux-ci à une échelle plus grande et d’une manière plus efficiente que s’il essayait de les produire tous.
Pour une création d’emploi : L’intégration économique régionale accélère le processus de délocalisation. C’est aussi une source de création d’emploi. Donc elle augmente le revenu pour les résidents.
Pour l’amélioration du bien-être des consommateurs : Les besoins des consommateurs primaires ne sont plus satisfaisants par les producteurs locaux, le pays est obligé d’en importer pour combler ces lacunes. Avec la suppression des droits de douane, les prix d’importation vont diminuer et les acheteurs sont donc les gagnants grâce à la baisse des prix résultants de la réduction.
Table des matières
Introduction
Partie I : Approche théorique : LA CONTRIBUTION de la mondialisation à travers l’intégration régionale au développement et croissances des PED
Section 1 : Mondialisation et intégration régionale
1. La mondialisation
1.1. Définition
1.2. Les conséquences de la mondialisation
1.2.1. Les effets sociaux
1.2.1.1. L’emploi
1.2.1.2. Les conditions de vie
1.2.1.3. L’identité culturelle
1.2.1.4. La cohésion sociale
1.2.2. Les effets politiques
1.2.3. Les effets économiques
1.2.4. Les effets au niveau mondial
1.2.4.1. L’accentuation des asymétries entre pays
1.2.4.2. Les effets écologiques
1.3. Evaluation systémique des conséquences de la globalisation (Tableau a la page suivante)
Section II : Echanges internationaux
1. La théorie classique du commerce international : la théorie des avantages absolus d’Adam Smith
2. Historiques
3. Cause des échanges internationaux
3.1. Les différents pays
3.2. A cause des intérêts et gains tirés de l’échange
4. Le mécanisme
4.1. La Division Internationale du Travail ou DIT
4.2. La Nouvelle Division Internationale de Travail (DIT)
Section III : Intégration régionale
1. La logique des zones d’intégration régionale
1.1. La négociation économique
1.2. Les accords et institution de la zone Océan Indien et Afrique de l’Est
2. Approche de l’intégration régionale
2.1. Les aspects de l’intégration régionale
2.2. Les intérêts de l’intégration régionale
Partie II : Intégration entre Madagascar et COMESA
Section I : COMESA
1. Présentation
1.1. origine de la comesa
1.2. Les règles qui gèrent le COMESA
2. Mode d’action du COMESA
2.1. Les objectifs du COMESA
2.2. Analyse SWOT du COMESA
3. Union douanière du COMESA
3.1. Les objectifs d’une union douanière
3.2. Le progrès est réalisé par l’Union Douanière du COMESA
3.3. Les éléments fondamentaux d’une Union Douanière
3.4. La protection douanière
Section II : Madagascar – COMESA
1. Madagascar et ses échanges avec l’extérieur
1.1. Importations
1.2. Exportations
1.2.1. Exportation d’origine agricole
1.2.2. Les exportations d’origine non agricole hors zone franche
1.2.3. Les exportations des zones franches
2. La Balance de Paiement de Madagascar
2.1. Objectif et mesures en 2006
2.2. Résultats pour 2006
2.3. Transferts courants
2.4. Les opérations en capital et financières
3. Madagascar au sein du COMESA
3.1. Structure des échanges entre les deux
3.1.1. La structure des exportations de Madagascar vers le COMESA
3.1.2. La structure des importations en provenance du COMESA
3.2. Les avantages de Madagascar dans le COMESA
3.3. Les désavantages de Madagascar au sein du COMESA
3.4. Le COMESA et la réalité
3.5. Difficultés de l’intégration
3.5.1. En termes de quantité et qualité
3.5.2. En termes de cout
3.5.3. En termes de cadre législatif
3.6. Recommandations
Conclusion
Annexes
Bibliographie