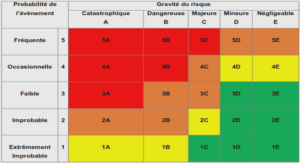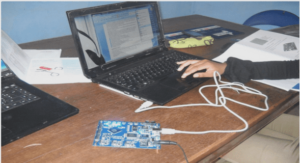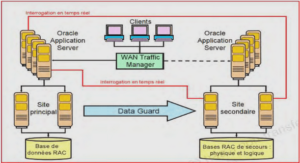Depuis quelques décennies, on observe dans le domaine des télécommunications l’apparition de nouvelles technologies permettant de communiquer de manières différentes. Du transport initial de la voix entre deux usagers, on est arrivé à un partage de données qui peut revêtir de nombreuses formes : messages, textes, photos, vidéos, etc. Tout d’abord, les premiers réseaux informatiques ont permis l’échange de données numériques par le biais de câbles et de fibres optiques. Puis, les systèmes cellulaires GSM (Global System for Mobile communication) entièrement numériques correspondant à la deuxième génération de téléphonie mobile est lancée. Ce système permet de dialoguer, d’envoyer des messages et des données dans la zone de couverture avec un débit maximal autorisé de 14,4 kbits/s. Dans une version améliorée du GSM (2G+), les systèmes de téléphonie sans fil proposent des débits plus élevés et une connectivité internet avec notamment le GPRS (General Packet Radio System) et EDGE (Enhaced Data Rates for GSM Evolution) qui peuvent atteindre des débits théoriques respectifs de 171,2 kbits/s et 384 kbits/s. Cette évolution mène ainsi vers un système cellulaire de troisième génération (3G) nommé UMTS (Universal Mobile Transceiver System) proposant des débits théoriques maximum de 2 Mbit/s. Cependant, des débits plus importants permettant de transférer simultanément des photos et des vidéos, ou de proposer les services des réseaux locaux ou internet font toujours l’objet d’une demande croissante. C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier les possibilités d’augmenter les débits d’un système de quatrième génération (4G). Avec cette génération, les industriels et les opérateurs cherchent à faire passer les débits aux alentours de 40 Mbps. On devrait donc atteindre des débits proches de ceux disponibles dans le fixe avec la fibre optique, avec la nuance que la bande passante sera mutualisée entre tous les utilisateurs présents simultanément dans la zone considérée.
Propagation des ondes électromagnétiques
Types de propagation
Les ondes électromagnétiques se propagent en espace libre ou hors espace libre.
Propagation en espace libre
Selon l’environnement de propagation, les influences du canal diffèrent. Le modèle d’espace libre permet d’avoir une première approche. Dans le cas d’une liaison en vue directe LOS (Line Of Sight) entre l’émetteur et le récepteur, la première zone de Fresnel permet de cerner la validité du modèle espace libre dans un canal réel. Effectivement, si cette zone n’est pas dégagée, le modèle n’est plus valable.
Propagation hors espace libre
Les situations les plus courantes de propagation des systèmes de radiocommunication sont loin d’être en espace libre. Les obstacles de différentes formes géométriques et de diverses caractéristiques physiques perturbent la propagation. Ces perturbations se traduisent par des fluctuations de la puissance du signal reçu en fonction de la distance.
La décroissance en 1/d² est la principale perte de puissance. La densité de puissance diminue au fur à mesure que l’onde s’éloigne de sa source. L’influence des obstacles rencontrés par l’onde varie selon leurs configurations. En plus de la décroissance de la densité de puissance en fonction de la distance, entre l’antenne d’émission et l’antenne de réception, le signal subit deux types de pertes : pertes à petite échelle et pertes à grande échelle.
Phénomènes influents sur la propagation
La propagation des ondes électromagnétiques est caractérisée par plusieurs phénomènes physiques :
– la réflexion du signal sur un obstacle.
– la réfraction du signal lorsque celui-ci traverse un milieu d’indice différent de celui d’où il provient.
– la diffraction due à un obstacle.
Tous ces phénomènes physiques entraînent des échos (propagation par trajets multiples due à la présence d’obstacles) pouvant engendrer des évanouissements (fadings) qui sont des « trous de transmission » résultant de l’annulation du signal à un instant et une fréquence donnée.
Par conséquent, lorsqu’on est en réception fixe, portable ou mobile, la probabilité de recevoir uniquement une onde directe provenant d’un émetteur est très faible. On va donc recevoir le signal émis par l’émetteur ainsi qu’une multitude de signaux atténués et retardés provenant des différents échos.
Evanouissements dans le système SISO
Une caractérisation approfondie du canal de propagation permet d’améliorer la qualité de services QoS (Quality of Service) d’un système de transmission numérique. Ainsi, le lien existant entre les paramètres caractéristiques du canal et l’information transmise est présenté. Cette information peut être représentée par deux paramètres : le temps symbole TS qui correspond à la durée d’un symbole et la bande passante qui est l’occupation spectrale de l’information transmise.
Evanouissements temporels
Les évanouissements temporels du canal peuvent être classés en deux catégories:
– Évanouissements rapides : Si le temps symbole est plus grand que le temps de cohérence alors il existe des fluctuations durant l’émission d’un symbole lors d’une communication numérique.
– Évanouissements lents : Si le temps symbole est plus petit que le temps de cohérence alors le canal paraît stable pour le symbole émis.
Evanouissements fréquentiels
Dans le domaine fréquentiel, un canal a un niveau de puissance pouvant fluctuer selon la bande fréquentielle d’observation, ce qui implique deux types d’évanouissements :
– Canal sélectif en fréquence : la bande de cohérence du canal est plus petite que la bande passante occupée par le signal transmis.
– Canal plat : la bande de cohérence du canal est plus grande que la bande passante occupée par le signal transmis.
Évanouissements spatiaux
Ces évanouissements peuvent se décomposer en deux catégories. Les évanouissements à petite échelle interviennent lorsque le mobile se déplace sur des distances proches de la longueur d’onde. Ils correspondent à des interférences constructives ou destructives au niveau du récepteur. Ainsi, il est possible de recevoir une puissance quasi nulle au niveau du récepteur, ou inversement de recevoir un niveau de puissance supérieur à celui émis. Ces évanouissements sont superposés aux évanouissements à grande échelle, qui sont dus aux effets de masque dans l’environnement de propagation : collines, immeubles, etc. Ils interviennent pour des déplacements importants. Ainsi, si la distance parcourue par le récepteur est grande (petite) devant la distance de cohérence, le canal subit un évanouissement à grande (petite) échelle.
INTRODUCTION |