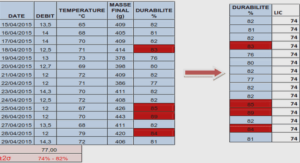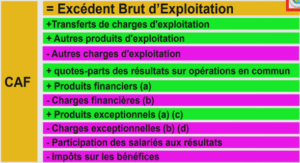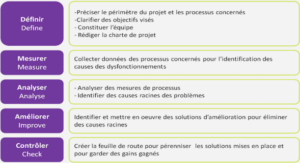Formation en enseignement rénové de la grammaire
Plusieurs chercheurs soutiennent que, pour enseigner la grammaire rénovée, il est essentiel que les enseignants acquièrent une base solide de connaissances grammaticales et s’approprient les outils d’analyse ainsi que les démarches d’enseignement qui lui sont propres (Chartrand, 2009, 2011 , 2013; Chartrand, Lord et Gauvin, 2010; Gauvin et Boivin, 2013; Hamel, 2010; Lord, 2012). Pourtant, Chartrand et Paret (2010) mentionnent que le ministère de l’Éducation n’a donné aucune formation de base massive aux enseignants pour soutenir l’implantation de la GR prescrite dans le programme de français de 1995. Ce n’est qu’en 2009, près d’une quinzaine d’années après les modifications apportées à l’enseignement de la grammaire traditionnelle, qu’un document prescriptif est élaboré par le MELS à l’intention des enseignants du primaire, la Progression des apprentissages du primaire (MELS, 2009). Ce document destiné, entre autres, à l’enseignement des différentes disciplines associées à la classe de français (lecture, écriture, communication orale) présente un contenu grammatical à faire apprendre et des pistes de travail pour guider l’enseignement à chaque année du primaire. Au moment de sa parution, la nécessité de former les conseillers pédagogiques de français à la GR s’est imposée. Ainsi, la nouvelle théorie grammaticale leur est présentée par le MELS2 lors d’une session de perfectionnement (mars 2010 à octobre 2010). Ces différentes mesures ont eu peu d’effet sur l’appropriation de la GR par les enseignants. Selon une enquête de l’ÉLEF (2012) menée par Chartrand et Lord (2010), 72% d’entre eux considéreraient « utile» ou « très utile» une formation sur la grammaire de la phrase, évaluant que leurs connaissances de la GR sont précaires au regard du contenu grammatical et des outils d’enseignement qu’elle privilégie.
Pratiques d’enseignement grammatical
Différents travaux ont examiné les pratiques de l’enseignement rénové de la grammaire au secondaire et au primaire (Chartrand, 2011 ; Chartrand et Lord, 2010, 2013; Cogis, 2006; Garcia-Debanc, Paolacci et Boivin, 2014; Hamel, 2010; Nadeau et Fisher, 2006; Paolacci et Garcia-Debanc, 2009). Ils montrent que les démarches d’enseignement traditionnel, comme l’explication de règles et la réalisation d’exercice d’application d’une règle, jouissent encore d’une certaine popularité (Beaudoin, Boutin et Huot, 2004). En ce sens, l’étude de Chartrand (2011) est particulièrement révélatrice quant aux pratiques actuelles au secondaire. L’auteure a analysé les séquences d’enseignement réalisées par cinq enseignants. Les résultats montrent que {( ni l’esprit, ni les démarches, ni les outils de la grammaire rénovée ne sont convoqués en classe» (p.52). Plus récemment, Chartrand et Lord (2013), qui rapportent les résultats d’une étude menée par l’ÉLEF, soulignent que « les exercices de grammaire sont toujours aussi présents dans la classe de français, la dictée également et ce, même si nombre de didacticiens ont critiqué ouvertement son efficacité en matière d’outil d’apprentissage» (p. 88).
Ces résultats vont dans le sens de ceux de Ouellet (2010) qui a étudié les méthodes d’enseignement de la grammaire chez des enseignants de 6e année du primaire, de 1 re secondaire et d’adaptation scolaire. L’auteure a mis en évidence que « les exercices d’application de règles dominent dans les trois niveaux scolaires suivis de la présentation de règles» (p. 14). En ce qui concerne le primaire, la recherche de Beaudoin et al. (2004), réalisée auprès de 34 enseignants et 148 étudiants en formation universitaire à l’enseignement, rapporte leurs pratiques privilégiées. Les participants étaient invités à choisir, parmi 30 possibilités, les démarches d’enseignement les plus pertinentes. Les résultats de l’étude montrent que celles mises de l’avant en GR, comme l’analyse syntaxique au moyen des manipulations syntaxiques ou les approches inductives telles que la démarche active de découverte (DADD) sont presque absentes des choix effectués. Les auteurs ont observé que les enseignants et les étudiants de 1 re année universitaire présentent « une conception plus traditionnelle» (p.15) de l’enseignement apprentissage de la grammaire que celle, plus contemporaine, des étudiants de 3e et 4e année, « ce qui laisse présager l’influence de la formation universitaire reçue» (p. 11).
Quant à l’étude de Hamel (2010) portant sur les pratiques effectives de huit enseignantes du 3e cycle, elle montre que « le paradigme traditionnel (de l’enseignement grammatical) est encore bien présent dans les classes» (p.178). Les résultats de ces études québécoises rejoignent ceux obtenus en France par Paolacci et Garcia-Debanc (2009). Selon ces auteures, l’enseignement grammatical relèvent davantage de pratiques « traditionnelles» que de celles privilégiées par les recherches en didactique du français des dernières décennies. En somme, les études rapportées montrent des lacunes concernant d’une part, les outils didactiques pour l’enseignement grammatical, en particulier au regard du métalangage qui manque d’uniformité et de cohérence, pourtant essentiel à une activité grammaticale formatrice (Chartrand et aL , 2010). D’autre part, elles rapportent que les démarches d’enseignement privilégiées en GR sont peu utilisées dans le travail grammatical réalisé par les enseignants et les élèves.
Pertinence sociale
Depuis longtemps au Québec, une grande importance est accordée à la qualité et à la maitrise de la langue française. À cet effet, le Conseil supérieur de la langue française (CSLF, 2015) a tout récemment émis un avis à la ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française dans lequel il souligne la nécessité d’un enseignement du français efficace à tous les ordres d’enseignement. Il rappelle également que « la responsabilité première en matière de compétences linguistiques incombe aux établissements d’enseignement» (p. 26). Il revient donc à l’enseignant d’amener ses élèves à développer les outils langagiers nécessaires à la maitrise de la langue. Au primaire, ceux-ci concernent, entre autres, les connaissances de base en grammaire de la phrase et l’appropriation graduelle de la terminologie grammaticale permettant à l’élève « d’intervenir avec précision lorsqu’il participe à des activités liées à la langue» (PFÉQ, 2001 , p.72). L’apprentissage de la grammaire vise à contribuer au développement des compétences langagières: lire, écrire, communiquer oralement. Toutefois, pour assumer adéquatement un enseignement de qualité, l’enseignant doit tirer profit des pratiques prometteuses susceptibles d’améliorer les connaissances syntaxiques et grammaticales des élèves et d’en favoriser le transfert dans les différents domaines de la discipline « français ». L’introduction de la grammaire rénovée en classe représente «tout un virage sur le plan de la théorie grammaticale» (en proposant) «une description plus rigoureuse et plus complète des phénomènes grammaticaux» (Nadeau et Fisher, 2006, p.2) et des démarches d’enseignement qui rendent les élèves actifs sur le plan cognitif.
En introduisant un nouvel outil d’enseignement qui intervient dans le parcours professionnel des enseignants et en privilégiant leur formation continue dans « des conditions de forte proximité participative de terrain)} (Bru, 2002, p. 65), nous souhaitons contribuer à la transformation de leur pratique d’enseignement de la GR, notamment du point de vue des outils d’analyse de langue et des pratiques qu’elle propose. Nous disposons de peu d’information sur les apports des outils mis à la disposition des enseignants sur la transformation de leurs pratiques. Toutefois, il semble qu’ils peuvent «contribuer à une transformation des types de situations d’enseignement apprentissage mises en oeuvre par les enseignants dans leur classe, mais aussi de la manière dont les élèves apprennent)} (Lebrun et Niclot, 2009, p. 9). Par ailleurs, les résultats s’avéreront aussi utiles pour soutenir la formation initiale des futurs enseignants. Comme le souligne Dufays (2005), les recherches qui s’intéressent aux pratiques permettent « de mieux guider les jeunes enseignantes sur les conditions d’efficacité de leurs actions)} (p. 10). L’analyse de ces pratiques et la description des principaux savoir-faire des enseignants expérimentés (Goigoux et Vergnaud, 2005) soutiendraient le développement des compétences professionnelles des futurs enseignants. Selon Goigoux et Vergnaud (2005), « mieux décrits, ces savoir-faire sont plus aisés à transmettre en formation professionnelle)} (p. 10). Ainsi, la recherche contribue à combler certaines lacunes observées concernant la recherche en éducation qui, selon Tardif et Zourhlal (2005) s’avère souvent, peu adaptée aux besoins des praticiens auxquels elle est pourtant destinée et peu utilisée dans les milieux de pratique.
REMERCIEMENTS |