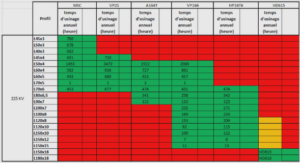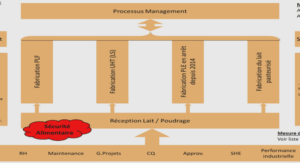Importance de la production de piment
L’intérêt des plantes légumières telle que le piment pour l’alimentation des populations est largement reconnu dans le monde (Ludy et Mattes, 2011). Dans le monde entier, la consommation des fruits de Capsicum probablement classés parmi les premiers épices ou additifs alimentaires, ne cesse d’augmenter. La Chine est le plus grand producteur de piment avec plus de 125 000 000 tonnes en 2005. Ainsi, en 2005, l’Asie a produit 65,6 % de piment, suivie de l’Amérique (13,9 %), et de l’Afrique (8,8 %). En Afrique, le Nigeria, l’Egypte et le Ghana ont une production régulière qui se retrouve sur le marché international (FAO, 2006). Le piment est un produit de base de cuisines ethniques comme la cuisine thaïlandaise, coréenne, indienne, hongroise, africaine, mexicaine etc. (Kollmannsberger et al. 2011). Les fruits de Capsicum sont très appréciés un peu partout dans le monde. Il peut être consommé à l’état frais de manière directe, frit, en sauce où en conserve. Il est souvent associé en mélange avec divers autres légumes (Kouassi et Koffi-Nevry, 2012).
Au Sénégal, le piment est devenu un produit de « luxe », un épice très recherché sur le marché. Son prix parfois exorbitant s’explique par sa faible production dans les Niayes par rapport aux autres spéculations (SENEPLUS, 2015). Il est beaucoup plus produit dans la zone sud du pays notamment dans la région de Kolda. Cependant, la zone des Niayes également contribue pleinement à la production de cette spéculation (AGRICULTURE SENEGALAISE, 2019).
Quelques ravageurs et maladies du piment
L’espèce Ceratitis capitata
Les mouches des fruits (Diptera : Tephritidae) sont des ravageurs des cultures redoutées sur tous les continents. Parmi elles, la mouche méditerranéenne des fruits Ceratitis capitata (Wiedemann) qui se répartit dans les zones tropicales et subtropicales (Gardon, 2000). Au Sénégal elles causent plus de dégât aux familles des Cucurbitacées et des Solanacées comme le piment (Dia et al., 2015b).
Origine de C. capitata
Originaire d’Afrique subsaharienne, cet insecte ravageur de nombreuses cultures fruitières est présent dans toutes les régions de climat méditerranéen des deux hémisphères.
L’aire d’origine de l’espèce reste encore un sujet de controverse mais son origine a été tout de même confirmé par le biais de techniques biomoléculaire, comme l’électrophorèse (Malacrida et al., 1992) mais également par la technique RAPD (polymorphisme d’amplification aléatoire de l’AND par PCR ) (Baruffi et al., 1995).
Biologie de C. capitata
Les mouches adultes pondent leurs œufs sous l’épiderme des fruits, particulièrement là où la peau est déjà déchirée. L‘œufs éclosent au bout de trois jours et la larve se développe à l’intérieur du fruit en se nourrissant de la pulpe (Chrlstenson et Foote, 1960). Les femelles, qui vivent de 2 à 3 mois, déposent au cours de leur vie environ 800 œufs en conditions de laboratoire et 300 en conditions naturelles (Back et Pemberton, 1918).
Ces œufs, légèrement arqués et de couleur blanche, mesurent environ 1 mm de long. Le nombre d’œufs par ponte varie entre 1 et 14. Les larves sont munies de 2 crochets buccaux noirâtres.
La pupe brun-foncée a une forme de tonnelet et une longueur de 4 à 5 mm (McDonald et McInnis, 1985).
Les pucerons
Les cultures protégées souffrent de l’attaque de plusieurs ravageurs dont les pucerons qui constituent le groupe entomologique le plus nuisible (BAKROUNE, 2012b). Sur piment, deux espèces sont présentes : Myzus persicae Sulzer et Aphis gossypii Glover (Hemiptera ; Aphididae) (Kamel et al, 2010). Ils se nourrissent de la sève élaborée des plantes et provoquent des dégâts directs (Dedryver, 2010). En prélevant la sève, ils provoquent la décoloration, la déformation ou la destruction des tissus végétaux et donc affaiblissent la plante. Ils sont aussi responsables de dégâts indirects en transmettant certains virus (Maaoui, 2012). Le miellat qu’ils produisent, favorise la présence d’un champignon de couleur noire, la fumagine qui recouvre les feuilles diminuant ainsi la photosynthèse (BAKROUNE, 2012c). Ces insectes sont un obstacle majeur à l’augmentation des rendements ainsi que la qualité des produits (Diallo et al., 2017 ; Akantetou et al., 2011).
La mouche blanche
La mouche blanche du cotonnier Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera ; Aleyrodidae) est devenue un véritable fléau qui préoccupe de plus en plus les producteurs de cultures maraîchères dans le monde entier (Naranjo et Ellsworth, 2001). En plus des dégâts trophiques directs, l’insecte véhicule de nombreux virus sur différentes cultures. Par l’excrétion du miellat, B. tabaci affecte aussi la fonction photosynthétique et la qualité des produits récoltés (Brown, 1994 ; Traboulsi, 1994).
Elles sont responsables de virose chez le piment et provoquent un flétrissement des feuilles (Ryckewaert et Fabre, 2002) . Ces insectes transmettent les virus par les piqûres lors du prélèvement de la sève provoquant ainsi leur chute avant la maturité.
Autres ravageurs du piment
D’autres ravageurs comme les chenilles, les orthoptères et les hétéroptères peuvent également causer des dégâts néfastes sur le piment (Ryckewaert et Fabre, 2002)
Solution d’ail + piment
Insectifuges de chenilles, de coléoptères, des criquets et des pucerons, l’ail et le piment sont deux biopesticides prometteurs utilisés en protection des cultures (Tchibozo, 1996).
L’ail
Description
L’ail, du nom scientifique « Allium sativum », appartient à la famille de Liliacées et au genre Allium. Ce genre contient plus ou moins 400 espèces dont 7 seulement sont utilisées comme légumes. La partie comestible est constituée par une partie souterraine appelée « bulbe ». Ce bulbe est composé d’un « plateau » résidu desséché de la tige courte de la plante, parfois pourvu au centre d’un « bâton », base de la hampe florale sur lequel s’insèrent les caïeux. Ces derniers sont séparés les unes des autres par des tuniques sèches, résidus de gaine foliaire épaisse, chacune, percée au centre d’un canal qui donnera passage aux premières feuilles. Le disque sur lequel s’insèrent tous les caïeux s’appelle « cormus ». La coloration de membranes extérieures peut être blanche, rose, jaunâtre et constitue un caractère variétal (Pierre, 2011).
Composition chimique de l’ail
Dans le genre Allium (Liliacée), on trouve principalement des acides aminés soufrés non protéiques, les alk (en) ylcystéine sulfoxides. Leurs dérivés dipeptidiques de l’acide glutamique sont également présents en grande quantité, leur proportion pouvant atteindre 5 % du poids sec (Lancaster, 1988). Le bulbe d’ail contient des diverses huiles éthériques qui lui confèrent des propriétés condimentaires et antibiotiques. L’alcaloïde du bulbe d’ail est appelé « allicine » et celui-ci confère à l’ail des propriétés fongicides, bactéricides et nématicides (Pierre, 2011). C’est un composé organo-sulfuré abondant dans l’ail comme on le trouve également dans l’oignon et les autres espèces de la famille des Alliacées. L’allicine fait partie des mécanismes de défenses de certaines alliacées comme l’ail contre les attaques d’insectes et autres prédateurs (Block, 1985).
Action des composés soufrés de l’ail
Les actions négatives des composés soufrés des Allium sur les insectes se divisent également en actions comportementales et physiologiques (Thibout et Auger, 1997). Des cas d’effets anti-appétant ont été observés des extraits d’Allium sativum qui perturbent la prise alimentaire du coléoptère Epilachna varivestis (Nasseh, 1981). Selon Nasseh (1983) le puceron Myzus persicae a été sensible aux effets d’extrait d’ail. Selon Bhuyan et al. (1974) les extraits d’A. sativum repousse le moucheron Simulium indicum et le moustique Culex fatigans. Les trois expériences réalisées en serre ont prouvé que le nouveau biofongicide, à base d’ail , contrôlait aussi bien le blanc de la tomate que le soufre lorsque les pulvérisations étaient effectuées à chaque semaine (Richard, 2007).
Le piment (pili-pili)
Composition chimique
Le piment fort, Capsicum frutescens, est caractérisé par l’existence de plusieurs variétés qui se distinguent par leurs formes, leurs couleurs et leurs pouvoirs piquants. D’un point de vue chimique, en plus des composés primaires, le genre Capsicum contient divers métabolites secondaires tels que des alcaloïdes sous formes de capsaicidine (Sabler, 1976), de capsaicine (Cordell and Araujo, 1993) et de solanine (Newall et al., 1996), des saponines (Lucca et al., 2002) et des flavonoïdes avec d’autres composés phénoliques (Materska et al., 2003). Ces composés ont un effet toxique pour une large gamme d’insectes ravageurs (Williams and Mansingh, 1993) mais également présentent un grand pouvoir répulsif pour ces derniers (Zibokere, 1994). Ces composés sont facilement biodégradables, moins toxiques et ont moins d’impact possible sur l’environnement et la santé humaine (Regnault et al., 2008). Ils constituent donc un grand atout en protection des cultures.
Action des extraits de Capsicum frutescens
Les extraits aqueux de Capsicum frutescens L. contiennent des substances allélochimiques agissant par des effets répulsifs, anti-appétant ou toxiques contre les phytophages généralistes (Ehrlich et Raven, 1964). Les alcaloïdes, les saponines et les flavonoïdes, extraits des fruits de C. frutescens, affectent la viabilité des œufs et la survie des adultes de Bemisia tabaci (Choi et al., 2003) . La poudre et les extraits de C. frutescens ont un effet répulsif sur Sitophilus zeamaïs Motsch et Tribolium castaneum (Herbst) (Trematerra et Sciarretta, 2002a).
L’effet insecticide du fruit de C. frutescens a aussi été observé chez C. maculatus (Gakuru et Foua Bi, 1996). Chez certains invertébrés, on peut observer des effets répulsifs ou anti-appétant dû aux alcaloïdes des Capsicum (El-Lakwah et al., 1997 ;Tang et al., 2000 ;(Trematerra et Sciarretta, 2002). Al-Moajel (2004) a aussi montré que les extraits de ont un effet toxique sur les larves de Trogoderma granarium. Ces extraits apparaissent donc comme potentiellement utilisables en gestion intégrée des ravageurs.
Importance des extraits végétaux en phytoprotection
L’emploi des extraits de plantes comporte des avantages certains. En effet, les plantes constituent une source de substances naturelles qui présentent un grand potentiel d’application contre les insectes et d’autres parasites des plantes et du monde animal (Schémaeza et Sonda, 2007). Les produits biodégradables provenant de plantes constituent une bonne alternative qui permet aux producteurs de pouvoir assurer la protection de leurs cultures à un coût relativement faible. La réduction de l’emploi des pesticides chimiques due à l’utilisation des extraits de plantes contribue énormément à la réduction de la pollution de l’environnement et cela permet également d’améliorer la santé publique des populations (Asma et Somia, 2013)