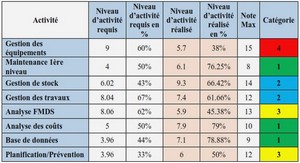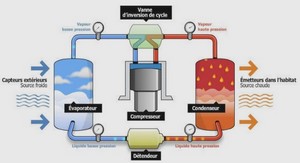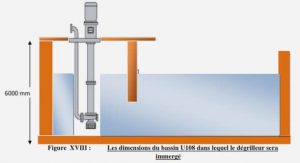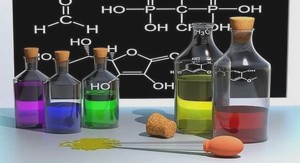Utilisation des herbicides
L’exploitation des terres agricoles s’est intensifiée au rythme de la croissance exponentielle de la population mondiale depuis la révolution industrielle. Les techniques modernes de travail et la mécanisation ont activement participé à l’augmentation de la production agricole. Cependant, pour répondre à une demande de plus en plus forte, les utilisateurs ont recours à différents herbicides afin d’éliminer entièrement ou partiellement les végétaux parasites. Leur utilisation remonte avant la révolution industrielle. Les herbicides sont de plus en plus sélectifs de nos jours, c’est-à-dire que leurs effets se limitent à quelques espèces. Cependant les désherbants ayant un champ d’action étendu agissant sur de nombreux végétaux en fonction de la dose d’emploi, du stade de développement de la plante, du mode d’application et des conditions climatiques sont encore largement utilisés ; ce qui engendre des risques de phytotoxicité . Les modes d’action des herbicides sont diverses même si l’objectif demeure la même. Les techniques d’épandage dépendent des produits mise en œuvre par les agriculteurs, du moment d’application, de la superficie à traiter. Il s’agit essentiellement de la pulvérisation au sol, de l’épandage aérien.
L’arrivée, après la deuxième guerre mondiale, des herbicides chimiques de synthèse a considérablement contribué à l’amélioration des rendements et à la mécanisation de la récolte. Selon leur mode d’action, on peut les utiliser en pré-levée (avant la germination) ou en post-levée. On distingue : les désherbants sélectifs (les plus nombreux) ; les débroussaillants, et produits de dessouchage chimique ; les désherbants totaux (les plus utilisés); les défanants qui détruisent la partie aérienne des végétaux. Ils sont par exemple utilisés pour la récolte mécanique de la pomme de terre ou de la betterave ;
les anti-germes, qui empêchent le démarrage de la végétation de bulbes ou tubercules destinés à l’alimentation (oignons, pommes de terre par exemple) ;
les silvicides qui visent plus spécifiquement les espèces forestières ou le processus de régénération naturelle ;
La décennie 1950-1960 a été très riche en synthèse chimique de nouvelles molécules ayant un potentiel herbicide utilisable pour les cultures à grande échelle. Parmi ces produits de synthèse, on retrouve trois familles majeures d’herbicides : les phénylurées, les phénylcarbamates et les triazines .
Classification des herbicides
Il existe dans la nature une multitude d’espèces de mauvaises herbes. Pour les combattre, une grande variété d’herbicides est disponible pour les utilisateurs. Il est possible de les regrouper en différentes classes : selon leur mode d’action ; leur moment d’application (usage préventif ou curatif) ou en fonction de leur famille chimique.
Selon le mode d’action : On entend par mode d’action d’un herbicide tous les phénomènes qui concourent à la destruction d’une plante sensible . Cela comprend la pénétration du produit dans le végétal, le déplacement vers son site d’action, son interaction avec sa cible biochimique et ses conséquences physiologiques comme la mort de la plante. On distingue les inhibiteurs de synthèse, les inhibiteurs de la photosynthèse, les herbicides auxiniques.
Inhibiteurs de synthèse : Ce sont des herbicides qui visent les jeunes pousses et peuvent migrer des feuilles aux racines. On distingue les inhibiteurs de la synthèse des lipides à mode d’action systémique qui agissent uniquement contre les graminées, les inhibiteurs de la synthèse des acides aminés (aliphatiques ou aromatiques) ou de l’action des acides aminés à chaine ramifiée qui agissent sur les enzymes pour prévenir la production d’acides aminés . Ils se diffusent dans toute la
plante et sont à l’origine de l’atrophie ou encore du jaunissement pouvant conduire à la mort de la plante . Hormis ces inhibiteurs de synthèse, il existe aussi les inhibiteurs de la dioxygénase, du pyruvate de p-hydroxyphényle (HPPD), les inhibiteurs de l’assemblage des microtubules et les inhibiteurs de la glutamine synthétase appelés aussi inhibiteurs de l’assimilation de l’ammoniaque. Inhibiteurs de la photosynthèse : Ce sont des herbicides qui attaquent en premier les tissus âgés et sont susceptibles de migrer vers les feuilles de la plante. Ils inhibent précisément la photosynthèse au niveau du photosystème II suivant plusieurs sites, avec blocage du transfert des électrons et du transfert de l’énergie lumineuse. Au cours de la photolyse, des électrons sont libérés dans la plante jusqu’à la réduction de la nicotamide adénine dinucléotide phosphate (NADP+). Plusieurs composés destructeurs secondaires sont produites au cours de l’inhibition de la photosynthèse et donc la mort de la plante cible n’est en fait qu’une simple privation de nourriture.
herbicides auxiniques : Ces herbicides sont très mobiles dans le phloème (tissu conducteur de la sève nourricière des plantes). Le site d’action est censé être des récepteurs hormonaux à l’intérieur de la cellule. Les herbicides auxiniques ont sur les végétaux les mêmes effets que l’acide indolacétique qui régule la croissance des végétaux. Ce sont donc des inhibiteurs des hormones de croissance. Chez les plantes traitées par ces herbicides, on observe des déformations au niveau des tiges, des feuilles ou encore des épis. Les courbures des tissus végétaux ainsi que le grossissement des tiges compriment les vaisseaux et bloquent l’écoulement de la sève provoquant ainsi la mort de la plante .
Selon le moment d’application : Selon le stade de développement du végétal auquel l’herbicide sera appliqué on distingue deux catégories : les herbicides de pré-levée et les herbicides de post-levée. les herbicides de pré-levée sont appliqués entre le semis et la germination de la culture et des mauvaises herbes, c’est-à-dire avant qu’apparaissent les premières parties aériennes. Les doses d’application dépendent de la nature du sol et de sa composition (sol argileux ou sableux, matières organiques) et de son état physique (sols motteux, présence de paillis) .
les herbicides de post-levée sont appliqués en fonction du stade de développement des adventices. On distingue les produits de post- levée précoce dont le traitement est effectué avant la levée de la culture mais après celle des mauvaises herbes, et les produits de post- levée dont le traitement est effectué après la levée de la culture et des adventices. Dans ce dernier cas, on distingue deux catégories : les herbicides de post-levée de contact qui agissent en pénétrant directement dans les tissus, sans migration et les herbicides de post-levée systémique qui migrent à l’intérieur de la plante traitée après pénétration.
Impacts des herbicides l’environnement
Les herbicides sont majoritairement utilisés en agriculture afin d’améliorer les rendements agricoles en détruisant les espèces indésirables. Ils possèdent une toxicité qui leur permet de tuer les mauvaises herbes tout en protégeant les cultures. Cependant son utilisation massive a été une source de contamination des différentes sphères de l’environnement (eau, air et sol). Au moment de son application, l’herbicide se répartit entre la plante, le sol et l’atmosphère. Par pulvérisation, une partie de la quantité est susceptible d’être interceptée par les adventices et/ou la récolte. Le pourcentage de produit intercepté par la végétation dépend du stade de développement de la plante et de la densité des plantes . Les caractéristiques physico-chimiques du produit pulvérisé, c’est-à-dire de sa formulation et des éventuels adjuvants sont aussi des paramètres importants. Les herbicides représentent 60% des ventes totales mondiales de pesticides .
Pollution des eaux
Les produits appliqués sur les sols peuvent rejoindre les milieux aquatiques de surface par ruissellement ou érosion ou s’infiltrer dans la terre et atteindre les eaux souterraines par lixiviation ou lessivage.
D’après le rapport 2004-2005 de l’institut français de l’environnement (IFEN), les herbicides sont les pesticides les plus fréquemment détectés avec des teneurs élevées dans les eaux de surface et souterraines . Par exemple plus de 75% des pesticides détectés sur l’île française de la Réunion dans l’océan Indien sont des herbicides . En cas de pluie, les molécules d’herbicides sur les parcelles traitées subissent un lessivage qui les entrainent vers les eaux de surface et souterraines. Des études montrent qu’une partie de la pollution des eaux est due à l’utilisation de désherbants sur les trottoirs, les bordures des fossés, les abords des rivières . Ces molécules se retrouvent ainsi dans l’eau, sur les planctons et les micro-algues dont se nourrissent les poissons que nous consommons.
Pollution des sols
Les épandages d’herbicides se font principalement sur les sols. Ainsi, la majeure partie des désherbants se retrouvent soit directement ou indirectement sur le sol qui occupe une position centrale dans la régulation du devenir des pesticides dans l’environnement. Il joue un double rôle : le stockage et l’épuration . Les herbicides possèdent un très faible pouvoir de pénétration dans le sol. Ils subissent donc une dégradation directement sur le lieu d’épandage en fonction de leur persistance. A long terme, les quantités adsorbées peuvent être stabilisées plus ou moins provisoirement sous forme de résidus liés, qui sont non-extractibles : on parle alors de phénomène
d’immobilisation. Cette stabilisation des herbicides modifie la nature et les propriétés physico-chimiques du sol. La partie adsorbée par les argiles et les matières organiques subit des transformations entrainant la formation de nouveaux produits dérivés (sous-produits ou produits de transformation). Il peut s’agir d’une biotransformation par les microorganismes du sol et de l’eau, d’une hydrolyse, d’une oxydation, d’une photo-transformation induite par rayonnement solaire ou d’une métabolisation de la plante. Les activités microbiennes responsables de la dégradation des pesticides dans le sol dépendent de facteurs abiotiques intrinsèques comme le pH, l’humidité, la teneur en matière organique et extrinsèques comme les précipitations et les pratiques agricoles .
Toxicité de l’isoproturon
La solubilité élevée dans l’eau donne souvent lieu à des concentrations ndans les eaux de surface et les eaux souterraines dépassant la concentration maximale tolérable par la directive européenne pour l’eau potable (≤ 0,1ugL-1).
En raison de sa large utilisation, l’isoproturon et ses métabolites ont été détectés comme contaminants dans les eaux souterraines, les rivières et les ruisseaux, les lacs et l’eau de mer dans différentes régions du monde . L’isoproturon a une persistance relativement faible dans l’eau (demi-vie 12-32 jours) et est faiblement retenu par le sol. De ce fait, il peut rapidement atteindre les eaux superficielles et souterraines dans la période suivant son application. Des études de toxicité et d’écotoxicité menées sur l’isoproturon, ont révélé qu’il s’agit d’une matière active très toxique vis-à-vis des organismes aquatiques. Chez le poisson (poisson chat), on a observé une CL50 de 9mg L-1 pour l’isoproturon suite à une administration par voie orale après 96h ; une concentration efficace
médiane ou CE50 (21jours) égale à 0,025 mg.L-1 pour les algues ; une CE50 (9jours) égale à 0,1 mg.L-1 pour les mollusques. Chez les oiseaux l’isoproturon est nocif avec une DL50 supérieur à 3000mg.kg-1 par voie orale. D’après l’institut national de recherche et de sécurité (INRS) l’isoproturon présente une faible toxicité aiguë chez les rats et le chien. D’ailleurs, des études ont révélé que la DL50 de l’isoproturon chez le rat est égale à 1826 mg kg-1 suite à une administration par voie orale . Chez le chien par contre, aucune mortalité n’a été observée après une administration unique de 1000mg kg-1 (dose maximale testée). De nombreuses études subchroniques (durée intermédiaire entre une exposition aiguë et une exposition chronique) par administration orale ont été réalisées via l’alimentation chez les rats et le chien et par gavage chez le singe. A long terme, une anémie hémolytique est observée à partir de 800 mg.kg-1, chez le rat, 500 mg.kg-1, chez le chien et 150 mg.kg-1 chez le singe . Les DL50 par voie cutanée chez le rat, le lapin et le cobaye sont supérieures à 2000mg.kg-1. La CL50 chez le rat pour une exposition du corps de 4 heures est supérieure à 1,95mg.L-1.
Chez l’homme, l’isoproturon est irritante pour les yeux et la sphère respiratoire. Des nausées, vomissements, douleurs et diarrhées peuvent survenir en cas d’ingestion massive.
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES HERBICIDES
I-1. Définition du terme herbicide
I-2. Utilisation des herbicides
I-3. Classification des herbicides
I-3.1. Selon le mode d’action
I-3.2. Selon le moment d’application
I-3.3. Selon la famille chimique
I-4. Devenir et impacts des herbicides dans l’environnement
I-4.1. Devenir des herbicides dans l’environnement
I-4.2. Impacts des herbicides l’environnement
I-4.3. Effet des herbicides sur la santé humaine
I-5. L’ISOPROTURON (IPU)
I-5.1. Synthèse de l’isoproturon
I-5.2. Propriétés physico-chimiques de l’isoproturon
I-5.3. Mode d’action de l’isoproturon
I-5.4. Toxicité de l’isoproturon
I-5.5. Mécanisme de dégradation de l’isoproturon
CHAPITRE II : METODES D’ANALYSE DE L’ISOPROTURON
II-1. Introduction
II-2. Méthodes chromatographiques
II-2.1. Chromatographie liquide (CL)
II-2.2. Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
II-3. Méthodes spectroscopiques
II-3.1. Spectroscopie Infra-Rouge (IR) et de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
II-3.2. Méthodes fluorimétriques
II-4. Autres méthodes
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES