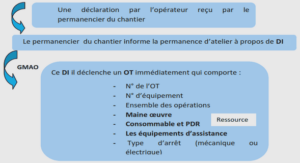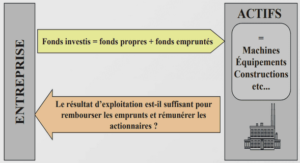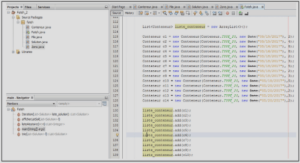Impacts de la négligence sur le développement
La négligence a des effets majeurs sur le développement des enfants qui en sont victimes (Cicchetti et Barnett, 1991 ; Glds et al. , 1997; Glaser, 2000; Higgins, 2004; Berzenski et Yates, 20 Il). Ces conséquences sont nombreuses et variées et peuvent affecter toutes les sphères développementales, notamment biologique, neurologique, sociale, psychologique et comportementale (van IJzendoorn, Schuengel et BakermansKanenburg, 1999; Cook et al. , 2005; D’Andrea et al., 2012). Entre autres, la négligence peut avoir un impact au plan cognitif tel que sur les aptitudes de planification, de résolution de problèmes et d’ encodage de la mémoire (Glaser, 2000; Schore, 2001 ; Nolin et Laurent, 2004). Il a été démontré que les enfants négligés peuvent présenter des comportements réactionnels de type dépressif, impulsif et agressif (Éthier et al., 2004; De Bellis, 2005 ; D’Andrea et al., 2012). De plus, la difficulté à identifier les émotions devient quant à elle un défi de taille dans la gestion des relations sociales (D’Andrea et al. , 2012; Runyon, Deblinger et Steer, 2014). Dans son fonctionnement global, l’enfant négligé peut présenter des difficultés de langage, des troubles d’apprentissage et de comportements (Shonk et Cicchetti, 2001; Schore, 2001 ; Nolin et Laurent, 2004). Selon des méta-analyses de van IJzendoorn et al. (1999), les enfants négligés sont plus sujets à développer un patron d’attachement désorganisé. Il s’agit d’environ 51 % des enfants qui sont sujets à développer ce type d’ attachement, contrairement à 15 % dans la population normative. La négligence a pour effet de freiner considérablement la construction cohérente de modèles internes opérants du nourrisson ou du jeune enfant (Schore, 1996; Glaser, 2000; Macfie, Cicchetti et Toth, 2001). La réponse de stress due aux périodes d’ abus devient le mécanisme adaptatif à des dynamiques potentiellement dangereuses, pouvant jusqu’ à laisser des symptômes traumatiques permanents (De Bellis, 2001; Schore, 2009; D’Andrea et al. , 2012).
L’état de stress post-traumatique (ESPT)
La maltraitance est un important prédicteur de l’ESPT (Hulette et al. , 2008; Putnam, Carlson, Douglas et Marmar, 1998; Shenk, Putnam et NolI, 2012; van der Kolk, 2005). Des symptômes post-traumatiques sont observés chez la grande majorité des enfants maltraités, bien que peu d’entre eux présentent l’ensemble des critères diagnostiques de l’ESPT (Briere et Spinazzola, 2005; Putnam et al., 1998). Pour ce qui est des enfants négligés, ils sont également à risque de développer des symptômes associés à l’ESPT (De Bellis, 2005; Milot et Éthier, 2010; Olds et al. , 1997), laissant supposer que l’ omission de réponse aux besoins de base place le stress causé par la négligence dans le spectre de l’ événement traumatisant et répétitif (Cook et al. , 2005; De Bellis, 2005; Terr, 1991). Comme menace à l’ intégrité psychologique, la négligence peut causer une forme sévère de trauma en faisant émerger une myriade de symptômes chez l’enfant (D’Andrea et al. , 2012; Éthier et Milot, 2009; Nolin et Laurent, 2004; Milot et al.,2010) .
Le DSM-5 définit l’ESPT comme l’état d’un individu ayant été confronté à un ou des événements traumatiques reliés à la mort, des blessures graves, ou une menace à l’intégrité physique (American Psychiatrie Association [APA], 2013). L’ ESPT inclut la triade classique des symptômes d’intrusion, d’évitement et d’hypervigilance, telle que proposée d’abord dans le DSM-I11 et le DSM-IV (A PA, 2000). Toutefois, les critères diagnostics de l’ESPT du DSM-5 comprennent un quatrième critère propre aux cognitions et à l’humeur et inclut certains comportements tels que les croyances ou les attentes négatives persistantes à propos de soi-même ou des autres, ainsi que certaines cognitions qui amènent l’ incapacité persistante de ressentir des émotions (APA, 2013).
L’hypervigilance se caractérise par une surréactivité omniprésente. L’enfant démontre une forte irritabilité ou des réactions exagérées pouvant devenir des comportements imprudents ou autodestructeurs. Elle peut être génératrice d’ épisodes de sursauts exagérés, des difficultés de concentration ainsi que des troubles du sommeil (A PA, 2000).
L’intrusion est l’envahissement incessant des pensées concernant la période d’abus. Les symptômes peuvent se manifester par des souvenirs répétés, des cauchemars, le sentiment de revivre l’abus, des hallucinations, des flash-backs (réactions dissociatives). Elle s’accompagne généralement d’ une détresse physiologique face à des indices évoquant un aspect de la situation traumatique (APA, 2000).
L’évitement rassemble les efforts conscients que fait l’enfant pour éviter les stimuli relatifs aux abus vécus. Il peut s’agir de l’évitement de pensées, de conversations, d’activités, d’endroits ou de personnes, de l’oubli d’aspects importants du traumatisme, d’une réduction de l’intérêt et des affects ou d’attachement d’autrui (APA, 2000).
La dissociation est définie comme une perturbation de certaines fonctions cognitives en lien avec la conscience, la mémoire, l’identité et les perceptions (Putnam et al. , 1998; Lanius, Brand, Vermetten, Frewen et Spiegel, 2012). Elle peut se manifester sous un éventail de formes telles que l’amnésie d’un événement passé, la dépersonnalisation ou la déréalisation (perception de son identité ou d’ un monde extérieur irréel) (Putnam et Peterson, 1994). La dissociation est fortement associée à un type d’attachement désorganisé (Cook et al., 2005 ; van IJzendoorn et al., 1999). Pour les enfants victimes de négligence, des réactions dissociatives peuvent devenir une stratégie d’adaptation à la situation ou une façon de faire disparaître les pensées et sentiments de détresse liés aux événements (Hulette et al. , 2008; Putnam et al., 1998). Ceci explique en partie la forte présence de dissociation chez ces enfants en comparaison à la population générale (Hulette et al. , 2008; Macfie et al. , 2001 ; Putnam et Peterson, 1994).
Psychopathologie développementale
Selon l’ approche développementale, plusieurs prinCipes guident le développement, notamment l’ équifinalité et la multifinalité (Perret et Faure, 2006).
L’équifinalité est la possibilité que plusieurs personnes ayant une trajectoire différente peuvent vivre des situations similaires. Quant à lui, le principe de multifinalité suppose que des personnes vivant une même situation peuvent avoir une réaction différente (Glaser, 2000; Sroufe, 1997). Dans cette perspective, l’individu est considéré comme un individu participant à son développement et à l’ intégration de ses processus adaptatifs (Olds et al., 1997). L’impact des situations vécues devient des patterns d’ adaptation et, par conséquent, ces patterns influencent directement son développement biopsychosocial (De Bellis, 2001; Perret et Faure, 2006; Runyon, Faust et Orvaschel, 2002).
Plusieurs caractéristiques intrinsèques à l’ enfant peuvent expliquer ces différences: son âge, son sexe, ses gènes, son développement cérébral, son profil d’attachement, son tempérament et ses habiletés sociales (Mc Crae, Chapman et Christ, 2006; Nolin et Laurent, 2004; Shonk et Cicchetti, 2001). Plusieurs facteurs extrinsèques peuvent aussi interférer: la qualité relationnelle, la réponse aux besoins, la chronicité/sévérité de l’ abus ainsi que le type d’ abus (Berzenski et Yates, 2011; Runyon et al., 2002; Steinhauer, 1997). Considérant que les enfants se distinguent autant sur les facteurs biologiques qu’ environnementaux, il est possible de supposer que certains enfants négligés ne développent pas nécessairement un ESPT, même s’ ils peuvent en développer quelques symptômes. Par contre, il est également possible de supposer que les enfants qui développent un ESPT aient une composition variée des symptômes, présentant donc des profils distincts de symptômes traumatiques.
Contexte théorique |