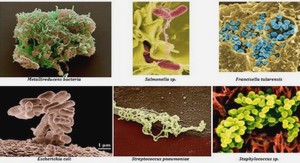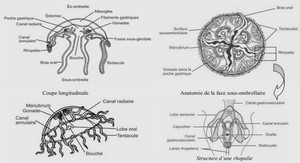Matériel anthropométrique: Variables anthropométriques et techniques de mesures
Les enfants se développent de façon continue, dès les premiers jours de la vie jusqu’au stade mature. Parmi tous les indicateurs utilisés pour apprécier la croissance et le développement d’un enfant, le poids, la taille et le périmètre crânien sont pris comme variables anthropométriques.
Les mesures anthropométriques des enfants ont été prises en même temps que l’enquête auprès des mères.
La mesure des paramètres comme le poids (P), la taille (T) et le périmètre crânien ou céphalique (PC) en pédiatrie est fondamentale [Sempé 1984], [Sempé et Bouchard, 2000]. Le matériel du laboratoire d’Anthropologie Physique prélevé de la trousse anthropométrique et aussi celui du centre CENHOSOA ont été utilisés. Il est composé essentiellement de balances, de toise et d’un mètre ruban.
Croissance staturo-pondérale
D’une façon générale, les facteurs des variations de croissance sont : génétiques, nutritionnels, énergétiques et endocriniens. L’accélération de la vitesse de croissance des nourrissons (0 à 6 mois) décline progressivement de 0 à 2 jours. Cette croissance est due à la dépendance essentielle de la nutrition, apport énergétique, de la production des hormones thyroïdiens, facteurs génétiques et des produits de nourriture disponibles dans le ménage.
Facteurs nutritionnels : La nutrition maternelle soit l’allaitement maternel exclusif (AME) joue un rôle important sur la croissance et le développement de l’enfant. Le lait maternel fournit aux jeunes enfants d’importants apports d’énergie, de protéines, de fer, de vitamines A et C et de calcium. Il protège contre les maladies. Mais, la plupart des mères ne respectent pas les recommandations de l’OMS et le Ministère de la santé concernant la durée d’allaitement maternel car la majorité des mères ont une habitude d’introduire déjà les aliments de complément dès que leurs enfants sont un peu plus âgés (compris entre quatre et cinq mois). Ces aliments de sevrage sont généralement pauvres en protéine et lipide ; en plus, ils sont souvent contaminés par des agents responsables de la diarrhée qui engendrent directement la malnutrition des enfants. Pour les enfants 0 à 5 mois : la croissance staturo-pondérale est influencée par des facteurs nutritionnels et environnementaux. Tant que l’enfant est alimenté exclusivement au sein [Ramarojaona et Razanaparany, 1986], il peut croître à l’image des enfants du monde [langue, 2002] parce que la qualité du lait maternel apporte une valeur énergétique (glucide, lipide, protide) élevée au cours des 6 premiers jours de vie.
Les courbes pondérales de 2014 diffèrent de celles de Randrianalimanga N. en 2003. A partir du second jour de la naissance les valeurs pondérales sont plus faibles . Une Discussion explication valable pour expliciter les deux coïncidences est l’environnement de crise politique à Antananarivo capitale de Madagascar, qui n’a pas pris fin en cette période.
Facteurs génétiques : La croissance pondérale et staturale dépendent d’un facteur génétique [Susanne, 1971] : la croissance staturale est un phénomène intimement lié à des facteurs génétiques, sur la qualité de l’environnement [Ulijaszek, 1998] et du niveau de développement social des parents [Rakotosamimanana, 1996]. L’influence génétique est nettement visible par rapport aux autres facteurs environnementaux (alimentation et climat).
Croissance pondérale des nouveau-nés du CENHOSOA
Au cours du développement somatique d’un enfant, ce dernier subit deux mécanismes de transformations suivies d’un rythme de croissance qui se caractérise par l’accélération, le ralentissement et ou un arrêt de la croissance.
La connaissance objective de la croissance biométrique dès la naissance constitue un «outil infaillible» qui renseignera sur la conduite à tenir afin de parfaire cet état de santé.
Les courbes de croissances pondérales ont servies à l’interprétation graphique pour la compréhension des problèmes de l’enfant qui avait des difficultés à récupérer son poids de naissance. Le ralentissement de croissance mérite une explication. La paupérisation de la population et la crise économique vécue en permanence font partie des causes d’anomalies de croissances pondérales [Randrianalimanga Raharivelo N., 2011]. La suite de la croissance après la naissance est rapide à cause de l’abondance du lait maternel [Kiehl E. M., Anderson G. C., Wilson M. E., Fosson L., 1996].
Comparaison des variables anthropométriques du nouveau-né en fonction des différentes catégories socio-économiques au CENHOSOA
Les calculs des valeurs de «t» du test de Student-Fisher indiquent qu’il existe des caractères qui permettent de différencier les catégories entre elles. Dans ces cas, les moyennes mêmes très voisines représentent deux échantillons totalement différents et bien distincts. Concernant le poids de naissance, pour CI (2,967kg), CII (3,083 kg) et CIII (3,011kg) avec p>0,05, l’hypothèse nulle ne peut pas être rejetée. La différence entre les moyennes pondérales n’est pas significative.
Pour le périmètre crânien, des valeurs voisines à travers les catégories CI (33,682cm); CII (33,818cm) et CIII (33,769cm) n’ont pas permis de rejeter l’hypothèse nulle car p>0,05. La différence entre les périmètres crâniens n’est pas significative. Par contre la taille moyenne de CII (49,182cm) et CIII (44,759cm) indique qu’il existe une différence significative, l’hypothèse nulle est rejetée avec p<0,05.
Conclusion : Le test « t » de comparaison des moyennes anthropométriques a permis de démontrer que les catégories CI, CII et CIII ne présentent pas des différences significative. Elles ont été mises en évidence par les paramètres poids et périmètre crânien.
Concernant la taille, CII et CIII présentent bien des différences hautement significatives. Il semble donc que les facteurs socio-économiques interviennent dans certains caractères et s’ajoutent aussi aux effets des caractères héréditaires [Randrianalimanga Raharivelo N., 1999]. Est-ce que CII et CIII seraient deux populations issues de deux pools géniques différentes.
Facteurs déterminant l’état nutritionnel des enfants
Malnutrition selon le sexe : Le dimorphisme sexuel a été bien visible par la supériorité physique et la dominance morphologique du sexe masculin [Randrianalimanga Raharivelo N., 1999]. La courbe chez les garçons est toujours au dessus de celle des filles.
Les observations, dès les premiers jours de vie, ont démontré que les enfants de sexe masculin étaient plus vulnérables et plus sensibles aux conditions de l’environnement (mésologiques) [Randrianalimanga Raharivelo N., 1999].
En effet, les résultats observés au FKT Ambohipo avaient montrés que la majorité des malnutris sont les garçons (tableau XI). Ces résultats rejoignent les valeurs au CENHOSOA de Randrianalimanga Raharivelo N., Rakotosamimanana B. et Razanaparany M. en 2001.
Malnutrition selon l’âge :
La maigreur ou émaciation ou wasting : Un enfant sur dix est maigre. Une fille sur quatre présente un déficit pondéral, contre un garçon sur trois. Le retard de croissance se présente pour les deux sexes une fois sur trois enfants. Ces résultats anthropométriques rejoignent celles de Randrianalimanga Raharivelo N. en 1999.
Retard de croissance : Le retard de croissance ou stunting se traduit par une taille trop petite pour l’âge. Cette situation de la malnutrition chronique est la conséquence d’une alimentation inadéquate et ou de maladie infectieuse pendant une période relativement longue ou qui s’est manifestée à plusieurs reprises. Le niveau de vie du ménage semble avoir un impact sur la prévalence de la malnutrition chronique car, cette forme de malnutrition est le reflet non seulement de la situation sanitaire passée de l’enfant, des pratiques alimentaires mais aussi du caractère héréditaire. L’attention des parents est attirée car d’après Maire B. et coll. en 2008 : « Le retard de croissance staturale n’est plus rattrapable à partir du vingt-quatrième mois de l’enfant ». Chez les enfants d’Ambohipo, il y aurait la malnutrition chronique.
Insuffisance pondérale : Le type de cette malnutrition est déjà prononcé. D’après l’EDS 2010, les 76,5% de la population malgache sont classés comme pauvres c’est pourquoi leur niveau de consommation est au-dessous du seuil de 468 000 Ariary par personne par an. Les femmes allaitantes vivent dans la pauvreté. Les ménages se heurtent toujours à la réduction de la ration alimentaire et ce sont la mère et l’enfant qui sont les victimes de cette pratique. Jellife en 1978 confirme que : « la réduction de la ration alimentaire entraîne une diminution de la quantité de lait secrété ». L’amélioration de la santé infantile dépend en grande partie du statut de la mère (économique, social) [Rakotondrabe, 2000] et de son pouvoir d’action au sein de ménage [Rubin, 1990].
Les méthodes de présentations graphiques offertes par le logiciel WHO Anthro sont multiples. Si Rakotoarimanana N. H. en 2014 et Rajaobeliarisoa H. en 2015 ont utilisé les représentations en courbes de GAUSS (aire de distribution en cloche), notre étude a opté sur le type de présentation en courbes de croissances « Chemins de Santé » retracés dans les carnets de santé des enfants et adopté par le ministère de la santé qui est simple à interpréter et facile à lire pour les mères de famille.
Table des matières
INTRODUCTION
I – CADRE D’ETUDE
II – METHODOLOGIE
II.1 – Echantillonnage et types d’études
II.1.1- Type transversal
II.1.2- Type longitudinal
II.2 – Période d’étude
II.3 – Mode de collecte de données
II.3.1 – Sujets (matériel humain)
II.3.1.1 – Femmes en âge de procréer
II.3.1.2 – Enfants en bas âges
II.3.2 – Matériel biologique
II.3.3 – Matériel anthropométrique: Variables anthropométriques et techniques de mesures
II.3.3.1 – Balances pour mesurer le poids
II.3.3.2 – Toise pour mesurer la taille ou la stature
II.3.3.3- Mètre ruban pour mesurer le périmètre crânien
II.3.4- Matériel informatique
II.3.4.1- Ordinateurs personnels – personal computer (PC)
II.3.4.2- Programmes – logiciels et analyses statistiques
II.3.5 – Fiches d’enquêtes, fiches de consultations et registres Hospitaliers
II.4 – Indicateurs de développements humains
II.4.1 – Indicateurs anthropométriques d’évaluation de l’état nutritionnel
II.4.2- Indice de Masse Corporelle (IMC), indice de corpulence ou Body Mass Index (BMI) des
femmes en âge de procréer
II.4.3- Indice Synthétique de Fécondité
II.4.4- Groupes Erythrocytaires
II.4.5- Pauvreté et le seuil de pauvreté
II.5- Représentations graphiques des résultats
III – RESULTATS
III.1- Identifications Biologiques
III.1.1- Groupes érythrocytaires : Système ABO
III. 1.1.1- Fréquences géniques du groupe ABO à l’Université d’Antananarivo en 2013-2014
III.1.1.2- Fréquences géniques du groupe ABO chez les parturientes du CENHOSOA en 2014
III.1.1.3- Exemple concret de résultat d’examen de groupage chez une des étudiantes enquêtées
III.1.2- Paramètres Anthropométriques infantiles au CENHOSOA en 2014
III.1.2.1- Croissance pondérale des nouveau-nés au CENHOSOA en 2014
III.1.2.2- Croissance pondérale des nouveau-nées du sexe masculin et du sexe féminin
III.1.2.3 – Croissance pondérale individuelle chez deux nouveau-nés de sexe masculin
III.1.2.4- Exemples de croissances pondérales individuelles de deux nouveau-nés de sexe masculin en difficulté
III.1.2.5- Croissance pondérale des nouveau-nés en 2014 par rapport à celle de 2000-2003
III.1.2.6- Poids, taille et périmètre crânien chez lez nouveau-nés selon les différentes catégories socio-économiques en 2014
III.1.3- Paramètres Anthropométriques des femmes en âge de procréer à Ambohipo et à l’Université
d’Antananarivo
III.1.3.1- Poids
III.1.3.2- Taille
III.2- Indicateurs de développement humain : valeurs materno-infantiles (2008- 2014)
III.2.1- Indicateur anthropométrique individuel de l’état nutritionnel d’un nouveau-né de sexe masculin P/T au CENHOSOA
III.2.2- Indicateur anthropométrique individuel de l’état nutritionnel d’insuffisance pondéral P/A d’un nouveau-né de sexe masculin au CENHOSOA
III.2.3- Indicateur anthropométrique individuel de l’état nutritionnel T/A de retard de croissance d’un nouveau-né de sexe masculin au CENHOSOA
III.2.4- Indicateurs anthropométriques de l’état nutritionnel des enfants d’Ambohipo de 2008
III.2.5 – Caractéristiques sanitaires des femmes en âges de procréer en 2014
III.2.5.1- Corpulence : Indice de Masse Corporelle (IMC), indice de corpulence ou Body Mass
Index (BMI) des femmes en âge de procréer
III.2.5.2- Issues de grossesses
III.2.5.3- Indice Synthétique de Fécondité (ISF) à Ambohipo et au CENHOSOA (2008-2014)
III.2.6- Caractéristiques socio-économiques
III.2.6.1- Répartition des ménages selon la taille : membres composant la famille
III.2.6.2- Ages et Catégories socioprofessionnelles des femmes en âge de procréer du CENHOSOA en 2014
III.2.6.3- Durée de séjour à la maternité du CENHOSOA après l’accouchement 2014
III.2.6.4- Situation de dépenses par famille et statut économique individuel
IV – DISCUSSION
IV.1- Groupes Erythrocytaires ABO au CENHOSOA et à l’Université d’Antananarivo
IV.2 – Croissance staturo-pondérale
IV.2.1 – Facteurs nutritionnels
IV.2.2- Facteurs génétiques
IV.2.3- Croissance pondérale des nouveau-nés du CENHOSOA
IV.2.4- Comparaison des variables anthropométriques du nouveau-né en fonction des différentes
catégories socio-économiques au CENHOSOA
IV.2.5- Poids et taille des femmes en âges de procréer à Ambohipo et à l’Université d’Antananarivo
IV.3 – Facteurs déterminant l’état nutritionnel des enfants
IV.3.1- Malnutrition selon le sexe
IV.3.2 – Malnutrition selon l’âge
IV.4- Indicateurs de développements des femmes en âge de procréer
IV.4.1- Indice de Masse Corporelle
IV.5 – Caractéristiques sanitaires et socio- économiques
IV.5.1– Occupation des parents
IV.5.2 -Santé reproductive des mères
IV.5.3–Catégorie sociale
IV.5.4- Durée du séjour à la maternité
IV.5.5- Dépenses monétaires
V- RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES