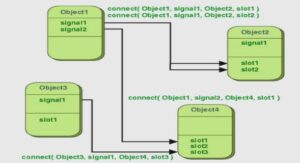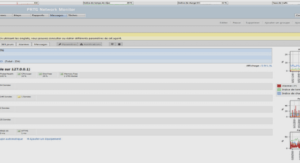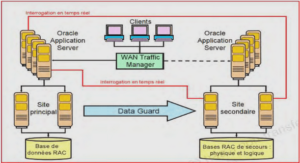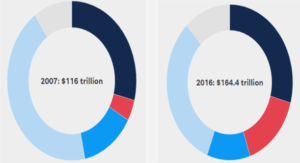Identification par PCR des espèces du complexe Anopheles gambiae
Amplification par PCR
Le principe de la PCR (polymerase chain reaction ou réaction de polymérisation en chaine) consiste à démultiplier l’ADN en un nombre de copies suffisamment élevé pour être révélé sous un rayon ultraviolet (UV). De façon plus pratique, cette méthode consiste à répéter cycliquement les phases de dénaturation correspondant à l’ouverture du double-brin d’ADN, d’hybridation ou fixation des amorces à la matrice et d’extension qui est l’ajout des bases complémentaires grâce à un thermocycleur (Mullis et al, 1986). Elle permet d’obtenir un très grand nombre de copies d’une séquence d’ADN choisie. Ce cycle est répété un grand nombre de fois pour obtenir une multiplication exceptionnelle de la séquence d’ADN cible.
Ainsi, l’amplification des séquences d’intérêt est réalisée dans un volume réactionnel de 26,05µl contenant 11,1µl d’eau ultra-pure, 5µl de tampon 5x coloré, 2,5µl de dNTP, 0,3µl de MgCl2, 1µl de chaque amorce, 0, 15µl de Taq polymérase et 1µl d’extrait d’ADN. La PCR est réalisée dans les conditions suivantes: une dénaturation initiale de 5min à 95°C, suivi de 30 cycles composés chacun d’une dénaturation de 30s à 95°C, d’une hybridation des amorces de 30s à 58°C et d’une élongation de 30s à 72°C, et enfin d’une élongation finale de 5min à 72°C.
Electrophorèse et révélation
Electrophorèse
A l’issue de l’amplification, le résultat des PCR a été migré sur gel d’agarose à 2% (2g d’agarose + 100 ml de TBE 1X).
La préparation du gel à 2% s’est faite par rajout de 2g d’agarose à 100ml de tampon TBE 1X, mesuré respectivement à l’aide d’une balance et d’une éprouvette graduée. Le mélange mis dans un erlenmeyer en verre a été porté à ébullition au four à micro-onde pendant 5 minutes pour l’obtention d’une solution translucide. Celle-ci a été refroidie avant d’y ajouter 5l de Biotium. Le mélange ainsi obtenu a été bien homogénéisé avant d’être coulé dans une cuve à gel contenant deux peignes préalablement placés dans la moule. Ce mélange est ensuite laissé à température ambiante pendant une heure. Après solidification, les peignes ont été enlevés et le gel a été immergé dans une cuve à migration remplie de TBE 1X.
Les produits de PCR ont été individuellement déposés dans les puits formés dans le gel, 2μl de marqueur de taille de 100pb ont été déposés dans le premier et le dernier puits. Environ 1,5ul d’amplicon du témoin négatif et du témoin positif ont été respectivement déposés dans le deuxième et le troisième puits. Le même volume des échantillons amplifiés a été déposé dans les puits restants puis le générateur réglé au préalable à 80 volts et 400 milliampères a été mise en marche pendant 90 à 120 mn.
Révélation
Les fragments d’ADN amplifiés de tailles différentes sont séparés par électrophorèse sur un gel d’agarose avec marqueurs de taille. La révélation après la migration a été faite au niveau de la table à UV (GelDoc) relié à l’ordinateur pour l’annotation et la sauvegarde des photos. Les brins d’ADN sont visualisés par fluorescence grâce à l’ajout du GelRed (Biothium).
Ainsi, Les tailles de bandes attendues pour l’identification des espèces du complexe An. Gambiae sont les suivants :
• 221 pb chez An. gambiae ;
• 387 pb chez An. arabiensis ;
• 426 pb chez An. coluzzii ;
• 528 pb chez An. melass et
• 636 pb chez An. quadriannulatus.
Pour une éventuelle recherche des gènes kdr-e et kdr-w trois bandes d’ADN sont aussi attendues:
• la bande commune (314 pb),
• la bande susceptible (214 pb) et
• la bande résistante (156 pb).
RESULTATS ET DISCUSSION
Résultats globaux
Entre septembre et décembre 2018, un total de 2 208 spécimens adultes d’An. gambiae s.l. issues d’un élevage à l’insectarium ont été testés. Le statut des populations d’An. gambiae s.l. face au chlorfénapyr a été déterminé au Sénégal dans cinq (5) districts sanitaires: Diourbel, Dianké Makha, Koungheul, Nioro, ZAC Mbao.
Tous les tests ont été faits avec les bouteilles du CDC.
Les femelles d’An. gambiae s.l. récoltées ont été exposées au chlorfénapyr par le test en bouteilles CDC, suivi d’une observation à 72h. Ainsi, les résultats des tests ont montré une sensibilité à la chlorfénapyr des populations dans toutes les localités. Cependant cette sensibilité diffère en fonction de la concentration de l’insecticide, de la durée d’exposition et de la localité. Les résultats ont été ainsi validés par ceux obtenus avec les bouteilles témoins. La mortalité dans les bouteilles témoins ayant été toujours inférieure à 3%, une correction par la formule d’Abbott n’a pas été effectuée. Les données des bio-essais ont été saisies sur des fiches d’enregistrement dont un exemplaire est présenté en (annexe3)