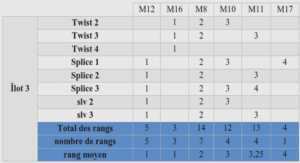Griffintown à Montréal
Le quartier de Griffintown situé dans le Sud-Ouest de Montréal a contribué de manière inéluctable à l’essor économique de la ville. Il est l’un des plus anciens quartiers de la Ville- Marie12 et est le berceau de la population ouvrière irlandaise. Durant le XVIIème et XVIIIème siècle le secteur est consacré presque exclusivement au pâturage pour le bétail et ce n’est qu’au début du XIXème siècle que le quartier amorcera son entrée dans l’ère industrielle déjà initiée en Occident. Dès lors, le gouvernement procèdera à la démolition des fortifications entourant le quartier, unissant Griffintown à la vie urbaine de Montréal. Sous les directives de Mary Griffin, un plan de lotissements aux dimensions régulières, fractionnées à parts égales est créé par l’arpenteur Louis Charland13. Le quartier de Griffintown devient rapidement le berceau de la révolution industrielle montréalaise et compte dès 1825, 1192 habitants, 13 usines et entrepôts, ainsi qu’un faubourg de 137 maisons ouvrières. Profitant de cette dynamique sociale et économique, l’édification du canal de Lachine conforte Griffintown dans sa position industrielle stratégique et encourage l’immigration d’une importante main d’œuvre principalement constituée d’irlandais. Le canal Lachine est par la suite doublé en largeur et en profondeur entre 1843 et 1848 afin de donner accès aux bateaux provenant du fleuve. Le quartier compte alors 29 manufactures et des milliers d’habitants issus d’une classe ouvrière assez défavorisée.
Lors de la deuxième moitié du XIXème siècle, l’explosion du développement des manufactures et des industries prend alors un tournant encore plus prononcé et l’on assiste alors à une diversification des champs d’activités notamment vers le travail du métal et du bois, du travail du cuir, des produits chimiques, des équipements ferroviaires… Malgré l’éclatement de la grande crise en 1873 et des conditions de vie de plus en plus précaires pour les ouvriers, le quartier sortira indemne de cette période difficile et connaîtra un second souffle grâce aux infrastructures de transport qui positionnent stratégiquement Griffintown comme pôle des échanges et des débarquements de marchandises jusqu’en 1920. Une stagnation se fait alors ressentir dès le début du XXème siècle, puis le canal sera rendu obsolète en 1959 avec le développement de la voie maritime du Saint-Laurent. Malgré les efforts de la commune de Montréal pour faire survivre le quartier en le re-zonant en zone industrielle, cette décision sera vaine puisqu’elle ne contribuera pas à conserver les industries dans le secteur. En 1965, avec l’ouverture de l’autoroute Bonaventure, le quartier se retrouve complètement isolé du reste de la ville. Puis en 1970, à la fermeture du Canal Lachine, la plupart des entreprises sont contraintes de fermer leurs portes et 20 000 personnes perdent leurs emplois. La population ouvrière de Griffintown quitte à regret le quartier et s’en suit la destruction de nombreux bâtiments.
L’émergence du projet urbain
Depuis 2004, Griffintown fait partie des 26 secteurs de planification détaillés par le Plan d’Urbanisme de la ville de Montréal. D’une superficie de 84 hectares, il a été identifié comme étant le « projet urbain du centre-ville » par le plan de développement de Montréal14. Ainsi, un PPU (Programme Particulier d’Urbanisme) a alors été élaboré à l’échelle du quartier. Deux portions ont alors fait l’objet de démarches de planification urbaine ayant mené à l’adoption de documents spécifiques. Le PPU Griffintown – Secteur Peel Wellington est adopté par la ville de Montréal en 2008 et vise à établir les règles de développement pour une portion du quartier comprise entre la rue Ottawa, le canal Lachine, la rue du Séminaire et l’autoroute Bonaventure et d’une superficie d’environ 23 hectares. Puis en 2009, la ville adopte un règlement afin d’encadrer le redéveloppement d’un ancien centre de tri postal vacant depuis 1997. Ce règlement vise à L’objectif est alors de faire de Griffintown un quartier respectueux de son identité tout en créant un nouveau milieu de vie mixte offrant un cadre de vie agréable, promouvant les notions de proximité, de convivialité ou encore de sécurité. D’en faire un quartier aménagé pour reconnaître et encourager les nouveaux modèles de comportement urbain15. En somme être en accord avec les grands principes du développement durable et donner un renouveau à un quartier en décroissance.