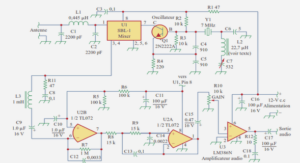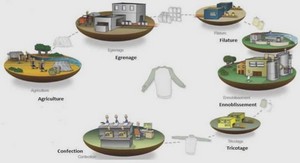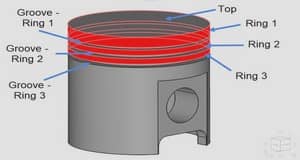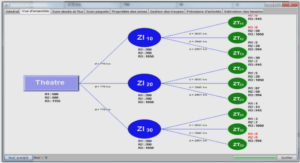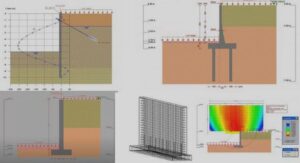Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
La superposition entre ordre social et ordre racial
Comme l’explique Barry Chevannes, l’esclavage dans les Antilles repose à la fois sur la coercition physique et sur une armature idéologique. Dans un contexte où les esclaves constituent l’immense majorité de la population des îles, la violence physique pure s’avère insuffisante. Le préjugé de couleur, en créant les conditions de l’acceptabilité d’une relation fondamentalement inégale entre maître et esclave, tient le rôle de justification du système esclavagiste et assure la pérennité de l’ordre social48. Dès le XVIe siècle, les rapports de contrainte économique et d’inégalité sociale sont, dans les Caraïbes, arrimés à un marqueur phénotypique qui les enracine au plus profond des corps. Ce processus est mis en lumière par Jean-Luc Bonniol qui explique comment, à la différenciation maître/esclave, s’ajoute une opposition raciale noir/blanc symbolisée par une « ligne de couleur49. » Le recours à l’esclavage dans les sociétés de plantation va de pair avec le développement d’un préjugé racial et l’institution progressive d’un système binaire associant la noirceur à la servitude et la blancheur à la liberté : « la segmentation raciale se juxtapose à la stratification socio-économique, déjà sanctionnée par une coupure juridique […]. La “race” finit donc par devenir consubstantielle à l’ordre esclavagiste, que l’on peut désormais qualifier de socio-racial50. » Dans un double mouvement, la socialisation du biologique génère des pratiques sociales qui, à leur tour, inscrivent le biologique dans l’ordre social et le verrouillent51. La « ligne de couleur » devient par conséquent une pièce essentielle au maintien de la hiérarchie de la plantation52. Rapports de classe et de « race » sont intimement liés, la confusion entre ordre racial et ordre social permettant de rationaliser l’inacceptable et de faire passer s’inspire ici des réflexions de Bourdieu qui observe dans un article publié en 1990 que le racisme « vise à imputer des différences sociales historiquement constituées à une nature biologique fonctionnant comme une essence d’où se déduisent implacablement tous les actes de l’existence ; […] travail millénaire de socialisation du biologique et de biologisation du social qui […] fait apparaître une construction sociale naturalisée […] comme la justification naturelle de la représentat ion arbitraire de la nature. » (Pierre Bourdieu, “La domination masculine”, Actes de recherche en sciences sociales, vol. 84, n° 1, 1990, p.12.) l’exploitation pour un fait inné et définitif53. La prohibition du métissage a pour but d’assurer la pérennité de cette hiérarchie socio-raciale en interdisant les unions susceptibles de brouiller cette frontière de la couleur54. Dans la pratique, la barrière s’avère toutefois perméable, dans la mesure où il est accepté que les hommes blancs entretiennent des relations (le plus souvent forcées) avec les femmes noires55. Face à l’inévitable émergence d’une population mulâtre, la hiérarchie raciale s’adapte, s’affine et donne lieu à une véritable « taxinomie sociale56 », où les nuances chromatiques constituent autant de catégories de métissage reliant les deux paliers raciaux que sont la noirceur » et la « blancheur57 ». La couleur de peau incarne un véritable « capital racial », comme en témoignent l’existence de stratégies de « blanchiment » dont l’objectif est d’assurer l’ascension sociale des générations futures58.
Dans cette perspective, la « race » ne constitue plus seulement un voile idéologique permettant de légitimer une systématisation de l’oppression, mais aussi un outil de contrôle des populations. La violence physique et symbolique exercée sur les corps captifs constitue à la fois une forme de « bio-pouvoir59 » – une tentative de disciplinarisation extrême des individus – et de « bio-économie60 » – un ordre social entièrement au service de l’exploitation économique. Ainsi Mbembe avance-t-il que les processus de racialisation visent à marquer ces groupes de population, […] à déterminer le plus exactement possible les emplacements qu’elles peuvent occuper […].
La race, de ce point de vue, fonctionne comme un dispositif de sécurité fondé sur ce que l’on pourrait appeler le principe de l’enracinement biologique par l’espèce. Elle est à la fois idéologie et technologie de gouvernement61. » Cette « gouvernementalité coloniale62 » et l’intériorisation des référents de sens raciaux qu’elle impose chez les dominés, passe par une scénarisation extrême de la violence. Pour assurer leur domination symbolique, les planteurs développent une « idéologie de la terreur63 » matérialisée par des dispositifs tels que les châtiments corporels et les structures carcérales64, la torture, la mutilation des morts65, les viols, ou encore la criminalisation de toute pratique culturelle perçue comme « africaine66 ». Ce spectacle de la punition corporelle et des exécutions participent simultanément à la mise en scène du pouvoir absolu du colon et à celle de l’infériorité des corps noirs67. Ainsi, nous dit Mbembe, le lien d’exploitation est-il « sans cesse produit et reproduit par le biais d’une violence de type moléculaire qui suture et sature la relation servile68. »
Les abolitions de l’esclavage durant la première moitié du XIXe siècle signent la fin officielle de cet ordre socio-racial. Pourtant, les régimes de pouvoir construits sous la société de plantation, ainsi que les catégorisations qui les sous-tendent, survivent à leur institution originelle. La conception racialisée des rapports sociaux a pris une importance telle dans l’imaginaire social qu’elle transcende les lois qui l’ont fondée et rend possible « le passage à une idéologie sans assise juridique69 ». Cette autonomisation du préjugé racial explique sans doute la longévité des schèmes idéologiques ayant participé à l’institutionnalisation de l’esclavage dans les sociétés antillaises. Bien plus que de constituer de simples rémanences, les catégorisations raciales continuent à réguler les rapports sociaux et font partie intégrante du processus de fabrication du Nous collectif dans l’imaginaire caribéen contemporain. « C’est en Sur le rôle central de la punition dans l’édification du système esclavagiste, voir Diana Paton, No Bond but the Law: Punishment, Race, and Gender in Jamaican State Formation, Durham and London, Duke University Press, 2004, notamment le chapitre 1. Voir également les exemples de sévices développés dans Harry Mephon, Corps et société en Guadeloupe : Sociologie des pratiques de compétition, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007, notamment pp.13-14.
La mutilation des cadavres des esclaves, et notamment des suicidés, constituait sans doute une des formes les plus extrêmes des tentatives de contrôle des esprits par les colons. De nombreux Africains, croyant en un retour à la « terre-mère » après la mort, commettaient des suicides sur les plantations. Les maîtres, dans le but de mettre un terme à ces tentatives désespérées et d’accroître leur emprise sur l’univers spirituel des esclaves, découpaient les cadavres, les pendaient aux arbres pour que leur esprit ne « s’échappent pas » vers l’Afrique et refusaient de les enterrer. Voir Vincent Brown, “Spiritual Terror and Sacred Authority in Jamaican Slave Society”, art. cit., pp.24-53.
En témoigne la criminalisation des religions étiquetées comme « africaines » à la fin du XVIIIe siècle, tel que le vaudou à Saint-Domingue (voir Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers, empoisonneurs : de Saint-Domingue à Haïti, Paris, Karthala, 1987.) et l’obeah dans la Caraïbe anglophone (voir Jerome Handler et Kenneth Bilby, Enacting Power: The Criminalization of Obeah in the Anglophone Caribbean, 1760-2011, Kingston, University of the West Indies Press, 2012.).
Kathleen Wilson, “The Performance of Freedom: Maroons and the Colonial Order in Eighteenth-Century Jamaica and the Atlantic Sound”, The William and Mary Quarterly, vol. 66, n° 1, 2009, p.52.
Achille Mbembe, Critique de la raison nègre, op. cit., p.36.
référence à l’essence du Blanc que tout Antillais est appelé à être perçu par son congénère », nous rappelle Frantz Fanon70. L’anthropologue R.T Smith décrit la société créole » anglophone des années 1960 comme étant « enracinée dans la domination politique et économique du pouvoir métropolitain, stratifiée par la couleur de peau et intégrée autour de la conception de la supériorité morale et culturelle de tout ce qui était anglais71. » Les deux courants de pensée fondateurs des études caribéennes, le pluralisme social de M.G Smith72 et la stratification sociale de Lloyd Braithwaite73, tout en développant des approches concurrentes, se rejoignent également dans la centralité accordée à la « race » dans l’analyse des structures sociales antillaises présentes. Celles-ci, nous dit Braithwaite, sont soumises à une double stratification : une segmentation socio-économique, organisée autour du pouvoir économique de l’individu, et une segmentation raciale, par laquelle une personne de teint clair bénéficie d’un prestige social plus important. Les rapports sociaux, poursuit l’auteur, sont sujets à une articulation permanente entre ces deux types de stratification, qui sont étroitement liés sans pour autant se juxtaposer74. La persistance de cette confusion entre ordre social et ordre racial est notamment illustrée par les travaux de Michel Giraud sur la Martinique. Le chercheur français y fait en effet le constat d’une « hypostase » entre le social et le racial : « les rapports de classe continuent d’être hypostasiés dans des relations de race qui les occultent et les justifient, et partant les fixent75. » La variable raciale prime dans la formation des clivages et constitue le langage par lequel le social s’exprime76. En montrant comment les catégorisations héritées du système de la plantation demeurent, selon des modalités renouvelées, consubstantielles à la production de l’ordre social contemporain, l’anthropologie caribéenne conforte notre postulat de départ selon lequel la construction d’Haïti en tant que problème public obéit à des logiques de racialisation.
De façon surprenante, s’il est démontré que les principes de la domination présents dans les sociétés antillaises reposent aujourd’hui encore sur la racialisation des rapports sociaux, cet aspect est relativement peu abordé sous l’angle du politique. De manière plus générale, la place et l’efficacité du marqueur racial dans la production de l’ordre politique contemporain n’est peu ou pas explicitée dans la littérature existante. Certes, certains auteurs y ont fait référence de manière plus ou moins directe. Jean-Luc Bonniol souligne que, dans les Antilles françaises, « la couleur a eu tendance à être utilisée comme emblème identitaire, et tout le débat culturel et politique […] s’en est trouvé affecté77 ». Holger Henke et Fred Réno, dans leur ouvrage collectif sur la culture politique caribéenne, constatent que « Dans le contexte de la Caraïbe il n’est guère possible de saisir [la culture politique] dans sa globalité sans mentionner ses liens spécifiques avec la “race” et la couleur78. » Fred Constant présente une analyse fouillée sur les processus de politisation des constructions identitaires dans l’espace caribéen, mais refuse de parler clivages raciaux, au profit de la notion d’ « ethnicité79 ». Ce contournement sémantique apparait d’autant plus déconcertant au regard du contexte socio-historique étudié que l’auteur n’hésite pas, au cours de son étude, à se référer à des catégories raciales – Noirs, Métis, Blancs, Créoles. Pour autant, la littérature ayant trait au politique dans la Caraïbe – dont les apports sont par ailleurs très riches – ne propose pas de modèle d’interprétation à même de théoriser ces logiques de racialisation du politique. Le positionnement défendu par le politiste Carl Stone, considéré comme le fondateur de la science politique jamaïcaine, offre un exemple illustratif de cette difficulté à penser la relation entre identités raciales et politique. Dans un ouvrage consacré aux « comportements politiques » dans la Jamaïque des années 1970, le chercheur affirme dans un premier temps que les représentations raciales héritées de la société de plantation ont perdu leur performativité au contact des mutations socio-économiques ayant accompagné le processus de décolonisation dans les Antilles. Si la « race » peut intervenir dans la définition du statut social, celle-ci est aujourd’hui d’une importance secondaire face aux facteurs déterminants que sont « la richesse matérielle et le revenu80 », estime Stone. Pourtant, un peu plus loin dans son ouvrage, le politiste dément ses propres affirmations lorsqu’il avance que les institutions postindépendances jamaïcaines, soumises à de fortes tensions sociales, se maintiennent essentiellement dans la mesure où les valeurs issues de la société de plantation contribuent à en légitimer l’existence81. Le tiraillement de Carl Stone entre son approche matérialiste et la réalité qu’il observe est révélateur des difficultés de la discipline à appréhender la manière dont les représentations raciales concourent à l’édification du politique dans les sociétés antillaises.
Conflits identitaires et production du politique dans la Caraïbe
Il ne s’agira pas, à travers ce travail, de présenter un modèle d’interprétation exhaustif à même de résoudre cette équation complexe. Plus modestement, nous souhaiterions donner un aperçu, et partant de là élaborer des pistes de réflexion, des logiques de racialisation du politique opérant dans l’imaginaire social antillais à partir de la mise en problème d’Haïti. Pour cela, il nous parait nécessaire de revenir, par le biais de la littérature existante, sur certains aspects saillants du politique dans les sociétés caribéennes et, plus spécifiquement, d’aborder les conflitualités identitaires qui y prennent place. On l’a vu, la notion de « mort sociale » développée par Orlando Patterson permet de mettre en lumière le projet d’annihilation sociale totale port é par les planteurs envers leurs esclaves. Peut-on pour autant affirmer que cette entreprise de dépossession qu’est le système de la plantation et l’omniprésence des dispositifs de contrôle qui l’accompagnent ont atteint leurs objectifs ? C’est là qu’apparaît la limite de l’approche de Patterson, à savoir celle de considérer l’esclave comme un être passif et d’éluder les pratiques opposées aux prétentions hégémoniques de leurs maîtres. Patterson n’est en l’occurrence pas le seul à défendre cette thèse de la tabula rasa, qui postule une déstructuration complète des institutions sociales des esclaves et la perte totale des éléments culturels africains : des auteurs tels que Franklin Frazier pour l’Amérique du Nord82, et plus récemment Francis Affergan pour les Antilles83, ont avancé des hypothèses similaires. La société esclavagiste est en réalité un champ de crises et de déséquilibres permanents dont les tensions se manifestent à travers les actes de résistance des esclaves et contribuent à poser les jalons de cultures politiques en germe.
Mécanismes d’opposition et contre-cultures des esclaves
Au cœur même du système de la plantation, Jean Benoist identifie l’existence d’« interstices » dans lesquels les esclaves développent des modes d’expression autonomes se manifestant sous la forme de « pressions parfois violentes, parfois subtiles84 ». Pour étudier ces phénomènes de résistance, Elsa Dorlin s’inspire de la distinction que Michel de Certeau opère entre les notions de tactique et de stratégie : selon l’auteure, la première s’articule autour du corps de l’esclave et se déroule au sein même de l’habitation, tandis que la deuxième s’articule autour du territoire et puise à l’extérieur les instruments de sa résistance85. La « stratégie » se manifeste d’une part par le biais des nombreuses rébellions qui marquent l’histoire de l’esclavage86, et d’autre part par le « marronnage », pratique qui désigne la fuite des esclaves de la plantation et pouvant aboutir à l’établissement de communautés indépendantes87. Le marronnage peut revêtir des formes multiples et permet de constituer des lieux « politiques et antagoniques » où se dit la contestation du système de la plantation88. À mesure que le processus de créolisation étend son œuvre, la tentation de briser ses chaînes par la violence cède toutefois du terrain face aux « tactiques89 ». Celles-ci s’insèrent dans les failles conjoncturelles du système de la plantation et constituent autant de moyens de se différencier des frontières raciales imposées par le planteur. Elles s’expriment dans des modalités très diverses : vols de matériels, acquisition de vêtements et de parures90, réduction du rythme de travail, mise en culture d’un lopin de terre91, actes de défiance durant les punitions92… S’intéressant à ce travail d’ « opposition », Richard Burton souligne que les espaces d’expression produits par les esclaves participent d’un processus de « rétention, d’interprétation, d’imitation, d’emprunt et de création culturels93 ». Dans cette perspective, la résistance des esclaves ne se joue plus seulement dans la rébellion ouverte, mais aussi sur le plan culturel et dans la contestation des structures d’oppression idéologiques imposées par le colonisateur. Paul Gilroy, à travers la notion d’ « Atlantique noir », met ainsi en lumière l’existence d’une « contre-culture de la modernité » qui « reconstruit sa propre généalogie critique, intellectuelle et morale dans une sphère publique partiellement cachée94 ». De ce point de vue, les pratiques d’opposition des esclaves n’agissent pas seulement en tant que vecteurs de contestation du système de la plantation : elles rendent possible l’édification de « contre-identités95 ». Actes politiques signifiants, celles-ci réinterprètent des croyances et en créent de nouvelles – ce que René Depestre nomme le « marronnage culturel96 » – permettant l’émergence d’univers symboliques alternatifs.
Ces logiques de reconstruction et de réappropriation du sens forment la trame des modes d’expression du politique dans le contexte caribéen. Roger Bastide met en ava nt cet aspect à plusieurs reprises dans ses écrits, arguant l’importance des processus de réinterprétation » dans l’édification des cultures créoles97. À l’instar d’autres auteurs comme Alleyne, chez Bastide, ces logiques semblent toutefois se réaliser au profit d’une origine africaine, comme si l’expérience de la plantation ne changeait qu’à la marge une culture transportée d’Afrique98 ». À l’inverse, les théoriciens de la créolité mettent l’accent sur le syncrétisme culturel et le caractère novateur des imaginaires antillais99. Pour eux, le mode opérationnel de la « rencontre100 » entre les différents groupes qui constituent les sociétés antillaises est celui du conflit101 ; conflit dont les termes sont déterminés, nous disent Mintz et Price, par la position de domination des Européens :
les institutions crées par les esclaves pour gérer […] les aspects les plus importants de leur vie ont pris leur forme caractéristique dans le cadre des paramètres déterminés par le monopole du pouvoir des maîtres, mais de manière séparée des institutions des maîtres102 ».
Les cultures antillaises constituent par conséquent des espaces où s’affrontent et s’entremêlent trois influences principales : une présence africaine, lieu du refoulé et de la mise sous silence, mais dont l’influence irrigue les pratiques culturelles et sociales des Caribéens103 ; une présence européenne, lieu du pouvoir institutionnel et entreprise hégémonique assignant le Soi antillais dans un régime dominant de représentations ; une présence américaine, lieu de rencontre où se conjuguent les apports multiples et allochtones qui composent les univers symboliques antillais104. Cet écartèlement des origines de la culture antillaise est régulièrement mentionné dans la littérature scientifique : « bipartition […] de l’organisation générale de la société » pour Benoist105, entre dominants et dominés ; entre noirceur et blancheur… Elle se traduit par la cohabitation d’espaces « officiels » et de résistance dans divers aspects de la vie sociale et culturelle telles que la langue (le créole et la langue métropolitaine, tous deux assignés à des lieux de pouvoir déterminés), la religion (les religions importées de la métropole et les systèmes de croyance afro-caribéens110), l’organisation spatiale (l’espace urbain face au « pays en dehors111 »), ou encore les pratiques festives et carnavalesques112. On récuse toutefois ici les « thèses de la dualité culturelle113 », porteuses d’une vision binaire et structuraliste des sociétés caribéennes, dont le modèle de la « respectabilité » et de la « réputation » de Wilson est l’un des cas les plus illustratifs114.
Aborder le rapport au politique au prisme de régimes de pouvoir racialisés
Mettant en garde contre cette conception dualiste des sociétés antillaises qui juxtapose individu et société et élude les rapports de domination, Nigel Bolland nous incite à juste titre à considérer ces oppositions comme étant constitutives d’un même lieu de pouvoir115. Le sociologue préfère parler de logiques « dialectiques » parcourant les cultures caribéennes et déplacer la focale sur le rapport quotidien à l’ordre politique, social et culturel dominant qu’elles impliquent116. Il ne s’agit donc pas tant de s’intéresser au contenu des constructions identitaires, par définition transitionnel, qu’aux rapports de pouvoir qui les façonnent et les animent. On retrouve un raisonnement similaire chez Glissant, pour qui « La créolisation […] qui est un des modes de l’emmêlement […] n’a d’exemplaire que ses processus et certainement pas les “contenus” à partir desquels ils fonctionneraient117 ». Fred Constant et Denis-Constant Martin donnent des pistes de réflexion prometteuses quant à la manière dont ces rapports de pouvoir sont établis. Pour les deux politistes, la « créolisation » du politique s’articule autour de deux figures indissociables : celle de la contestation de l’ordre dominant, et celle de la fascination pour cet ordre et ses formes118. Cette démarche en termes de dialectiques nous parait constituer un modèle utile pour saisir la production du politique au sein de l’imaginaire caribéen, dans la mesure où elle permet de mettre en lumière la façon dont les apports pluriels qui composent les sociétés à fondement esclavagiste se sont conjugués dans l’univers insulaire par le biais de luttes de pouvoir. Les représentations découlant de ces conflictualités conservent leur capacité agissante dans l’imaginaire social contemporain et constituent autant d’indices pour mettre à jour les types de rapports entretenus à l’égard des institutions politiques issues de la colonisation et saisir les manières de penser les pratiques déployées autour de celles -ci. Il est vrai que l’existence de dialectique de pouvoir fondées sur le couple domination/résistance n’est pas propre aux sociétés antillaises. La notion même de créolisation » a été extraite de son périmètre géographique et disciplinaire d’origine à de nombreuses reprises et appliquée à une pluralité de contextes. Pour autant, ces logiques n’en prennent pas moins une résonance et une signification particulières pour les univers sociaux créolisés du Nouveau Monde, dans un contexte où le pouvoir de catégorisation et de coercition exercé par les institutions dominantes atteint des proportions inédites119.
Cette configuration singulière des régimes de pouvoir caribéens agit directement sur le processus de fabrication du politique prenant place dans ces territoires et, par extension, sur la mise en problème d’Haïti. Une telle perspective nous amène à distinguer, à partir de la littérature existante et des réflexions menées jusqu’à présent, trois aspects concomitants à cette matrice socio-historique commune susceptibles d’éclairer les modalités par lesquelles le « problème haïtien » est politisé et con struit en tant qu’élément de controverse.
Le premier d’entre eux se rapporte à l’absence d’une définition identitaire politique commune et acceptée par tous dans les territoires antillais. La pluralité des pratiques de résistance décrite un peu plus tôt a pour conséquence de favoriser un foisonnement des modes d’être et d’agir, et de contrecarrer l’entreprise de captation identitaire du pouvoir officiel120. En effet, la défiance inspirée par les institutions héritées de la colonisation se traduit par l’existence d’un « univers politique éclaté », marqué par une multiplication des stratégies de contournement de l’autorité publique, par la persistance d’espaces de résistance où se disent des modes d’identification alternatifs, et par une tendance à recomposer en permanence ces registres d’appartenance en fonction des contraintes et des enjeux du moment121. En résulte une « tension structurelle » entre la volonté étatique d’exercer un monopole sur la mise en récit du corps collectif et la tendance inhérente de ces identités à échapper aux contraintes exercées par le pouvoir institutionnel122.
Deuxièmement, l’absence d’un récit collectif consensuel où se déploierait une vision commune du passé et du futur fait, peut-être plus qu’ailleurs, de la question de l’appartenance l’un des répertoires privilégiés d’énonciation du politique123. Cette problématique identitaire se situe déjà au cœur du fonctionnement de la société de plantation qui, on l’a vu, repose sur la capacité de l’ordre dominant à catégoriser les corps qu’il gouverne. À cet égard, les luttes interprétatives autour de la définition du Nous collectif observables dans l’espace caribéen n’apparaissent pas comme un enjeu politique parmi d’autres : elles constituent le fondement même à partir duquel s’exerce le pouvoir. C’est en ce sens que Christine Chivallon, dans ses réflexions sur la notion de créolisation », définit les innovations culturelles antillaises – et par là-même les stratégies identitaires qui les animent – non pas seulement comme une « disposition au changement », mais aussi comme l’ « invention de manières de composer avec le pouvoir » donnant lieu à un « rapport particulier au politique124 ». Plutôt que d’entretenir l’idée d’une question identitaire déconnectée du politique, il s’agit ici, pour paraphraser les mots de Jean-François Bayart et Romain Bertrand, d’aborder le contexte d’une action politique configurée par la conflictualité identitaire héritée du legs colonial125.
Le troisième aspect que nous voudrions aborder n’est pas tiré à proprement parler de la littérature existante et constituera l’une des hypothèses de travail qui guideront cette recherche. À partir du constat de l’ « hypostase126 » entre hiérarchies raciales et stratification sociale relevé un peu plus haut, on postulera que les tensions identitaires observées dans l’imaginaire social caribéen, et partant l’action politique qui en découle, sont informées par des logiques de racialisation. Dans un contexte marqué par des luttes de pouvoir récurrentes entre des conceptions asymétriques de l’identité raciale, dont les termes sont constamment affirmés, imposés, contestés et renouvelés, il parait en effet raisonnable d’affirmer que les antagonismes constitutifs de la production du politique sont imprégnés de référents de sens raciaux. L’étude du « problème haïtien » aura par conséquent pour objectif de mettre à jour ces logiques et d’en saisir les modes opératoires. Dans ce maillage relatif aux stratégies d’identification qu’un groupe se donne et que recouvrent les régimes de pouvoir racialisés entraperçus, ainsi qu’aux formes de politisation formelles et informelles propres aux sociétés à fondement esclavagiste, surgit une aporie qui fut décisive pour l’investigation : la tension entre la perpétuation des institutions issues de la domination raciale au sein de l’espace politique, et la capacité des acteurs à s’extraire des schèmes aliénants produits par ces mêmes institutions. Cette thèse entend donc non pas seulement aborder le « problème haïtien » en tant que lieu de mise en politique de schèmes raciaux, mais aussi d’interroger le degré d’autonomie des acteurs et leur aptitude à renégocier les structures de pouvoir héritées de la colonisation. C’est ici que la démarche comparative prend tout son sens : outre le fait qu’elle permettra de souligner le caractère transnational du « problème haïtien », elle servira à comprendre comment, dans le cas de configurations institutionnelles contrastées, en Jamaïque et en Guadeloupe, les acteurs composent avec leurs héritages coloniaux respectifs. Si les clivages raciaux nés de la société de plantation semblent avoir durablement structuré les luttes symboliques autour de l’identité, nous défendrons le point de vue selon lequel leur activation politique est étroitement liée aux stratégies adoptées par les acteurs et aux régimes d’historicités propres dans lesquelles elles s’inscrivent.
Sur le terrain, l’étude du « problème haïtien » s’est avérée être un sujet sensible, source de polémiques parfois violentes, et animé par des acteurs souvent soucieux de prendre à témoin l’observateur extérieur pour mieux légitimer et défendre leurs positions. L’étude des controverses n’est pas illégitime en science politique – elle comporte au contraire une valeur hautement heuristique – à la condition toutefois de ne pas se laisser enfermer dans les cadres de pensée qui structurent le débat public. Éviter cet écueil, et conserver une certaine distance avec le sujet d’étude, implique une clarification théorique du sens des mots, préalable à l’élaboration de concepts opératoires qui permettront d’appréhender les faits sociaux étudiés. C’est en effet la confrontation avec les catégories de pensée théoriques existantes qui a permis de fournir un cadre à cette recherche, de mobiliser des notions éprouvées sur différents terrains, de tester la validité de modèles d’analyse, et de relier nos questionnements à des enjeux théoriques plus généraux. Cette mise en débat avec la littérature scientifique constitue un préalable indispensable pour « objectiver » les faits sociaux étudiés par le recours à des outils théoriques, ainsi que pour ramener les observations empiriques à des questionnements plus généraux pour ainsi dépasser l’horizon d’un monde posé comme « allant de soi ».
Table des matières
INTRODUCTION
PENSER LE POLITIQUE DANS LA CARAÏBE : REPÈRES
HISTORIQUES ET CULTURELS
POSITIONNEMENT DANS LA LITTÉRATURE DES
SCIENCES SOCIALES
PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE
RECENTREMENT ET ANNONCE DU PLAN DE LA THÈSE
1ERE PARTIE. GOUVERNEMENTALITÉ COLONIALE, IDÉOLOGIE RACISTE ET USAGES POLITIQUES D’HAÏTI : PERSPECTIVES HISTORIQUES
CHAPITRE 1. UNE FIGURE RACIALISÉE DE L’ANTI-MODERNITÉ : L’INVENTION D’HAÏTI DANS L’IMAGINAIRE COLONIAL
CHAPITRE 2. RÉGIMES DE POUVOIR ET CATÉGORIES RACIALES : HISTORICISER LA PRODUCTION DU POLITIQUE EN JAMAÏQUE ET EN GUADELOUPE
CHAPITRE 3. RETRACER LE RAPPORT À HAÏTI. MISE EN CONTEXTE DES RELATIONS HISTORIQUES AVEC LA JAMAÏQUE ET LA GUADELOUPE
2EME PARTIE. LA RÉACTIVATION DU « PROBLEME HAÏTIEN » EN JAMAÏQUE ET EN GUADELOUPE DURANT LES ANNEES 2000.
CONSTRUCTION DE LA MENACE ET PROCESSUS DE MISE A L’AGENDA
CHAPITRE 4. SAISIR LES « UNIVERS DE SENS » À L’ORIGINE DU « PROBLÈME HAÏTIEN » : ALTÉRITÉ, RÉAPPROPRIATIONS IDENTITAIRES ET LOGIQUES DE RACIALISATION
CHAPITRE 5. DE L’ASSIGNATION IDENTITAIRE À LA POLITISATION : MISE À L’AGENDA ET CONTESTATION DU « PROBLÈME HAÏTIEN » EN JAMAÏQUE
CHAPITRE 6. LA POLARISATION DU CHAMP POLITIQUE AUTOUR DE L’IMMIGRATION HAÏTIENNE EN GUADELOUPE : RACISME, LUTTES DE POUVOIR ET MOBILISATIONS IDENTITAIRES
3EME PARTIE. DE LA MISE EN POLITIQUE AUX PRATIQUES INSTRUMENTALES. L’USAGE D’HAÏTI EN TANT QUE TECHNOLOGIE GOUVERNEMENTALE
CHAPITRE 7. MODES DE GOUVERNEMENTALITÉ ET INSTRUMENTATION DU « PROBLÈME HAÏTIEN » : RÉAFFIRMER L’IDENTITÉ LÉGITIME
CHAPITRE 8. LES POUVOIRS PUBLICS FACE AU TREMBLEMENT DE TERRE DE 2010 : VICTIMISATION ET (RE)MISE À NU DES CORPS
CONCLUSION GÉNÉRALE