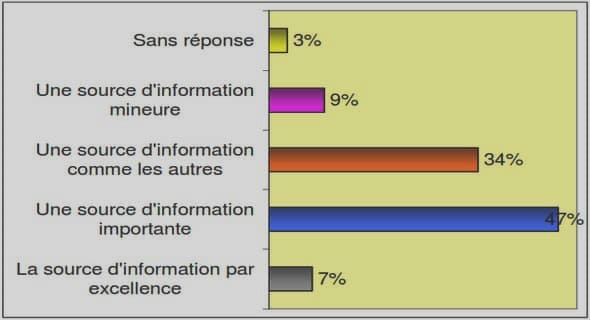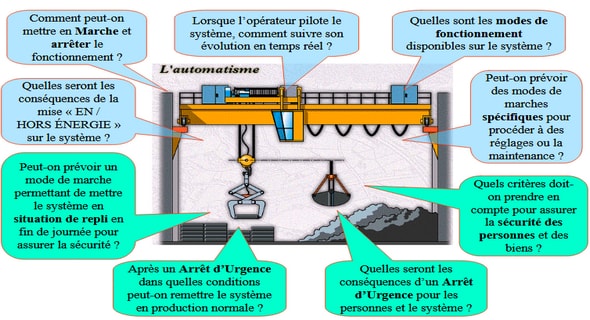Généralités sur les digues
Les différents types de digue en terre
Les digues en terre peuvent être différenciées selon certains nombres de critères. Le critère le plus évident est sa forme caractérisée, en premier lieu par sa hauteur (1), Mais aussi par la forme de sa section transversale. Il existe aussi d’autres critères qui semblent les moins évidents comme entre autres, les matériaux qui la constituent et son rôle.
Distinction selon sa forme
La forme des digues contribue beaucoup à sa stabilité surtout en renversement. En effet, les digues en terre ont généralement la forme trapézoïdale mais elles peuvent aussi être en redan. La hauteur d’une digue joue aussi un rôle très important dans sa stabilité vis-à-vis des efforts.
Distinction selon son rôle
a) Les digues de protection contre les crues fluviales :
Elles sont situées dans le lit majeur d’un cours d’eau ou le long du littoral, parallèlement à la rive et destinées à contenir les eaux de celui-ci à l’extérieur des digues. Elles portent alors parfois le nom de levée.
b) Les digues de canaux :
Les canaux sont généralement alimentés artificiellement, les digues de canaux servent à contenir l’eau à l’intérieur du canal. Les remblais composant des barrages sont aussi parfois appelés digues mais pour éviter toute confusion, nous allons éviter d’employer le mot digue pour désigner un ouvrage transversal qui barre un cours d’eau.
c) Les digues portuaires :
Plus ou moins longues faisant office d’écran aux vagues, sont appelés brise-lames. N’ayant qu’une fonction de protection contre les vagues et courants de marée, elles n’ont pas vocation à être étanches ; Certaines digues sont basses et constituées de blocs de pierre ou de béton qui atténuent les vagues sans empêcher l’eau d’y circuler.
d) Les ouvrages de protection contre la mer :
Sont de plus en plus nombreux ; isolant et protégeant une ville de la mer; les dunes littorales sont des digues naturelles et doivent être respectées comme telles. Et plus récemment, on voit aussi :
e) Les digues à bermes reprofilables :
Ce sont des digues marines conçues pour que la houle puisse les remodeler, de manière à atteindre un profil en S plus stable.
f) Les digues dites « digues écologiques »
elles visent à limiter ou en partie compenser leur impact écologique ; ce sont des défenses côtières (ou fluviales), auxquelles on a intégré une vocation de récif artificiel, de support de faune et algues marines ou de filtration ou amélioration de la qualité de l’eau ou un intérêt écotouristique. Elles peuvent alors être intégrées dans un dispositif compensateur de perte ou fragmentation d’habitats littoraux ou sédimentaires. Elles peuvent s’intégrer dans une trame verte et bleue ou une trame bleue marine. Des études visent à mieux comprendre comment elles peuvent contribuer à réduire ou compenser des impacts d’endiguements.
Les matériaux constitutifs des digues
Le choix des matériaux constitutifs d’une digue ou barrage en terre repose parfois sur la disponibilité au voisinage du chantier. Et ceci décide dans la plupart des cas le type et la forme de l’ouvrage. On peut distinguer généralement deux grandes classes de matériaux utilisés pour la construction des digues ou des barrages en terre :
● Les sols pulvérulents ou grenus classés comme matériaux perméables mais aussi comme matériaux supportant les forces de cisaillement élevées.
● Les sols cohérents ou fins classés comme matériaux peu perméables dont la résistance au cisaillement est faible.
La proportion de ces types de matériaux joue un rôle très important dans une construction d’une digue en terre. Si l’on utilise une très grande proportion de matériaux peu perméable et un faible volume de matériaux perméable, l’ouvrage est donc homogène et peu perméable. Et dans le cas contraire ou ces deux proportions est inversée, il est commode de choisir la solution d’un ouvrage à noyau étanche c’est-à-dire que les matériaux perméables sont utilisés comme recharges et les matériaux peu perméable en comme noyau.
Si l’on est en présence d’au moins trois types de matériaux dont la perméabilité est nettement différente les uns des autres, on dispose les matériaux d’autant plus centrale dans le corps de digue que leur perméabilité est plus faible. Lorsqu’on utilise uniquement des matériaux fins, les talus de l’ouvrage sont relativement faibles mais pour les digues à noyau, les talus peuvent être plus raides car la résistance au cisaillement du sol de recharge est plus élevée. Ce qui explique aussi que pour les digues à noyau la quantité des matériaux utilisés est moins importante que pour les digues homogènes construit à partir des matériaux fins. Que ce soit pour le sol grenu ou pour le sol fin, des essais d’identification doivent être effectués avant leur utilisation. Identifier un sol c’est connaitre un certain nombre de propriétés physique mécanique ou chimique. Ces propriétés sont obtenues par des essais empirique, simple et rapides appelés essais d’identification.
Les sols étant d’aspects très voisins mais pouvant présenter des comportements très différents, que les essais d’identifications doivent avoir une description précise, chiffrée, et non seulement descriptives du sol.
On peut distinguer deux grandes catégories d’essais d’identification de sols :
● Les essais qui répondent de l’arrangement et de la répartition des phases (solide, eau, air). Ces essais déterminent l’état du sol et ne peuvent être réalisé que sur des échantillons intacts ;
Les essais qui traduisent les propriétés des particules du sol et l’intensité de leurs liaisons avec l’eau. Ces essais caractérisent la nature du sol et sont réalisés sur des échantillons intacts ou remaniés (dont l’état a été perturbé lors du prélèvement ou du transport).
Les matériaux utilisés et leurs caractéristiques
Les matériaux pour les remblais sont quasi de même aspect dans les zones centrales de .En général, la partie centrale de Madagascar est caractérisée par la présence des sols ferralitiques faiblement ou fortement rajeunis. Avec une érodibilité « K » moyenne, qui détermine la vulnérabilité des sols à l’érosion plus particulièrement à l’érosion hydrique. Il définit la résistance des sols à la battance des gouttes de pluie. La valeur de K varie suivant le type de sols, la région.
Cependant, pour avoir un ouvrage apte à résister aux forces de la nature, il vaut mieux bien sélectionner son matériau. Avant de les utiliser. Les matériaux doivent passer aux laboratoires pour des essais comme entre autres l’essai d’identification, l’essai CBR et l’essai Proctor.
Identification et description qualitative des matériaux
Identifier un sol, c’est déterminer un ensemble de propriétés physiques, mécaniques ou chimiques qui permettent de le caractériser. Ces propriétés sont déterminées par des essais simples et rapides, appelés « essais d’identification ».
Les essais d’identification conduisent à une description précise et chiffrée, et non seulement descriptive, du sol. Une définition chiffrée est nécessaire car des sols d’aspects très voisins peuvent présenter des comportements (mécaniques, en particulier) très différents. Les essais d’identification servent de base aux divers systèmes de classification des sols. Leurs résultats permettent aussi d’estimer au moyen de corrélations des ordres de grandeur des propriétés mécaniques des sols et d’établir un prédimensionnement grossier des ouvrages au stade des premières études. On distingue classiquement deux grandes catégories d’essais d’identification :
— les essais qui répondent de l’arrangement et de la répartition des phases (squelette solide, eau, air). Ces essais caractérisent l’état du sol et ne peuvent être réalisés que sur des échantillons intacts ;
— les essais qui traduisent les propriétés des particules du sol et l’intensité de leurs liaisons avec l’eau. Ces essais caractérisent la nature du sol et sont réalisés sur des échantillons intacts ou remaniés (dont l’état a été perturbé lors du prélèvement ou du transport).
Introduction générale |