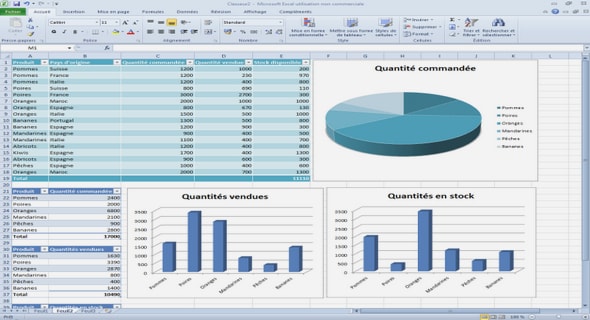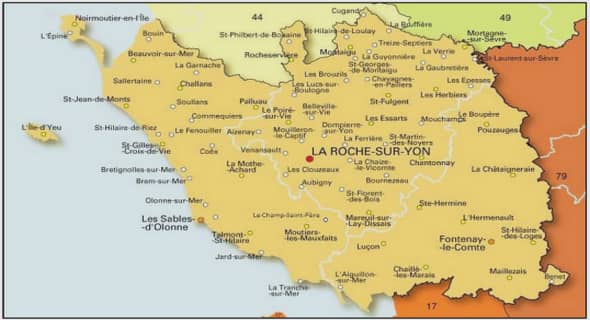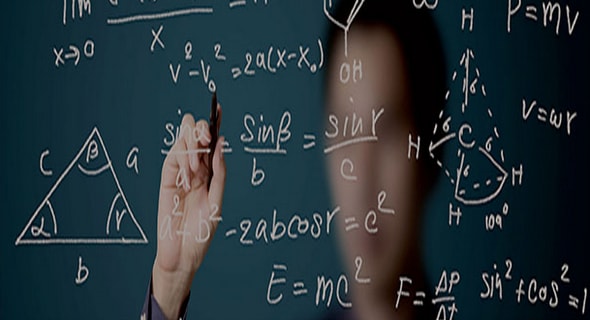Le lait de vache est un aliment complet, possédant tous les nutriments nécessaires à la vie notamment les protéines et le calcium qu’il apporte. En 1996, la production en lait frais à Madagascar est de 484000 tonnes. Mais le lait et les produits laitiers font l’objet d’une demande très forte nécessitant encore une importation de 280 tonnes de lait frais, 1321 tonnes de poudre de lait, 562 tonnes de lait condensé, 270 tonnes de beure et 114 tonnes de fromages (MEYER C, DENIS J P, 1999) .
La filière Lait est considérée comme une filière porteuse à Madagascar. Les grandes entreprises de transformation se trouvent dans les régions de Vakinankaratra et de l’Imerina Central. Les autres régions produisent du lait pour une consommation directe des populations aisées des villes les plus proches ou pour des transformateurs. (Actualité laitière – FIPA, 2004).
GENERALITES SUR LES PARAMETRES ZOOTECHNIQUES DE L’ELEVAGE
Environnement
Les normes de bâtiment d’élevage laitier
Une étable doit disposer un couloir de service au milieu, de deux rangs de stalles, de deux couloirs d’alimentation latéraux, de mangeoires, d’abreuvoirs, de rigole et de fosse à purin. Il faut aussi prévoir des annexes :
− local de stockage du foin ou de l’ensilage
− local de conservation de l’aliment concentré
− local pour la préparation du concentré
− fosse à fumier
− salle de traite et éventuellement laiterie .
Plan de l’étable :
Une étable comporte des stalles ou emplacements réservés aux animaux. Les stalles pour vaches ont 1,10-1,20m de large, 2-2,50m de longueur. Pente du sol :
− rigole longitudinale, parallèle au grand axe de l’étable : 1à 2%
− pente des stalles vers la rigole longitudinale : 2%
− pente du couloir de service vers la rigole longitudinale : 1%
− couloir d’alimentation .
Les couloirs :
− largeur du couloir de service : 1,5 m
− largeur de couloir d’alimentation : 1,3 m
− auge dont la largeur est de 60-70 cm, sa longueur est de 1,20 m, et sa hauteur au sol du bord antérieur est de 40 cm .
Les ouvertures :
Il s’agit essentiellement des portes, les murs et cloisons n’étant pas en général élevés jusqu’au plafond.
− Les portes centrales : largeur 1,50 à 2m ; hauteur 2,20 à 2,40m
− Les ouvertures murales : à 2,2 m du sol et dont la hauteur est de 1m
− Les portes de service du personnel : 80cm de large sur 2,20m de haut .
Les normes d’ambiance dans le bâtiment
L’étable doit être construite dans un endroit approprié : large, calme, pas d’humidité, bien aéré et lumineux.
Aération : il faut une bonne ventilation tout en évitant les courants d’air dans une étable, pour empêcher tout stress de l’animal qui pourra affecter la production.
Hygrométrie : il faut éviter toute humidité afin de pouvoir limiter le taux de microbismes dans l’étable
Luminosité : l’étable doit être lumineuse pour éviter tout stress de l’animal afin qu’il puisse avoir de bon fonctionnement physiologique.
Alimentation
Le système digestif de la vache de plus près
Bouche :
La nourriture se retrouve dans la bouche de la vache où elle est mastiquée une première fois afin de réduire la longueur des fibres de l’herbe ou du foin. Lorsqu’elle mange, la vache mastique très peu et avale sa nourriture presque «tout rond». La vache n’a pas d’incisives supérieures. Ainsi, lorsqu’elle broute l’herbe, elle ne la coupe pas avec ses dents, mais la déchire en la tirant.
Oesophage :
La nourriture emprunte ensuite l’oesophage pour se rendre dans le premier compartiment, le rumen.
Rumen (1er compartiment) :
C’est le compartiment qui a le plus grand réservoir et dont le rôle est le plus important. C’est à cet endroit que fermentent les fourrages et les grains. Ces aliments ne pourraient pas être transformés par l’estomac d’un autre mammifère et absorbés par le sang. Chez la vache, les micro-organismes du rumen font la différence. Elles transforment partiellement les aliments en des substances que le système digestif de la vache peut utiliser. Les aliments demeurent entre 24 et 48 heures dans le rumen.
Rumination :
Les aliments que consomme la vache se présentent souvent sous forme de longues particules qui sont de trop grande taille pour que les bactéries du rumen puissent les digérer complètement. La vache les régurgite donc pour les mastiquer plusieurs fois jusqu’à ce que les particules soient suffisamment petites. On dit alors que la vache rumine. La salive joue aussi un rôle important car elle fournit des éléments utilisés par les bactéries du rumen. Pendant la rumination, la production de la salive peut atteindre de 250 à 300 ml/min soit 1 litre toutes les 3 à 4 minutes. Chez la vache, la production de la salive dépasse 200 litres par jour. Une vache peut mastiquer de 50 à 70 fois par minute et pendant 10 à 12 heures par jour, soit 40 000 à 45 000 mouvements de mâchoire par jour.
Réticulum (2ème compartiment) :
Une fois le travail des bactéries du rumen effectué, la nourriture est dirigée vers le réticulum, le plus petit estomac. Celui-ci assure la continuité de la fermentation et sert en quelque sorte de tamis, retenant les particules trop longues dans le rumen, tout en permettant aux petites de poursuivre leur route vers l’omasum. Les particules retenues seront régurgitées pour être mastiquées de nouveau (rumination).
Omasum (3ème compartiment) :
L’omasum exerce une fermentation additionnelle et retient une partie de l’eau qui imprègne les aliments dans les premiers compartiments.
Abomasum (4ème compartiment) :
Il s’agit du compartiment de l’estomac de la vache qui correspond à l’estomac des non ruminants, c’est ici que commence la digestion proprement dite.
Intestins :
Finalement, la nourriture entre dans les intestins pour compléter la digestion et les éléments nutritifs qui en résultent sont absorbés.
INTRODUCTION |