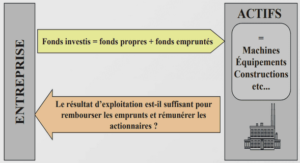Généalogie des approches gestionnaires de la RSE et du développement durable
Introduction :
Les débats concernant la capacité de la biosphère à soutenir le développement économique et humain ne sont pas nouveaux (Malthus, 1798; Randers et Meadows, 1972). La notion de développement durable, si elle se constitue dans la continuité de ces interrogations, est apparue plus récemment : il faut attendre 1987 pour disposer d’une définition canonique du concept, proposée dans le rapport Bruntland comme « un développement apte à répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Bruntland, 1987). Jusqu’à une période plus récente encore, le concept a été principalement mobilisé dans le champ des politiques publiques ou l’économie du développement (pour une histoire du concept dans le champ politique et économique, cf. Godard, 1994 ; Sachs, 1998 ; Aggeri, 2004).
L’appropriation massive de la notion de développement durable par les entreprises constitue ainsi un phénomène nouveau, remontant à la fin des années 90 (Aggeri et al., 2005). Par ailleurs, la notion de développement durable n’a pas le même sens dans le débat politique et dans l’entreprise. Plutôt qu’une simple transposition, l’importation du concept de développement durable dans le champ managérial a été l’occasion de réactualiser et de généraliser le concept de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE / Corporate Social Responsibility –CSR- en anglais). Au-delà des débats sur la préservation des ressources et l’équité inter- et intra-générationnelle, la RSE renvoie à l’acceptabilité des activités de l’entreprise et à l’intégration de l’entreprise à la société.
Sous l’impulsion d’entreprises, de consultants, de chercheurs, de groupes d’échange et d’acteurs publics, le concept de RSE a connu une diffusion particulièrement spectaculaire depuis la fin des années 90 (Capron et Quairel Lanoizelée, 2004 ; Vogel, 2005) et est souvent présenté comme le corollaire gestionnaire du concept de développement durable (Férone et al., 2001). La Commission Européenne, à travers son livre vert en 2001, consacre le concept de RSE et le définit comme « l’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (2001, p.7). Par ailleurs, elle articule explicitement les notions de RSE et de développement durable6.
Le concept de RSE s’inscrit dans une longue histoire de pratiques et de théories, qu’il est nécessaire de mieux appréhender afin de comprendre les enjeux contemporains de sa diffusion et de son étude. Ce chapitre vise donc à développer une histoire de la notion de RSE, des pratiques associées, et des cadres théoriques élaborés pour étudier ce construit. Il vise à appréhender la manière dont la Responsabilité Sociale de l’Entreprise puis le développement durable ont été problématisés et étudiés dans le champ managérial. Ce chapitre poursuit deux objectifs : premièrement, il s’agit d’effectuer une histoire des pratiques associées à la RSE et de l’évolution des problématisations de ces notions dans le champ des affaires ; deuxièmement, nous poursuivons un objectif de réévaluation théorique, en revenant sur des travaux aujourd’hui considérés comme secondaires, ou en analysant avec un recul critique la portée et les limites de cadres aujourd’hui considérés comme centraux pour l’étude du management de la RSE et du développement durable. Ce faisant, nous chercherons à mieux appréhender les liens entre théories et pratiques de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.
Au sein de ce chapitre, nous ne chercherons pas à nous livrer à une histoire de la notion de responsabilité ou à fournir une histoire exhaustive de la notion d’éthique, mais à comprendre comment s’est progressivement construit un champ de pratiques et de réflexion autonome autour de la gestion de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et du développement durable. Dans notre histoire de la notion de RSE, nous accorderons une place particulière aux développements nord-américains. Cela ne signifie pas que les relations entre entreprises et société n’aient pas constitué un objet de questionnement ou de crise dans d’autres contextes, ou bien que des pratiques assimilables à des démarches de RSE ne se soient pas développées ailleurs. Ainsi, différents travaux analysent les pratiques contemporaines de RSE comme un renouveau du paternalisme d’entreprise, développées dans un contexte de défaillances étatiques ou pour fidéliser une main d’œuvre qualifiée (Ballet et De Bry, 2001; Lefebvre, 2003). A un autre niveau, les débats français relatifs à la loi sur le bilan social, au milieu des années 70, faisaient écho à des réflexions internationales sur la comptabilité sociétale et la nécessité d’enrichir des indicateurs de communication externe des entreprises.
Si la problématique de la relation entre entreprise et société dépasse le contexte des Etats-Unis, plusieurs éléments justifient cependant d’accorder une place particulière aux développements nord américains. Premièrement, c’est dans le contexte culturel et institutionnel américain que la notion de RSE, aujourd’hui diffusée internationalement, est apparue et a pris corps (Pasquero, 1995, 2005). Plus profondément, le concept de RSE s’y est structuré, plus qu’ailleurs, en un champ de débats, de réflexions et de pratiques d’entreprises. Pour reprendre l’analyse de Dirk Matten et de Jeremy Moon (2004), la RSE se constitue aux Etats-Unis autour un corpus de pratiques « explicites » de la part d’entreprises : celles-ci mettent en œuvre des démarches structurées et volontaires afin de contribuer à la résolution de problèmes sociaux. Par opposition, la RSE en Europe relevait traditionnellement d’une approche plus implicite, découlant d’un cadre institutionnel reposant l’action coercitive de l’Etat7. Cette approche « explicite » de la RSE met en jeu l’élaboration précoce de « doctrines de la Responsabilité Sociale » (Bowen, 1953) et la structuration de discours au sein des milieux d’affaire (Heald, 1961).
En parallèle, la RSE s’est aussi constituée, aux Etats-Unis, en un champ académique à part entière, qui va s’institutionnaliser et se structurer progressivement à partir des années 1960. Une série de travaux gestionnaires vont ainsi se développer au sein d’un champ académique centré sur l’interface entre l’entreprise et la société (Business & Society), donnant lieu au développement d’un large corpus de travaux, dont nous chercherons à discuter la portée et les limites. Il semble donc que les Etats-Unis aient plus systématiquement envisagé la notion de RSE comme un champ de pratiques à piloter et à étudier, à la fois au sein de l’entreprise et du point de vue de l’action publique.
Nous inscrivons ici notre démarche dans une approche généalogique8, qui vise à resituer les développements théoriques en analysant leurs filiations et en les replaçant dans les débats théoriques, institutionnels et pratiques dans lesquels ils ont été conçus et ont été diffusés. Une revue de littérature traditionnelle tendrait à identifier, à un moment donné, différentes écoles de pensées en concurrence en matière de RSE (Garriga et Melé, 2004), en analysant leur portée explicative à l’aune de leurs postures ontologiques et épistémologiques respectives (Burrell et Morgan, 1979). La démarche généalogique vise, à l’inverse, à comprendre la manière dont différents cadres théoriques sont historiquement situés. En s’intéressant à la formation et la diffusion des concepts, l’approche généalogique cherche à souligner l’historicité des manières de penser et de problématiser de nouveaux objets de recherche. Ce faisant, elle suggère une vision des théories plus encastrées dans la société et tend à remettre en question l’idée d’une dichotomie claire entre théories et pratiques, qui prévaut souvent dans la littérature académique en matière de RSE (Acquier et Gond, 2006). L’intérêt d’une approche généalogique est double. Premièrement, elle offre une occasion de distanciation et de recul critique que ne permet pas une approche naturalisée9 ou ahistorique des concepts. Deuxièmement, en s’intéressant aux conditions d’émergence et à la diffusion des concepts de RSE, de performance sociétale et de stakeholders, l’approche vise aussi à s’interroger sur la pertinence et la transposabilité de cadres théoriques développés dans des contextes institutionnels et managériaux différents de ceux dans lesquels ils ont été historiquement formés.
Nous structurerons ce chapitre autour d’un découpage chronologique en cinq temps. Nous reviendrons tout d’abord sur l’émergence de l’idée de Responsabilité Sociale aux Etats-Unis (I.) et sur les premiers efforts d’analyse des rapports entre entreprise et société (II.). Nous aborderons ensuite les développements pratiques et académiques de la période 1965-1980 (III.), marquées par un mouvement intense d’engagement des entreprises et de managérialisation » de la RSE, et se traduisant par une série de travaux articulés à la théorie des organisations et à la stratégie des entreprises. Dans un contexte de remise en question des pratiques d’entreprise, la période 1980-2000 (IV.) est marquée par des efforts de synthèse théorique et de renforcement académique autour des concepts de Performance Sociétale de l’Entreprise (Corporate Social Performance) et de stakeholder. Dans une dernière partie (V.), nous détaillerons les transformations contemporaines, aussi bien d’un point de vue académique que pratique (1995-…).
Une représentation simplifiée des différentes courants d’analyse est fournie par le schéma 1.1.