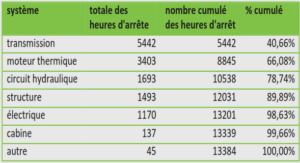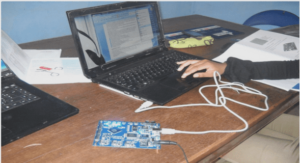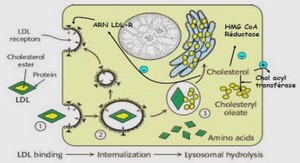Flux d’eau entre différents écosystèmes sur un territoire
Détermination et description du milieu récepteur
L’outil proposé dans cette partie correspond à la « définition et description du territoire d’étude » de l’Etude d’Impact Environnemental. Il s’agit de déterminer l’ensemble des entités (humaines et écosystèmes) pouvant subir des effets suite au rejet. 1 Description du milieu récepteur La question de recherche concerne l’étude du territoire du point de vue des services écosystémiques produits. Nous avons donc cherché une nomenclature ou un système existant permettant de connaitre les différents écosystèmes présents sur un territoire autrement que par une étude de terrain, couteuse en termes de temps et de moyens. L’étude bibliographique n’a pas montré l’existence d’une nomenclature des différents types d’écosystèmes. Une liste est proposée par le Millenium Ecosystem Assessment (Millenium Ecosystem Assesment, 2005a) et est retranscrite dans la deuxième colonne du Tableau 8. Ce tableau présente également dans la première colonne la décomposition du territoire sous Corine Land Cover (CLC) (Bossard et al., 2000). Corine Land Cover est un système de cartographie des différents types d’unités paysagères d’Europe. L’élaboration des cartes est basée sur la photo-interprétation d’images satellite sur des cartes à l’échelle 1/100 000. La plus petite unité de surface représentée est de 25 hectares. Les unités paysagères utilisées par cette méthode correspondent en grande partie aux types d’écosystèmes répertoriés par le Millenium Ecosystem Assessment mais sont déclinées de manière plus détaillées. Par ailleurs, un des avantages de Corine Land Cover est que les cartes sont disponibles gratuitement sur des sites internet comme Géoportail. Il est également possible d’acheter leur base de données afin de pouvoir l’intégrer dans des Systèmes d’Information Géographiques (SIG). A partir de Géoportail ou d’un SIG, il est possible de visualiser et d’identifier les différents types d’unités paysagères présentes sur le territoire étudié. Dans le cadre de l’étude des rejets aqueux d’une entreprise, cette représentation sera complétée par des informations plus précises sur le réseau hydrographique. D’une part parce qu’ils ne sont pas toujours bien représentés sous Corine Land Cover à cause de l’échelle de travail. D’autre part parce que pour la suite de l’étude il sera nécessaire de les identifier. Ainsi, nous proposons de coupler la représentation CLC par l’identification des masses d’eau présentes sur le territoire grâce aux Systèmes d’Information sur l’Eau (SIE : bases de données sur l’eau accessible par internet regroupant la quasi-totalité des données récoltées sur les masses d’eau dans le cadre de la DCE : données cartographiques, qualité de l’eau, prélèvements, rejets, etc.). Ainsi, la représentation proposée ici comprend l’identification de toutes les composantes, c’est-à-dire des écosystèmes (naturels ou non) présentes sur le territoire d’étude.
Détermination du milieu récepteur
Les différentes composantes de l’écosystème ne sont pas isolées les unes par rapport aux autres. Elles sont en relation par différents vecteurs d’échanges, dont l’eau. Les relations entre éléments géographiques peuvent être représentées de différentes façons, entre autres sous forme de graphes, cartes ou matrices (Bahoken, 2011). L’existence ou non d’une relation entre deux éléments peut être complétée par d’autres informations telles que l’orientation de la relation, l’attribution d’une valeur, divers caractéristiques… Ainsi, ces relations peuvent être représentées différemment comme le montre la Figure 23.Concrètement, il est ainsi possible de représenter de façon cartographique ou simplement graphique les échanges d’eau comme présenté sur la Figure 24 (flèches simples → ou doubles ↔ orientées de l’amont vers l’aval) entre le fournisseur de l’effluent et les différents écosystèmes sur un territoire, considérés alors comme des « boîtes noires » (les processus subis par les flux ne sont pas explicités). Pour répondre à la problématique, les échanges entre les différentes composantes de l’environnement seront représentés de façon graphique. En effet, cette solution parait la plus adaptée pour simplifier la compréhension et la visualisation par les utilisateurs. Pour les mêmes raisons, nous avons choisi de ne pas représenter graphiquement certaines informations (débit d’eau, composition) mais de représenter uniquement le sens des échanges. Ainsi, nous proposons de représenter les échanges véhiculés par l’eau entre les composantes du territoire par le biais d’un graphe orienté, que nous appellerons par la suite « diagramme de flux », comme présenté sur la Figure 24. L’aspect graphique de cet outil offre l’avantage de permettre une visualisation simple des relations qui existent sur le territoire d’étude et donc dans notre cas, les relations de l’entreprise avec son territoire via le rejet d’effluent aqueux dans un écosystème donné. L’ensemble des composantes reliées par des échanges d’eau sont ainsi connectées par des flèches. En particulier, l’ensemble des composantes en aval du milieu récepteur constituent le milieu récepteur potentiel (Par exemple, la composante D représentée sur la Figure 24 ne fait pas partie du milieu récepteur). L’hydrosystème n’a pas de frontières, donc en théorie, le milieu récepteur non plus. Nous verrons dans le chapitre suivant comment déterminer les limites du milieu récepteur.
Représentation des services produits par le milieu récepteur
Sur le territoire, les différents écosystèmes produisent des services (voir Chapitre 2). Ces services répondent à des besoins de l’Homme. Dans un objectif d’évaluation quantitative des besoins de l’homme vis-à-vis de ces services, nous avons préalablement sélectionné les services qui répondent directement aux besoins définis par Maslow (Maslow, 1943). Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux services produits par les écosystèmes aquatiques puisque ce sont eux qui vont être à l’origine de la propagation éventuelle des impacts vers les autres composantes du milieu récepteur. 1 Services écosystémiques répondant aux besoins de l’Homme Dans le Chapitre 2, nous avons signalé que dans la littérature, de nombreux types de services écosystémiques ont été identifiés et classifiés selon différentes familles. Pour la suite du travail, seuls les services écosystémiques répondant de manière directe à un besoin de l’Homme seront conservés. Ceux-ci sont présentés dans le Tableau 9. Certains services « supports », qui relèvent du fonctionnement intrinsèque des écosystèmes, difficilement appréhendable de manière quantitative en termes de besoin, ont été écartés de l’étude. Ainsi, nous avons choisi de ne pas traiter les services tels que la pollinisation, les cycles nutritifs, la capture d’exergie. Cependant, dans d’autres types d’études il pourra être pertinent de les inclure
Services écosystémiques produits par les différentes composantes du milieu récepteur
Benjamin Burkhard et al. (2009) proposent dans un article intitulé “Landscapes‘ Capacities to Provide Ecosystem Services – a Concept for Land-Cover Based Assessments” une matrice (Figure 25) indiquant la capacité (sur une échelle de 0 à 5) de chaque type d’unité paysagère, correspondant à celles de Corine Land Cover, à fournir différents services écosystémiques. Cette matrice est issue de jugements d’experts principalement et présente des résultats génériques, qui, comme l’indique l’auteur, nécessitent des adaptations et/ou des précisions au niveau local.
Matrice des services : outil de base pour l’étude des services écosystémiques sur un territoire
A la manière de Burkhard (Burkhard et al., 2009) (Figure 25), nous avons choisi de représenter les services pouvant être fournis par les différents types d’écosystèmes dans une matrice des services (Figure 26). Les services retranscrits dans cette matrice sont ceux sélectionnés dans le Tableau 9. Figure 25 : Matrice proposée par Benjamin Burkhard et al (2009) pour l’évaluation de la capacité des différentes unités paysagères à fournir les différents types de services écosystémiques Capacité de l’unité paysagère à fournir des biens et des services Services supports Hétérogénéité abiotique Biodiversité flux d’eau biotique Efficacité métabolique Capture d’exergie (radiation) Reduction de la perte de nutriments Capacité de stockage Services d’approvisionnement Cultures Bétail Fourrage Pêche commerciale Aquaculture Aliments sauvages Bois (construction) Bois (chauffage) Energie Composés biochimiques/médicinaux Eau douce Services de régulation Régulation du climat local Régulation du climat global Régulation des inondations Recharge des eaux souterraines Régulation de la qualité de l’air Régulation de l’érosion Régulation des nutriments Régulation de la qualité de l’eau Pollinnisation Services culturels Récréation et valeur esthétique Valeur intrinsèque de la biodiversité.. Les différents types d’écosystèmes décrits selon la nomenclature CLC sont présentés dans la colonne de gauche, et les services écosystémiques sélectionnés dans la ligne du haut. Figure 26 : Matrice des services écosystémiques produits par les composantes du milieu récepteur Services produits par les différentes composantes du territoire d’étude Habitat Communication et transport Culture Energie Sylviculture Elevage chasse cueillette Pêche commerciale Aquaculture Pêche Approvisionnement en eau Régulation de la qualité de l’eau Régulation de la qualité de l’air Climat Maladies Cycles de l’eau (RN) Régulation des sols (RN) Déchets Réservoir du vivant Esthétique Environnement olfactif Environnement sonore Social Sport Tourisme et loisirs Thermalisme et thalassothérapie Recherche Développement des savoirs Tissu urbain continu Tissu urbain discontinu Zones industrielles et commerciales Réseaux routiers et ferroviaires Zones portuaires Aéroports Extraction de matériaux Décharges Chantiers Espaces verts urbains Equipements sportifs et de loisirs Terres arables hors périmètre d’irrigation Périmètres irrigués en permanence Rizières Vignobles Vergers et petits fruits Oliveraies Prairies Cultures annuelles associées aux cultures permanentes Systèmes culturaux et parcellaires complexes Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants Territoires agro-forestiers Forêts de feuillus Forêts de conifères Forêts mélangées Pelouses et pâturages naturels Landes et broussailles Végétation sclérophylle Forêts et végétation arbustive en mutation Plages, dunes et sables Roches nues Végétation clairsemée Zones incendiées Glaciers et neiges éternelles Marais intérieurs Tourbières Marais maritimes Marais salants Zones intertidales Cours et voies d’eau Plans d’eau Lagunes littorales Estuaires Mers et océans
Matrice portrait
outil de représentation du territoire d’étude A partir de la matrice des services (Figure 26), seules les composantes du milieu récepteur sont conservées dans la colonne de gauche (unités paysagères et masses d’eau). Une étude locale permet par la suite d’identifier les services produits par les différentes composantes. Ces informations pourront être retranscrites dans cette matrice en remplissant les cases : 0 = le service n’est pas produit par cette composante ; 1 = le service est produit par cette composante. Nous avons fait le choix pour cette étude d’évaluer la production de services par les différentes composantes du territoire de manière binaire (0 ou 1) car l’objectif est uniquement d’identifier les services produits sur le territoire. Cependant, comme d’autres auteurs l’ont fait (MEA, 2005), (Burkhard et al., 2009), il est possible, si nécessaire, d’ajouter une échelle d’importance pour chaque service. Cette matrice portrait, élaborée à partir de la matrice des services, est donc un outil que nous proposons afin de représenter les différentes composantes d’un territoire et les services qu’ils produisent. c Matrice « portrait – eau » : outil de représentation du milieu récepteur La matrice « portrait-eau » est le résultat de deux outils décrits précédemment : le diagramme de flux et la matrice portrait. A l’aide du diagramme de flux établi précédemment, il a été possible d’identifier le milieu récepteur : ses composantes et les échanges liés à l’eau. Ces informations peuvent être retranscrites dans la matrice portrait afin d’établir une matrice réduite, que nous appellerons la matrice « portrait – eau ». Dans cette matrice seront représentées uniquement les composantes du milieu récepteur de l’effluent. Ainsi, les services produits au sein du milieu récepteur peuvent être identifiés.