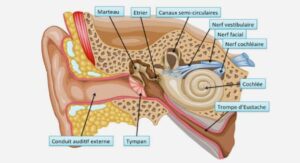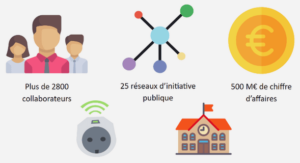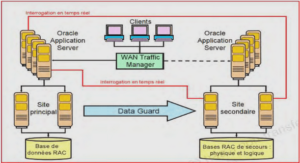Facteurs de risque et états précancéreux
Des études épidémiologiques ont mis en évidence l’existence de facteurs génétiques liés à un taux accru de CCR et dans environ 15% des cas, ce cancer survient dans un contexte de prédisposition génétique.
On définit trois niveaux de risque de CCR dans la population :
– Le risque moyen :
* C’est le risque moyen de la population générale.
* Le risque moyen net d’être atteint d’un CCR avant l’âge de 74 ans est estimé à 3,5%.
Les sujets âgés de plus de 50 ans des deux sexes constituent une population à risque moyen.
– Le risque élevé : [35, 36,37].
* Sujets ayant des antécédents personnels d’adénome ou de CCR.
* Sujets ayant un ou plusieurs parent(s) du premier degré atteint(s) de CCR ou d’adénome. Si le parent avait moins de 45 ans lors du diagnostic de CCR ou si deux parents ont un antécédent de CCR, le risque relatif est alors de 4.
* Patients atteints de maladie inflammatoire de l’intestin (colites étendues).
– Le risque très élevé :
* Sujets appartenant à une famille atteinte de cancers à transmission héréditaire autosomique dominante (voir plus loin « HNPCC et PAF »).
Le risque élevé concerne les parents au premier degré de sujets atteints de CCR ou avec un antécédent personnel ou familial d’adénome ou de cancer colorectal et les malades ayant une rectocolite hémorragique ou une maladie de Crohn.
Le risque est très élevé dans les familles atteintes de cancers à transmission héréditaire.
Facteurs génétiques
L’âge inférieur à 50 ans lors du diagnostic, des antécédents tumoraux personnels, une agrégation familiale de cancers doivent faire évoquer une prédisposition héréditaire et reconstituer l’arbre généalogique du sujet.
Il s’agit de polyposes digestives, adénomateuses et ou hamartomateuses, des cancers colorectaux héréditaires sans polypose (syndrome HNPCC) et de quelques syndromes héréditaires rares (Li- Fraumeni).
Parmi ces maladies, deux représentent des prédispositions majeures à savoir la polypose adénomateuse familiale PAF et le syndrome HNPCC. Le risque cumulé au cours de la vie de développer un CCR lorsqu’ un sujet est porteur d’une altération génétique associée à l’une de ces maladies est supérieur à 80 % en l’absence de traitement préventif ; en pratique, le diagnostic de cancer colorectal aura été fait dans plus de la moitié des cas avant l’âge de 45 ans.
La polypose adénomateuse familiale PAF
La PAF est une maladie de transmission autosomique dominante, qui touche environ un individu sur 10 000 et qui est responsable de près de 1 % des CCR.
Elle se caractérise par l’apparition de nombreux adénomes coliques et rectaux au moment de la puberté avec des manifestations extracoliques possibles mais inconstantes ; adénomes duodénaux, polypose fundique glandulokystique, hypertrophie de l’épithélium pigmentaire rétinien, tumeurs osseuses, sous cutanées, desmoïdes, hépatoblastomes, médulloblastomes et cancers thyroïdiens.
Au cours de la PAF classique, les sujets atteints développent des centaines voire des milliers d’adénomes colorectaux, le plus souvent avant l’âge de 20 ans et 95 % des malades ont une polypose à l’âge de 35 ans. Une polypose est suspectée si plus de 15 polypes adénomateux colorectaux synchrones ou métachrones sont mis en évidence. Le pronostic est dominé par le risque de dégénérescence maligne qui approche les 100% pour les sujets non dépistés à l’âge de 50 ans. Un diagnostic génétique direct de la maladie est possible et le dépistage adapté par les coloscopies chez les malades porteurs de la mutation délétère identifiés dans leur famille indique le moment de la colectomie préventive. Des formes atténuées de PAF sont décrites au cours desquelles les adénomes sont moins nombreux, prédominent dans le colon droit et se développent plus tardivement que dans les formes classiques. Cette PAF atténuée peut être difficile à distinguer au plan clinique d’un syndrome HNPCC ou syndrome de Lynch. Plus de 90 % des sujets atteints développent des adénomes duodénaux, en particulier dans la région ampullaire qui peuvent aboutir à des cancers du duodénum représentant une cause non négligeable de décès chez des malades atteints de PAF ayant eu une colectomie.
Dans 90 % des cas une mutation constitutionnelle du gène APC situé sur le chromosome 5 est identifiée [38, 39]. Les corrélations génotype-phénotype montrent que la position des mutations sur le gène conditionne la gravité de certaines manifestations cliniques. C’est ainsi que le nombre d’adénomes coliques d’un sujet porteur d’une mutation délétère du gène APC peut varier de 0 à plus de 1000. La présence d’un phénotype atténué, c’est-à-dire de moins de cent adénomes dans le côlon, est liée à l’existence d’une mutation dans les 4 premiers exons entre les codons 1 à 163, dans la partie de l’exon 9 épissée de manière alternative et dans la partie distale de l’exon 15 entre les codons 1860 et 1987. Les formes adénomateuses profuses en tapis de haute laine, sont présentes lorsque la mutation siège entre les codons 1249-1330.
Le Syndrome HNPCC ou syndrome de lynch
Le syndrome de lynch ou (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer) HNPCC a été décrit pour la première fois en 1895 par Alfred Warthin, la première dénomination utilisée fut « cancer family syndrome ». Un demi-siècle plus tard le nom de Dr lynch fut attaché à ce syndrome. En 1984, il décrivit deux syndromes distincts : Lynch I correspondant à des cancers coliques familiaux et Lynch II associant des cancers coliques familiaux à d’autres localisations cancéreuses extracoliques (endomètre, ovaire, estomac). Deux syndromes sont incorporés dans cette catégorie prédisposent en outre à des tumeurs cutanées de type kératocanthomes, cancers spinocellulaires et kystes sébacés (syndrome de Muire Torre) ou à des tumeurs cérébrales de type glioblastome (syndrome de Turcot). En 1997 la dénomination du syndrome HNPCC correspondant aux initiales de hereditary non polyposis cancer fut proposée et retenue.
Près de 5 % des CCR surviendraient dans le cadre d’un syndrome de lynch, vers l’âge de 40 à 50 ans le plus souvent au niveau du colon droit et sont de type mucineux et peu différenciés. Ils sont précédés d’adénomes peu nombreux et de petite taille.
1. INTRODUCTION |